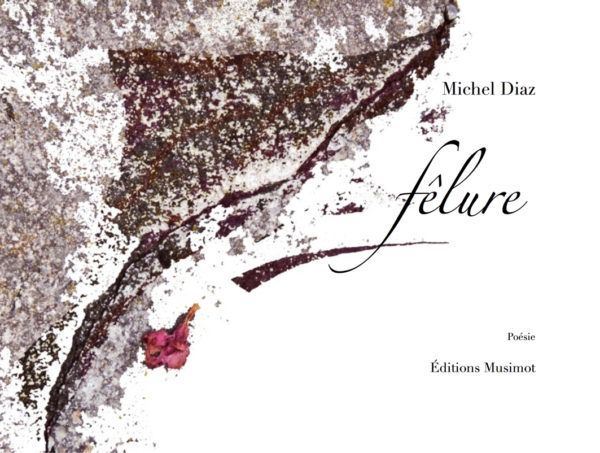 Michel Diaz
Michel Diaz
FÊLURE (Musimot, 2016), LE CŒUR ENDURANT (L’Ours blanc, 2016) lus par Laurent Dubois
Note de lecture publiée dans Les Cahiers de la rue Ventura, n° 37 (sept. 2017)
Michel Diaz ou la fêlure d’un cœur endurant, par Laurent Dubois
S’il nous faut aller, sans détours, dans l’intimité de la chair de ces deux recueils poétiques, je retiendrai ce qui nourrit leur écriture en profondeur, ce thème lancinant que leur auteur trame et tisse d’un texte à l’autre, en fils croisés, indémêlables, qui posent la question de l’être-au-monde, fruit d’un inépuisable sentiment d’étonnement qui se confond avec la soif inassouvie du chant toujours à naître, autant que fruit amer d’une inconsolable douleur.
Nous ne vivons que de devoir mourir, et ne pouvons écrire que sur ce qui ne peut se dire / n’est pas dit, car indicible est tout ce qui se tait. Et le poète ajoute que l’on a rien à dire en vérité / que ce cheminement têtu en nous…
Cheminement obscur de ce quelque chose qui nous travaille, car toujours, au fond de l’orchestre, on entend les mâchoires qui mastiquent la partition, les dents qui mordent dans la chair des heures, le mufle qui s’abreuve à l’auge de la douleur des hommes…
Survivre à l’échéance de la mort qui approche implique d’affronter ce repli coupable de la chair en deuil du désir. Ainsi le cœur vieillissant consent à l’ombre de lui-même, condamnant au seuil de ses abandons tout risque de clartés.
Certains d’entre nous, au-dessus du vide d’ici-bas, s’accrochent aux branches divines, misant leur salut sur l’incertain de l’au-delà. Pour eux, mourir est s’éveiller, aveuglé en pleine lumière.
D’autres crachent sur tout, mais à distance, le venin d’une amertume qu’ils croient produite par la lucidité mais qui, en réalité, tire ses principes actifs du mensonge fait d’abord à eux-mêmes.
Les plus nombreux enfouissent leur esprit dans les sables du déni, somatisant leur crainte viscérale de mourir en maux de toutes sortes.
Pourtant, pour se sentir vivant, écrit encore Michel Diaz, il faudrait convoquer ce miracle ; être là, sans paroles, pas trop en avant de soi et pas trop en arrière non plus, mais juste en équilibre sur la ligne de crête du souffle, accordé au balancement des secondes, au rythme de leur pouls. Libre de toute attente et de toute désespérance.
Écoutons bien cet état particulier de silence que le poète accueille, il n’appelle à rien d’autre qu’une absence écarquillée, ce lieu d’oubli où tout peut se jouer, après mise en jeu de la pure, inestimable gratuité du monde et dont le gain rêvé serait le pur sentiment d’exister. Avant de disparaître ?
… Mais la partie est ardue : le tapis de jeu a la dimension de nos drames, une vie ne suffit pas pour en connaître toutes les règles et qu’avons-nous en mains ? Si peu de signes en vérité pour nommer, sans véritablement les comprendre, les choses par leur sens commun, véritable carcan sémantique. Comment alors questionner ce mystère qui nous habite autrement qu’à l’aide des mots figurant sur les cartes à piocher au hasard – ou à la nécessité – des plis de l’existence ?
Oui, il faut écouter très attentivement la poésie de Michel Diaz, comme on perçoit le pouls d’un sang noirci de tant d’ombres amassées qui cherchent à se répandre et qui, jaillissant du vertige acéré, fulgurant, provoqué par une lame au poignet, délivrerait sa vigueur écarlate .
Seul le poème a le pouvoir de dire l’insoutenable enjeu du réel. C’est la raison pour laquelle on l’a tant bâillonné. Ici, affrontant le risque de se dépouiller de tout, y compris de lui-même, – à la lisière du non-naître, du n’être pas encore ou celle du n’être plus –, Michel Diaz se tient au cœur de ce que la poésie porte de plus bouleversant, de plus douloureux aussi, comme l’est toute
confrontation à la voix profonde qui jamais, en nous, ne s’apaise…
Laurent Dubois, avril 2017
Laurent Dubois, poète et photographe, vit dans La Sarthe. Il a dirigé la revue Argile, au début des années 80, et publié plusieurs livres accompagnés de textes poétiques (dont deux avec Michel Diaz). Il expose régulièrement, depuis de nombreuses années, un peu partout en France.
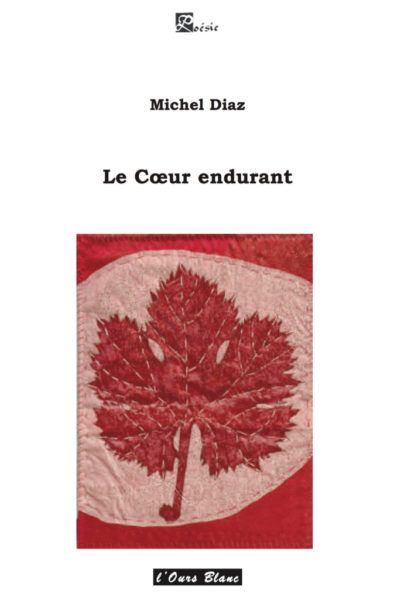 Le Cœur endurant
Le Cœur endurant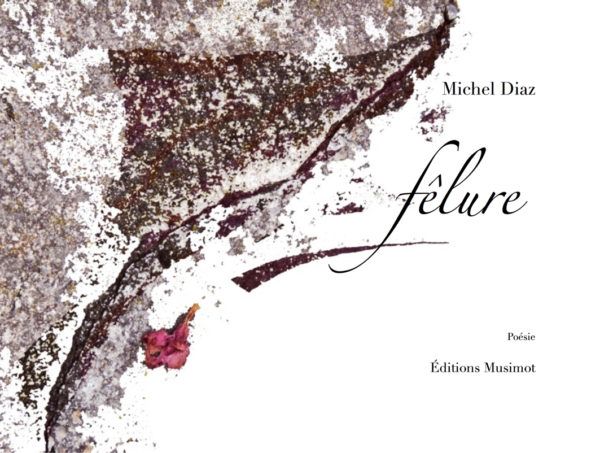 Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.
Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.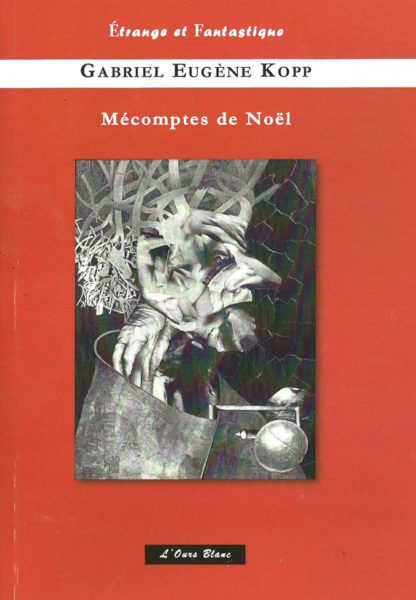 MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)
MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)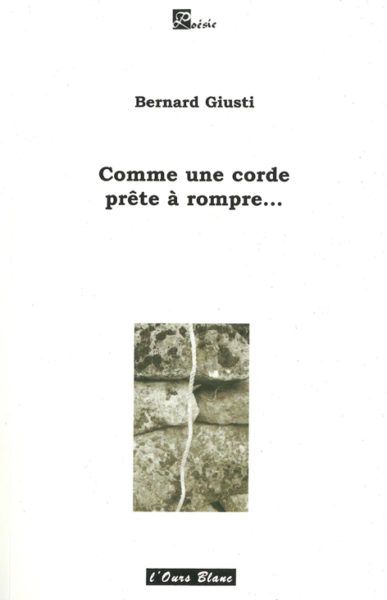 COMME UNE CORDE PRETE A ROMPRE
COMME UNE CORDE PRETE A ROMPRE