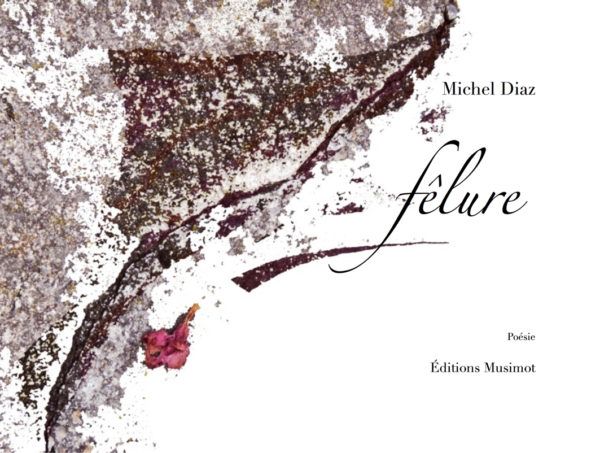 Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.
Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.
« La pure, inestimable gratuité du monde. »
Une lecture de « Fêlure » et de « Le Cœur endurant » de Michel Diaz.
Quelle est cette Fêlure que chacun porte en lui ?
Michel Diaz est un voyageur intrépide, il n’esquive rien, creuse un sillon :
Il y a une vérité, pour chacun, à habiter le monde. Fût-elle maladive, ou de nature indéfinie. Pourtant, pour l’habiter, peut-être suffit-il de le nommer, de toucher, du bout des lèvres, les mots qui le désignent.
Les obstacles sont nombreux, le chemin emprunté vers cette vérité est rude, incurvé d’ornières :
Car il se pourrait bien, d’ailleurs, qu’il n’y en ait aucune de définitive, pas plus définitive que la vie elle-même n’a de sens et que l’on suppose que celui-ci n’est rien qu’une coquille vide.
Mais qu’importe, le poète plonge, se frotte à l’infini, sa vraie matière, sa raison d’être. Et il découvre que le plus proche, toujours, nous est le plus inconnu:
Pour se sentir vivant, il faudrait convoquer ce miracle : être là, sans paroles, pas trop en avant de soi et pas trop en arrière non plus, mais juste en équilibre sur la ligne de crête du souffle, accordé au balancement des secondes, au rythme de leur pouls. Libre de toute attente et de toute désespérance.
Michel Diaz ne cite jamais le Dao, pourtant il est là, quelque chose qui n’a aucun nom et nulle consistance. Ni grain de sable, ni remous de l’air sous l’aile d’un oiseau, ni goutte d’eau qui se balance à la voûte du ciel. Quelque chose qui n’a, ni propre mouvement, ni aucune impulsion personnelle. (…) D’abord, cette évasion de la périphérie du corps vers un au-delà de soi-même, un inéluctable abandon au baiser conjugué de la mer et du ciel.
Avec les mots pour tout bagage ; ils sont le feu qui couve sous la cendre :
Comme on laisse glisser sur sa main, me disais-je à moi-même, l’ombre légère d’un nuage, laisser venir à soi les mots, dans une amitié vigilante.
Ce voyage est une plongée, dans un kaléidoscope, un maelstrom, toujours à la limite de la rupture : Laisser venir à soi les mots, pensais-je, feignant, je le devine, d’avoir l’âme apaisée, c’est s’avancer sur la lisière du non-naître, du n’être-pas-encore ou sur celle du n’être-plus, ce vertige où effroi et attrait vont de pair, étant d’égale signifiance et de même puissance, comme d’ailleurs celle de promener son ombre sur la terre.
Les mots sont aussi la chair ; il n’y a pas de différence entre l’intérieur et l’extérieur :
On entend respirer quelque chose, venu d’on ne sait où, d’on ne sait quelle île lointaine. Venu peut-être aussi de ces régions obscures de la peur, où rien ne moisit, ne fume ni ne rouille, mais survit à tout et traverse les nerfs, les poumons, les planètes, saisit au creux de l’estomac, jusqu’au centre du cœur.
L’unité tant recherchée commence à transparaître : dedans, dehors, à ce moment, ne font plus qu’un.
Lent et patient surgissement , celui d’une voix, une voix qui parle, appelle, se confie, réclame qu’on lui tende l’oreille, quelqu’un peut-être percevrait un lointain murmure d’abeille, un rien de bruit, un linge étendu qui s’égoutte.
Il faut en passer par la mort, dans ce voyage initiatique ; c’est dans la mort à lui-même que le poète cherche la rédemption. Il la trouve dans l’amour, en fin :
Où l’amour même, au revers de toute lumière, a fini, sans regret, d’effeuiller les pétales de sa dernière lampe.
J’ai entendu Le cœur endurant comme un écho à Fêlure ; les deux textes résonnent. Écoutons La Rose penchée :
Les heures, autour d’elle, ont fini de se rassembler. Mais forte de ce qui la lie aux promesses de l’ombre, elle est ce qui, de la lumière, excède le visible. Il n’y a rien qu’un mot pour vivre. Celui, seul, de désir, qui, de son sang irréversible, irrigue le néant.
Le néant, la mort, le désir… Toujours au centre de l’écriture de Michel Diaz :
Blanc de la page
sous la main qui tisse ces mots
la mort à l’œuvre à ciel offert
ses beaux doigts auscultant le silence
de son éternelle étrangeté
pétrissant à travers ses beaux yeux
la matière pure de son néant
Pour tout bagage, Le voyageur convie l’impensé du langage ; Michel Diaz lance ses phrases dans plusieurs directions, le sens en est multiplié ; il nous pousse au vertige :
Il n’est d’ineffaçable
que le sang du rêve
au verso du sommeil
que l’infinie
patience de la mort
dans l’épaisseur des pierres
il n’est d’inaltérable
que ce que la clarté du jour
demande à l’impensé de dire
et ce que répond le silence
Le désir est désir d’unité ; c’est là précisément la littérature, le poème :
ainsi toute invention
et toute la réalité du monde
ne sont que dans les mots
pour l’univers comme
pour le néant
on ne touche rien
du bout de ses doigts que
la chair du temps qui s’écoule
dans un écoulement heureux
on ne ressent rien
d’autre au creux de sa poitrine
au midi recueilli de son corps
où la pensée a levé l’ancre
que le pur sentiment
d’exister
Le Graal tant recherché, il l’entrevoit, le pressent, le devine, le poursuit et s’il le trouve, c’est dans le Temps :
et il y a l’aube chargée de fruits
la lumière qui veille au dehors
comme une fontaine paisible
une lampe d’eau claire
une abeille contre la vitre
les courbes d’un nuage
rien que la plénitude de l’instant
C’est dans un état second qu’on ferme le livre ; hébété, mais lavé, reposé, comme si une étape avait été franchie ; l’harmonie profonde qui se dégage de l’écriture de Michel Diaz délivre, libère. Un souffle magique, régulier et profond est passé délicatement sur nous…
Raymond Alcovère
« Fêlure », éditions Musimot, novembre 2016
« Le Coeur endurant », éditons l’Ours blanc, automne 2016
À noter dans ces deux livres, les superbes créations graphiques de Monique Lucchini et Jeannine Diaz-Aznar.
Raymond Alcovère a publié plusieurs romans, dont Fugue baroque, Le sourire de Cézanne, et Le bonheur est un drôle de serpent, un recueil de prose poétique : L’aube a un goût de cerise, mais aussi des récits historiques, Histoires vraies en mer Méditerranée et plus récemment un abécédaire : Roman de romans.
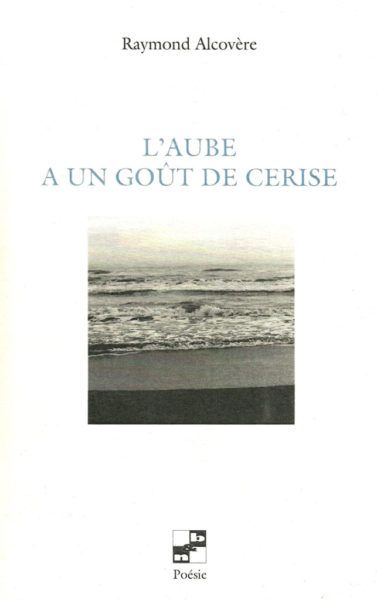 L’AUBE A UN GOUT DE CERISE – Raymond Alcovère
L’AUBE A UN GOUT DE CERISE – Raymond Alcovère Dans l’un de ses textes, Saint-John Perse s’interroge ainsi: « comment il nous vint à l’esprit d’engager ce poème, c’est ce qu’il faudrait dire. Mais n’est-ce pas assez d’y trouver son plaisir ? »
Dans l’un de ses textes, Saint-John Perse s’interroge ainsi: « comment il nous vint à l’esprit d’engager ce poème, c’est ce qu’il faudrait dire. Mais n’est-ce pas assez d’y trouver son plaisir ? »