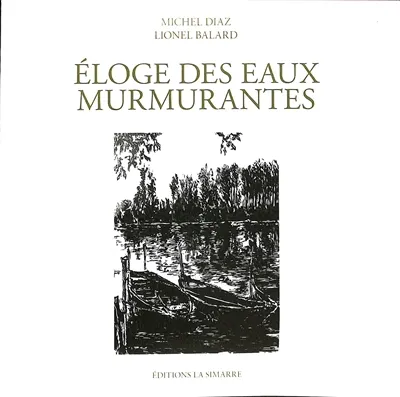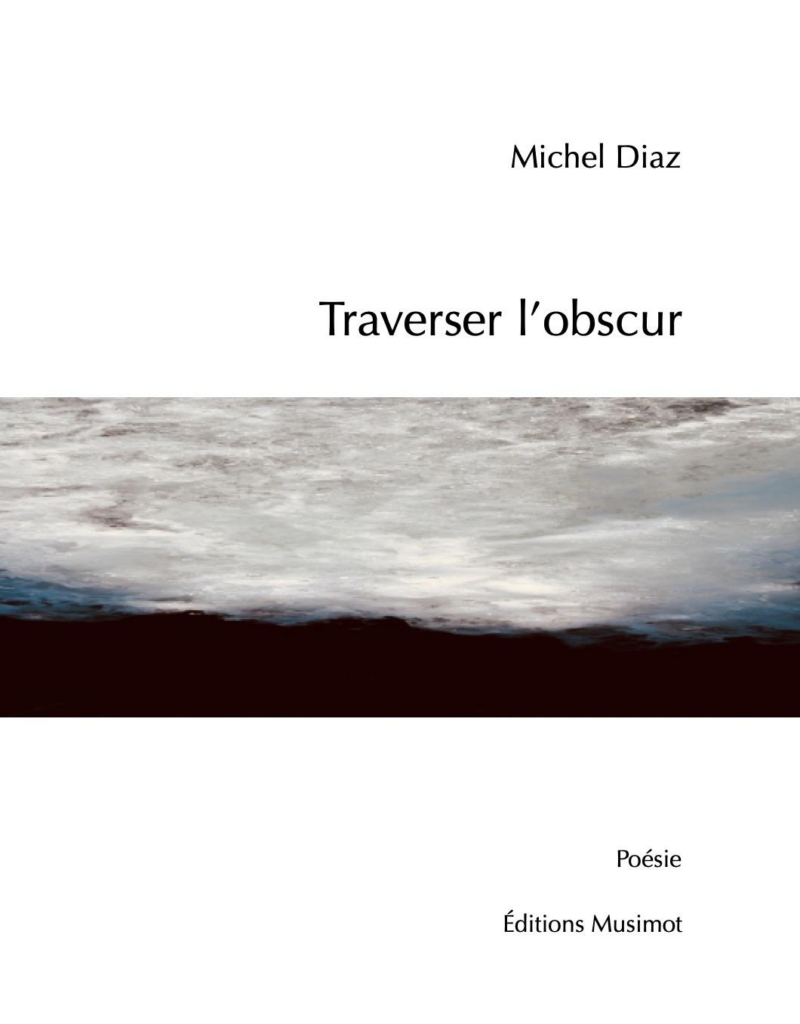
Traverser l’obscur
Michel DIAZ
préface de Jean-Louis Bernard
Éditions Musimot (2024) – 98p
Note de lecture de Jean-Pierre Boulic, à paraître dans un prochain numéro d’Arpa.
Au fil des lectures que proposent les recueils de Michel Diaz, une constante s’impose : l’errance – qu’il sait être le réel propre à chaque humain mais où la patience en est le prix inestimable. Mais alors de quelle sente initiatique peut-il être question, lorsque dans le nouvel ouvrage Traverser l’obscur que le poète vient offrir à ses lecteurs, il observe que « on rôde/égarés en nous-mêmes » avec « toute cette douleur/qui a fait notre histoire » ? Seraient-ce là les ténèbres de l’errance (« nous ne serons jamais que nos ombres ») comme peuvent le laisser entendre ces « Leçons de ténèbres », titre de la partie initiale du livre ?
La crainte de l’abrupt d’un monde sombre que nous observons chez Michel Diaz se matérialise dans les thèmes liés à la solitude, l’abandon, la souffrance, voire l’insondable. Et rien ne nous interdit de faire un rapprochement avec ces autres « Leçons de ténèbres » que le compositeur François Couperin (1668-1733) laisse surgir des lamentations du prophète biblique déplorant la destruction de Jérusalem… La comparaison – peut-être audacieuse – ne paraît nullement déplacée : personne n’échappe au tragique qui traverse l’existence.
Mais qu’en sera-t-il des temps à venir si « nos souffles/enchaînés à leur roue de supplice » devaient en être définitivement le signe ou la fatalité ? L’approche qu’en fait Jean-Louis Bernard, en préfaçant l’ouvrage, incite à demeurer vigilant : « Il n’y a pas de fin à cette errance-là […]. Et donc, au fond, l’énigme que nous recherchons en cette errance, ne serait-elle pas l’errance elle-même, et sa disponibilité à l’imprévisible ? » Nous pourrions ajouter l’impossible si l’on suit le poète face « au mystère insondable de l’univers ».
« Comme une porte au vent » ouvre la deuxième partie du recueil, demande « où trouver le lieu du passage » quand on a « la nuit dans la poitrine ». Le poème donne à découvrir ici, dans sa prose ample, une voie possible quand il confie : « la caravane indigente des rêves t’enseigna peu à peu à pétrir le pain de ta parole – qui avait goût de cendre, la soupe de tes soirs la lenteur du silence et des larmes… ». Jean Sulivan déclarait que l’on écrit pour se sauver du monde. Alors, comment guérir par l’écriture, a fortiori par le langage poétique, à un moment où l’on se heurte aux affres de la consommation et de la violence ?
Mais la parole de poésie – son espace – est seulement un lieu – celui du réel refondé, celui de la relation intime où existe ce qui fait vivre en vérité : « je vous écris d’un lieu/où il y encore – on ne sait/pour combien de temps -/ des arbres sur la terre/et de l’air dans les feuilles/du feu dans les nuages/et de l’eau dans le ciel ». Le poète sait voir et partager. La parole du poème ne croit pas à la vacuité de l’univers. Michel Diaz le révèle dans cette troisième partie, « L’ombre dissout les pierres », placée sous les augures d’Henri Meschonnic affirmant que « la lumière vient toujours après le noir », en attente d’une « bouffée d’éternité » relève Michel Diaz.
La quatrième séquence de l’ouvrage est une puissante méditation sur l’ « Être là » qui est finalement l’attitude conditionnant la réussite (le bonheur ?) de toute destinée humaine, véritable aventure qu’il faut considérer comme telle, même « en compagnie de la mélancolie » car il y a sûrement à rencontrer et accueillir ces « instants d’une lumière/dont la grâce soudain accordée/refait le commencement/du monde ». Instants de silence pur, dit le poète, qui laissent découvrir l’« incandescence/d’une simple fleur/sur laquelle descend butiner/un fragile rayon de soleil ».
Ce recueil, sous le bel écrin de l’éditeur, est partage d’une aventure et incitation à la quête du vivant, y compris dans ses méandres, et surtout comme un levain dans le monde « en état de perpétuelle naissance ».
Jean-Pierre Boulic (juillet 2024)