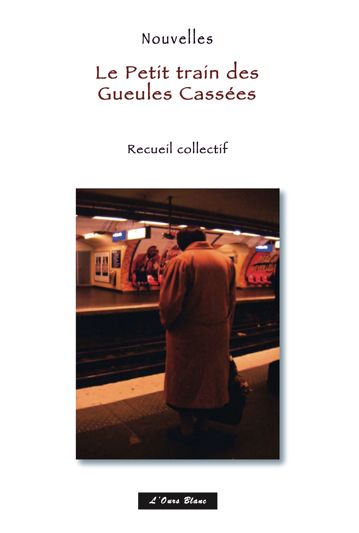Conversations dans un jardin
Bernard Pignero
Encretoile éditions, 2021
Lecture de Michel Diaz, note de lecture publiée in Diérèse N°82.
Ce recueil de nouvelles de Bernard Pignero, au titre verlainien, Conversations dans un jardin, est composé de six récits, trois brefs et trois longs, disposés selon l’alternance de leur dimension, et couvrant une variété de sujets dans laquelle on retrouve certains thèmes déjà évoqués dans d’autres ouvrages de cet auteur.
Il nous faut d’entrée dire que les nouvelles de Bernard Pignero sont écrites dans une langue riche, remarquablement maîtrisée qui révèle un travail ciselé dont la prose contemporaine (romanesque ou nouvelliste), dans la grande majorité des publications actuelles, semble désormais avoir oublié la nécessité. Il faut, en effet, à l’auteur de ces textes, une belle maîtrise de son outil syntaxique pour conduire aussi sûrement le lecteur à travers des phrases de huit, douze ou quinze lignes, comme on en rencontre parfois dans ces pages, petits bijoux d’orfèvrerie qui ne sont pas pour peu dans le plaisir gourmand que l’on prend à le lire. Aussi, dès les premières pages, peut-on éprouver l’heureux sentiment que nous avons affaire à un beau prosateur.
Ajoutons encore que Bernard Pignero n’investit, ni stylistiquement ni formellement, le genre de la nouvelle pour en faire un champ d’expérimentation littéraire qui obéirait au désir de céder à quelque préoccupation de modernité narrative. Son projet est tout autre, et ailleurs, et d’abord dans le choix et le traitement de thèmes actuels qui enracinent ses récits dans la plus immédiate contemporanéité. En fait partie, par exemple, dans Catégories, qui ouvre le recueil, la question du trouble des sentiments chez deux jeunes gens d’aujourd’hui qui s’interrogent sur l’importance que revêt l’attirance pour quelqu’un du même sexe. Par exemple encore, dans La fenêtre ouverte, les amours compliquées et mutiques d’une jeune épicière de campagne et d’un jeune chômeur, un peu frustre, aux études interrompues, obligé de partir à la ville parce que la terre ne paie plus, qu’elle soumet ceux qui n’ont pas d’autre choix qu’y rester, les autres humbles comme lui, à d’autres conditions d’esclavage. Ou aussi, dans Conversations dans un jardin, les échanges entre un journaliste invité par un ami à une garden party, et le jeune amant de ce dernier. Echanges au cours desquels tomberont dans la tête de l’invité, pourtant a priori « libéral, tolérant et ouvert » les derniers préjugés et les dernières réticences qu’il nourrissait secrètement encore à l’égard des amours homosexuelles. Quant à la nouvelle, Sillage, elle met en scène la vie amoureuse, quelque peu tâtonnante, d’une jeune étudiante en droit constitutionnel et de son compagnon Karim, émigré de la deuxième génération, encore mal dégrossi, avec des idées préconçues sur tout, des préjugés et d’abord sur les femmes. La dernière de ces nouvelles, Un pianiste, sûrement la plus douloureuse, évoque un musicien, doué depuis le plus jeune âge, aux prises avec un drame intime, puisque ce grand beau jeune homme n’était pas d’une nature fragile, ni d’une santé précaire, bien au contraire, mais il était inscrit dans le secret de sa construction physio-psychologique une incompatibilité apparemment rédhibitoire entre les talents musicaux qu’on lui reconnaissait et la faculté d’en faire l’exhibition publique.
Mais s’il inscrit ses récits, qui ne débordent jamais du réel, dans l’époque où nous sommes, son auteur y fait cependant la part belle à quelques-unes de ces éternelles questions qui sont, depuis longtemps, sinon depuis toujours, la matière même de la littérature sous toutes ses formes et, entre autres, à cette question que la quatrième de couverture formule de la sorte : « N’y a-t-il de véritable amour qu’impossible ? » Question à laquelle chacun de ces récits répond à sa manière. Mais jamais avec violence ni dramatisation excessive, car il n’y a, dans l’esthétique de Bernard Pignero, aucun goût pour les fins résolument malheureuses, brutales ou tragiques, ni pour la noirceur des sentiments. D’ailleurs, même dans Un pianiste, nouvelle que nous qualifiions plus haut de plus « douloureuse » de toutes peut-être, la fin du récit nous montre un personnage qui aura raté sa carrière annoncée de brillant concertiste, un homme brisé certes dans ses ambitions, éternellement dépressif et sans doute un peu suicidaire, mais retiré dans la montagne et passant ses journées au milieu de ses ruches à parler avec ses chères abeilles.
En tout cas, quels qu’ils soient, ces personnages ne sont jamais tout à fait « anges » ni tout à fait « salauds », mais l’un et l’autre en même temps, l’un dans l’autre selon les circonstances d’une situation, les pensées et les tensions qui les traversent. Des personnages qui, l’espace d’un court récit, nous deviennent très vite familiers et généralement sympathiques.
L’option du point de vue utilisé par l’auteur de ce recueil relève de la narration traditionnelle, telle que la forme romanesque l’a véhiculée jusqu’à nous. Sur les six nouvelles que contient le recueil, Bernard Pignero n’adopte le principe narratif de la focalisation interne que pour deux d’entre elles, une brève et une plus longue, Catégories et Conversations dans un jardin. Les quatre autres seront écrites selon le point de vue dit de la « focalisation zéro », c’est-à-dire confié à un narrateur omniscient, qui voit tout et sait tout de la moindre pensée de ses personnages. Mais Edouard Pignero ne se contente pas d’user de ce procédé narratif pour se livrer à quelques réflexions sur la psychologie de ses personnages. Il s’en sert aussi, et de manière moins conventionnelle, comme s’il voulait par moments étudier, à la manière d’un observateur des phénomènes du psychisme, les mouvements de pensées, complexes et inattendus, qui se font dans la tête des personnages : pensées indépendantes qui, dans le même esprit et au même moment, se superposent ou se juxtaposent, se croisent ou interfèrent entre elles, donnant ainsi l’image d’une activité cérébrale en perpétuelle mouvance, comme dans le ciel les nuages prennent des formes qu’ils défont pour les transformer en d’autres figures. Nous nous contenterons, pour ne pas être trop long, de ne citer que cette phrase, mais suffisamment éclairante de cette démarche : Ainsi, pensait Jérémy – tout en remarquant qu’il était capable de mener presque de front deux réflexions sans rapport entre elles (cette remarque constituant en fait un troisième mais très provisoire niveau de son activité cérébrale) -, sur ces cinq jeunes, chacun pouvait prétendre être le seul à faire quelque chose qui le distinguait des autres et les classait donc dans une catégorie distincte.
Rien de gratuit pourtant dans ces observations quasi cliniques du psychisme humain. Mais au contraire des moments d’une démarche d’écriture dans lesquels nous ne pouvons que constater les étonnantes configurations de nos paysages intérieurs, où nous croyons conduire nos pensées, alors qu’en vérité nous n’en sommes pas toujours maîtres. Qu’il nous faut reconnaître que ce que nous appelons « penser » consiste à frayer son chemin à travers tous ces « bruits » qui peuplent continument notre esprit, s’y pressent et s’y heurtent, se parasitant pareils à la cacophonie qui remonte de la fosse d’orchestre au moment où les musiciens, et chacun pour soi, s’occupe d’accorder son instrument.
Mais en matière de récits, Bernard Pignero est un compositeur qui connaît son métier et sait parfaitement quel cadre il faut donner à la nouvelle. Celle, en tout cas, que nous reconnaissons dans notre littérature comme obéissant à des règles qui ont prouvé leur efficacité. Il suffit, pour les retrouver, de relire ces brefs récits que sont La voie et la vertu, trajectoire d’une vie qui s’arrache à la solitude affective et à son austérité monacale pour atteindre à la réussite intellectuelle et s’achever dans la douce quiétude de la sérénité ; ou encore Sillage, cette autre trajectoire questionnante d’elle-même qui s’achève, elle, sur le sentiment qu’a la jeune étudiante d’avoir compris les liens qui unissent les êtres et les choses et du sillage invisible qui nous suit.
En cela, Bernard Pignero s’inscrit dans l’analyse que Baudelaire, traducteur de Poe, comme on le sait, a proposé de la nouvelle, et répond à ces mêmes attentes : « (…) cette lecture, qui peut être accomplie tout d’uns haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture brisée, interrompue souvent par les tracas des affaires et le soin des intérêts mondains. (…) L’artiste, s’il est habile, n’accommodera pas ses pensées aux incidents, mais ayant conçu délibérément, à loisir, un effet à produire, inventera les incidents, combinera les événements les plus propres à amener l’effet voulu. »
Et Bernard Pignero, en artisan averti de la nouvelle, sait bien que dans cet exercice il faut mesurer l’espace impartit à la description, au dialogue, à la séquence. Que la moindre faute d’architecture y apparaît, et les complaisances aussi. Qu’il convient d’empoigner le lecteur, dès la première phrase, pour l’amener à la dernière, sans arrêt, sans escale.
La nouvelle, telle que la pratique l’auteur de ces Conversations dans un jardin, redonne à l’écrivain le pouvoir de gérer le temps, de créer un drame, des attentes, des surprises, de tirer les fils de l’émotion et de l’intelligence, puis, subitement, de baisser le rideau. Et quelle plus exacte illustration de ce que nous venons d’écrire que les dernières phrases de La voie et la vertu : (…) Charles observa longtemps (par la fenêtre) un grand navire blanc qui traversait la baie dans le soleil couchant, passait sous le pont et prenait la mer. Il le suivit du regard aussi loin que portait sa vue. Puis il ferma les yeux pour toujours.
Michel Diaz, 05/06/202

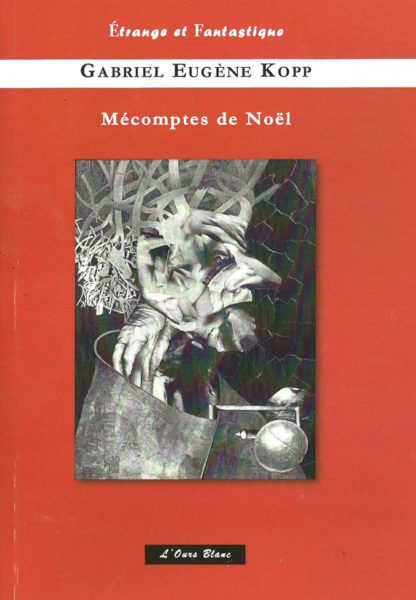 MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)
MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)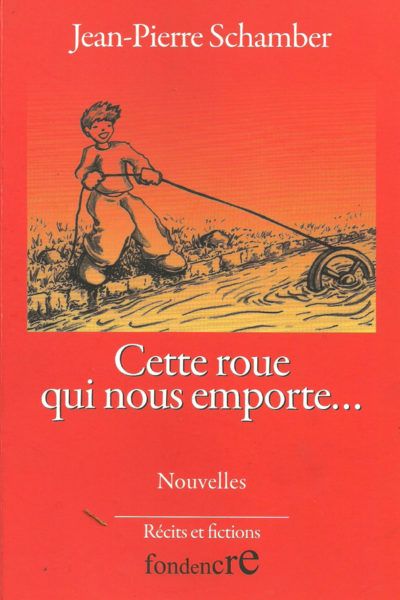 CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber
CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber