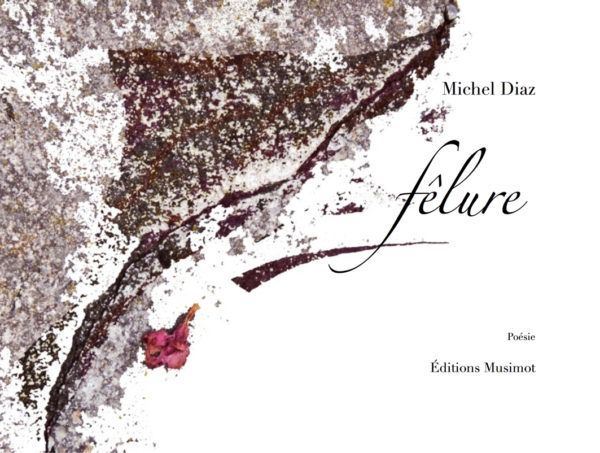 FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).
FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).
Inscrit Au Vital du Diaz : Ce produit des laboratoires Musimot est :
une ordonnance,
une prescription
une thérapie pour les mal-respirants aigus ou chroniques francophones ! Cible potentielle : 274 millions de patients dans le monde !
Michel Diaz nous offre là un soin profond et efficace pour tous ceux qui auraient des difficultés d’être avec l’air qui entre et avec l’air qui sort. L’air et la chanson, évidemment ! Respirer est le maitre mot de ce livre. Chaque syllabe de ces versets (oui, qu’on les apprécie ou pas, il y du Claudel et du St John Perse dans cette composition), chaque syllabe est pensée, pesée et ressentie pour être dite à haute voix. Déclamez Fêlure, récitez-le, vous entendrez. Normal, le docteur Diaz, c’est un homme de théâtre.
Pas un pet de travers !
Cet ouvrage est une performance extraordinaire : un contenu irréprochable joint à une beauté formelle que Musimot a produite font de ce petit recueil un besoin, une nécessité, une solution, une délectation.
Alliez la douceur du toucher et le format, le grain du papier et la mise en page offerts par une éditrice chevronnée et subtile à la balance à trébuchet du diamantaire Diaz et vous aurez cette pépite. Cette panacée.
Moi qui ne suis d’ordinaire pas tendre pour la poésie contemporaine, je me vois et je me lis obligé de retenir mon acrimonie. Mais je ne souffre pas de le faire, je souffle…
« Respirer seulement me fut, pendant longtemps, une souffrance de presque chaque instant.
Mais j’avançais ainsi… Souffle sans voix qui bée, voix qui, souffle coupé, bégaie, soulevant à chaque syllabe ses pelletées de terre, remuant aussi sur la langue ses tonnes de graviers. »
Enfin, je reprends haleine
Et là où chez d’autres auteurs j’aurais eu les pieds pris dans les pieds mal ajustés et déjà trébuché ; là où dans bien des recueils j’aurais été, le nez dans la poussière, étouffé de souffreteuses grossièretés, suffoqué d’inélégances déséquilibrées, Michel Diaz me permet de rester debout, d’aller bon train sans m’essouffler à travers les pays de ses enfances et les messages de ses jours, par-dedans une sensualité évoquée qui résonne au fond de mon âme.
Ménage
Ce bouquin doit figurer sur votre bureau, sur votre frigo, sur vos étagères, dans vos poches. Et au cas précis où la modernité bousculée vous couperait le souffle, posez vos pattes dessus ce livre, laissez sa douceur et sa douceur et sa caresse, et son chant et son chant et son chant et son chant, et son rythme vous offrir les quelques secondes de respiration nécessaires à poursuivre votre route, ou à vous asseoir pour attendre tranquillement la fin de l’angoisse…
Lire
« Un corps léger, de peu de signifiance, débarrassé du plomb de mes organes et s’avançant comme une danse dans le ciel ouvert.
Un corps flottant dans la lumière en brumes, pareil à un éclat de rire du soleil après la pluie. »
Posologie
À utiliser sans modération.
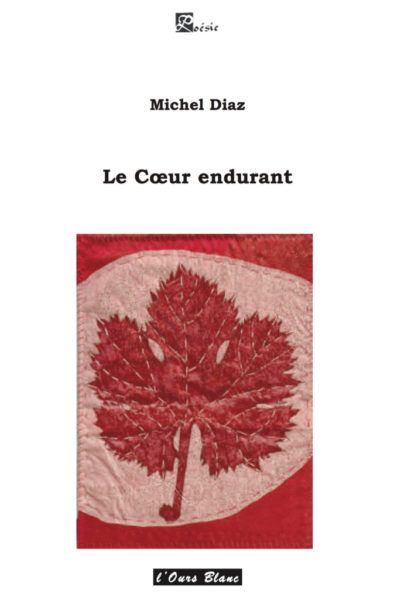 Le Cœur endurant
Le Cœur endurantMichel Diaz ne fait pas que jouer avec les mots : la rigueur de la composition de ce recueil ne fait aucun doute. La force de ses évocations nous gagne à nouveau, — il nous y a habitués — le sens de son dire nous appelle : c’est normal, Michel Diaz est un poète et sa tâche de poète il la fait bien !
J’ai rarement eu l’occasion, sauf parmi les plus grands (il en est peut-être un) d’admirer le travail scrupuleux auquel un poète, plus que tout autre écrivain doit se livrer. Avec Le Cœur endurant, publié dans cette superbe collection « Poésie », chez l’Ours Blanc, l’auteur m’a emporté vers son univers de la facture d’instruments qu’est sa poésie : cent fois sur le métier il a dû remettre son ouvrage.
La spontanéité ? Qui a prétendu que façonner son œuvre dénaturait l’émotion ? Assez de fadaises cossardes et vaniteuses sur l’improvisation et le premier jet qui serait plus véritable. Vomir serait-il plus positif que digérer ? À l’authentique pelleteur de nuages s’échiner ne fait pas peur : pris entre le souci de respecter son âme et son projet et de rendre le tout lisible, il lui faut de la force et une habileté à construire, et détruire, et construire… Endurance.
Dans ce recueil, rien de faible et rien d’abandonné sans élaboration. Jusqu’à la fin, Diaz est sans imprudences ni impudence.
Mais je m’éloigne de mon propos : l’ouvrage m’a emporté et plu. C’est un fait… Et m’a donné un cœur qui parfois me fait défaut. Non, il y a plus osé, et plus périlleux dans ce texte : il y a du courage !
Comment appeler autrement le fait qu’un homme de théâtre aussi reconnu que lui, s’aventure à vider sa partition, son scénario, de quasiment toute ponctuation !
Certes, ses vers sont si bien articulés que la ponctuation peut être considérée comme secondaire (sauf aux endroits où l’intelligence du verset le réclame pour éviter équivoques et approximations), mais un vrai poète ne laisse rien au hasard : j’ai perçu dans ces pages qu’il avait fait un choix lucide et structurant ! Les quatre premiers chapitres de ce recueil sont de cette veine.
Pierre Reverdy disait : « Chaque chose est à sa place et aucune confusion n’est possible qui exigerait l’emploi d’un signe quelconque pour la dissiper. Chaque élément ainsi placé prend plus rapidement et même plus nettement dans l’esprit du lecteur l’importance que lui a donnée l’esprit de l’auteur. »
C’est le cas ici. Et c’est un coup de force : Diaz nous impose, à son habitude, la voix haute ! La voix haute oblige à la respiration, la respiration, c’est la ponctuation, c’est l’auteur, c’est le lecteur ainsi guidé dans l’intime du poète ! Mais Diaz nous fait aimer les vraies chaines de la poésie.
« …
caresser
le velours de la nuit
d’un mot de l’autre y
entendre marcher le silence
à pelage de fauve
… »
La quatrième partie du recueil est bien souvent plus sage dans l’écriture. Mais c’est sans doute parce que Diaz veut y délivrer un message ne laissant pas d’ambiguïté quant à son propre avis et sa propre vie : l’auteur parle de lui, il décrit son âme, c’est poignant. Alors quel intérêt d’associer ainsi dans un même ouvrage deux rédactions différentes sur le plan formel et sur le plan du symbolisme ?
Mauvais décodage du titre de cette partie ! Au piquet, lecteur superficiel : ceci est un émargement ! Car un rêve montré d’emblée se doit de recevoir le cadre du sujet rêvant et ce cadre se nomme Pierres d’angle : il ratifie : Diaz ! La signification complète est alors : rêvez avec moi !
Le rêve d’abord, le moi en dernier, étayant ledit songe sans forfanterie, histoire qu’il se partage, et que ne disparaisse pas la signature, car il n’y a pas de rêve sans au moins un rêveur :
« … Une aube qui s’inventera un nom sous les paupières closes de la nuit, se fraiera un chemin de lumière. »
Qu’il partage son rêve intime ou sociologique, c’est un risque que prend un auteur. Qu’il en assume la paternité, qu’il soit la « pierre d’angle » de son rêve, quoi de plus normal.
Gabriel Eugène KOPP
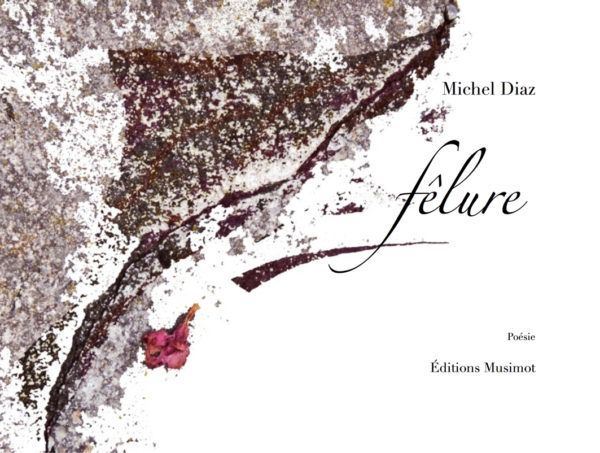 FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).
FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).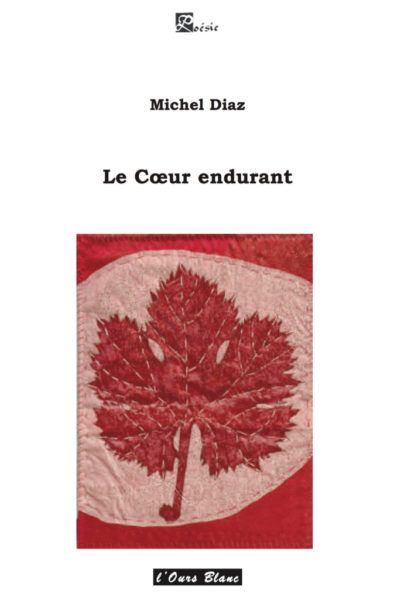 Le Cœur endurant
Le Cœur endurant