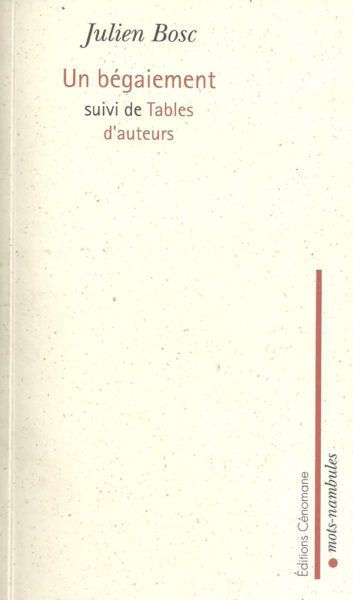 UN BÉGAIEMENT
UN BÉGAIEMENT
– suivi de Tables d’auteurs –
Julien Bosc – Editions Cénomane (2016)
Chronique à paraître dans Les Cahiers de la rue Ventura
… Elle pleure contre un mur, le lâche, se retient, cède, et est par terre, en boule, dans l’ombre, à l’abri du feu, avant le feu, et très fin. […] et ça dit, dans sa tête aussi ça dit « elle ouvrit les yeux et, pleura contre un mur, le lâcha, se retint et fut par terre, en boule, dans l’ombre, à l’abri du feu, avant le feu et très fin, du blanc. »
Ainsi s’ouvre le texte de Julien Bosc, ainsi s’achève-t-il, au bout du bout de son ressassement. Tout est dit, se dit, se parle entre ces deux phrases, ou lambeaux de phrases. Ce « quelque chose » qui se dit, se parle, et pourrait se parler comme à l’infini d’un cheminement de parole où, pour ne pas se perdre, il faut se cramponner aux mots de ces phrases que leur auteur déroule, la plupart du temps, sur l’espace de plusieurs pages, et pourrait poursuivre plus loin encore. Ce « quelque chose » qu’il conduit jusqu’à l’épuisement du souffle, jusqu’à la dissolution de ce corps dans sa fatigue extrême, ou sa dispersion dans le feu, la poussière, la cendre, le sable, le silence définitif, dans l’absolu du blanc, de ce qui s’est vidé jusqu’au bout de son sang, l’a regardé couler, sans un mot ni un geste pour le retenir, tentative inutile, parce qu’il est aussi le sang du temps, le sang du monde qui n’arrête pas de saigner d’une blessure ouverte au-delà de toute conscience, comme on ne peut ni arrêter ni endiguer la matière du rêve.
Or, il ne s’agit pas ici d’un rêve mais, au contraire, de la conscience suraiguë d’être plongé vif, écorché, l’esprit pantelant, dans le monde, et dans le temps du monde, jusqu’à l’indicible de la douleur, jusqu’aux origines d’une souffrance qui n’a, pour s’exprimer, comme en une entreprise d’exorcisme, que le théâtre de son propre corps.
Ce texte, errance hallucinée dans la parole, vertige sans réel début ni fin, expérience d’une descente dans les enfers physiques de l’être, pourrait aussi bien être un texte de théâtre. Il n’y a ici rien de plus de ce que l’on pourrait attendre d’une partition dramatique, d’une mise en espace où se jouerait l’essence même du théâtre. C’est-à-dire bien peu de choses si l’on voulait aller au bout de la parole, de l’offrande sacrificielle du corps du comédien, et d’une tentative dramatique extrême. Il suffirait alors d’un espace scénique indéterminé et d’une lumière crépusculaire, d’un mur aux pierres apparentes et blanchies à la chaux, d’un corps capable d’endurer une telle épreuve, et de ces mots tissés comme un terrible oratorio conçu pour une voix, qui ne passe pourtant par aucune bouche, une voix qui remonte de profundis et qui, comme on peut le lire en quatrième de couverture, cherche sa parole, arpente les labyrinthes du corps, se blesse au mur du silence, balbutie au bord des lèvres, de toutes les lèvres, s’affronte au souffle inaudible, un bégaiement.
A côté de cela, toute mise en scène d’un texte de Beckett (même ses textes sans parole) nous semblerait presque trop sage, le dépouillement du théâtre de Peter Brook nous paraîtrait encore trop chargé d’intentions, et il faudrait aller chercher du côté du « théâtre pauvre » de Grotowski, espace, jeu, esprit, pour approcher ce que l’on imagine *. Ce qui est donné à imaginer: (…) un mur, celui-ci derrière elle, s’y adosse, la tête inclinée, les jambes étendues devant elle, les bras elle ne sait, quoique la dextre entre les cuisses, mais où les bras, où la langue, aux limites du poumon et de l’estomac, égarée parmi les organes, une langue sous la peau, dans la peau, elle a la langue dans la peau, éperdue et nue, sans lieu ni lien avec rien, un bégaiement, ça bégaie…
Oui, j’ai lu ce texte, d’un bout à l’autre, comme un texte de théâtre, car outre ce qu’il « donne à voir » dans l’abondance de ses descriptions, presque essentiellement visuelles et organiques, on ne peut le lire qu’à voix haute, ou à mi-voix, qu’en emplissant sa bouche de ses mots, à déglutir, à murmurer, à mâcher ou à proférer, dans le souffle coupé, le halètement de la fièvre, le hoquet ou le spasme, le bégaiement, le ressassement jusqu’à la nausée.
Que les choses pourtant soient dites: tout texte littéraire (et celui-ci en est un qui s’inscrit dans la haute exigence), n’est digne de ce nom que s’il est capable de s’affronter à l’épreuve de la parole, au chuchotement, à la confidence, au balbutiement, au soupir, à la plainte, au cri, à la profération, au bégaiement, et à toutes les cordes de la voix humaine. Ainsi, la poésie, qui doit, d’abord nous donner à entendre, avant de donner à comprendre, et qui est affaire de cœur et de pouls, de poumons et de souffle, de langue, de bouche, de dents: (…) or sans mots, sans mots ça parle, le corps avec des mots de tous les jours mais dans sa langue à lui, elle revient sur ses pas, ne cesse d’écouter, à son corps défendant, ils lui échappent, les mots, mais quelquefois un bégaiement, du corps à la tête un dialogue, l’un avec sa langue, l’autre sa mutité, des mots errants, conglobés, dans un point du corps… Il faudrait cependant ajouter à cela ce qui, de la parole, passe par le ventre, les nœuds des intestins, les crampes de l’estomac et leurs élancements, et tout ce qui se joue encore dans l’espace de la poitrine, perfore le plexus, autre théâtre de douleurs ou point nodal d’où s’élargissent les ondes de l’apaisement.
Julien Bosc est aussi poète **. Il n’est donc pas très étonnant que son texte accorde cette place au corps et à la parole qui en suinte. Un corps en peine qu’il nous est donné, ici, de vivre par les mots comme l’on vit à l’intérieur d’une blessure. Elle est cela, ici, le seul lieu qui importe. Car nous ne sommes, ici, ni dedans, ni dehors, mais dans le lieu du signe, espace tout autant physique que mental, où cela remue, se bouscule, s’enchevêtre. Pas les pensées, non, mais leurs bribes, leurs haillons, mais les fulgurances des sensations, de froid, de chaud, de faim, de soif, de peur, de douleur, de plaisir, de vertige, d’évanouissement, d’anéantissement de soi. Mais aussi ces mouvements imprévus, de la tête, des bras, des jambes, de tout un corps qui se défait, se rassemble, se recompose, s’assure de lui-même pour se défaire encore. Un corps qui se blottit entre ses propres bras, ou se recroqueville, se détend et s’étire, se lève, marche, esquisse quelques pas hésitants, trébuche, se redresse, se cogne à quelque chose, un mur, une souffrance qui semble vivre de sa propre vie, respire, soupire, hoquète, vomit on ne sait quel liquide, pisse, défèque et quelquefois se branle, plongeant ses doigts dans un vagin qui saigne… quand la parole continue : un mot, au bord, le jour, mais non, il retourne dans la bouche, se replie sur soi dans l’aorte, s’y resserre, seul, et elle seule aussi; la lèvre fendue, par le signe, l’épellation du signe…
Ce texte de Julien Bosc, Un bégaiement, s’inscrit dans la lignée de ce que nous ont laissé d’autres poètes, des explorateurs, comme lui, qui se sont avancés dans les territoires d’une parole qui a renouvelé notre rapport à la littérature. Nous pourrions aussi bien citer Maurice Blanchot, qu’Edmond Jabès ou Bernard Noël. Mais c’est sur Emmanuel Levinas que j’aimerais conclure, en citant un extrait de l’un de ses textes, relatif à la poésie, qui fait, me semble-t-il, écho à celui dont je viens de parler: Langage discontinu et contradictoire du scintillement. Langage qui par-delà les significations sait faire signe. Le signe se fait de loin, d’au-delà et au-delà. Le langage poétique fait signe sans que le signe soit porteur d’une signification en se dessaisissant de la signification. (…) La poésie transformerait les mots, indices d’un ensemble, moments d’une totalité, en signes délivrés perçant les murs de l’immanence, dérangeant l’ordre. Déranger l’ordre, défaire les structures du langage et bousculer notre quiétude digestive de lecteurs, ce texte de Julien Bosc ne peut se lire que sous ce brutal éclairage. Ou il nous faut alors passer notre chemin.
Michel Diaz, 02/04/17
* Pour Grotowski, l’entraînement physique de l’acteur était un moyen pour accéder à autre chose de plus subtil, de méta-corporel. Il pousse ses acteurs à l’extrême pour diminuer les résistances intérieures de ceux-ci, c’est la via negativa. Le don total de l’ HYPERLINK « https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur » \o « Acteur » acteur pour le jeu organique et immédiat, que le maître polonais nomme alors translumination, fait de lui un « acteur saint ». L’acteur est une fin, alors que le rôle est secondaire ; le rôle est un attribut du théâtre, et pas un attribut de l’acteur. Pour transmettre sa vision du théâtre il distingue la lignée organique de la lignée artificielle ; sans privilégier l’une ou l’autre, il découvre que ces deux approches ouvrent des sentiers d’expérimentation très fertiles. (Sources Wikipédia)
** Poète, Julien Bosc a été publié aux éditions Unes, Rehauts, L’Atelier la Feugraie, La tête à l’envers, Quidam, Potentille. En 2013, il a crée les éditions Le phare du cousseix, dédiées à la poésie contemporaine. Il est lauréat 2015 de la « Bourse Gina Chenouard de création de poésie », décernée par la Société des Gens de Lettres (SDGL).
 UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017
UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017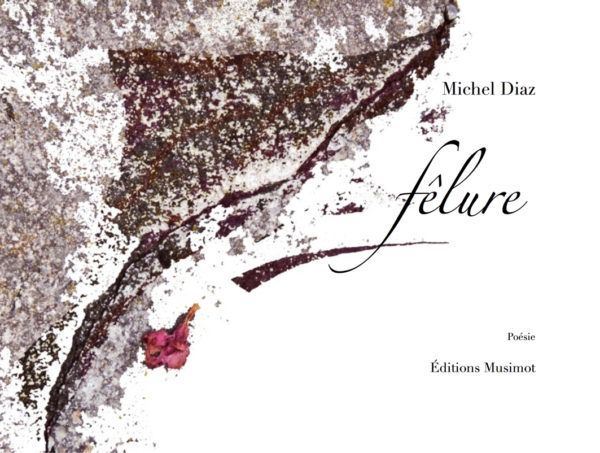 FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).
FÊLURE et LE CŒUR ENFURANT, lecture par Gabriel Eugène Kopp, Chronique publiée dans le N° 50 de Chemins de traverse (juin 2017).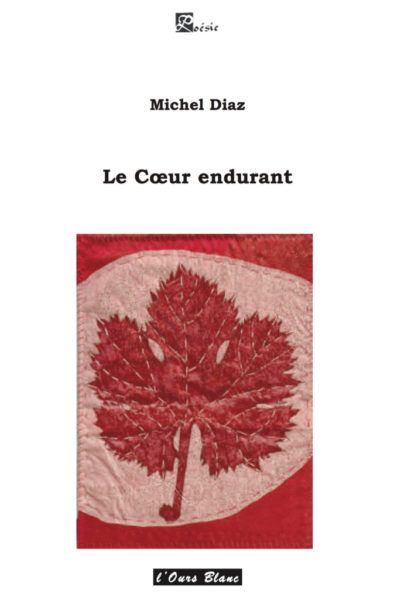 Le Cœur endurant
Le Cœur endurant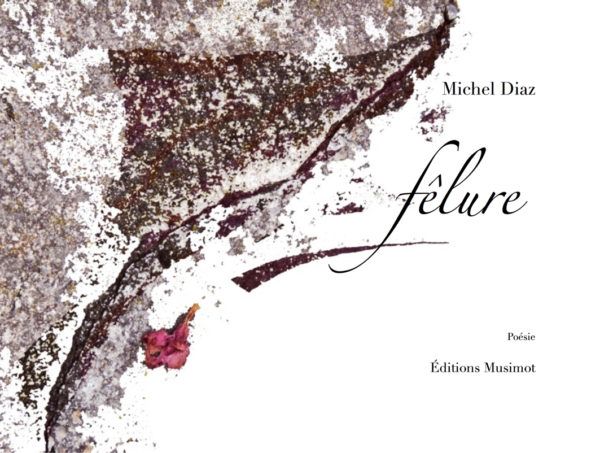 Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.
Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.