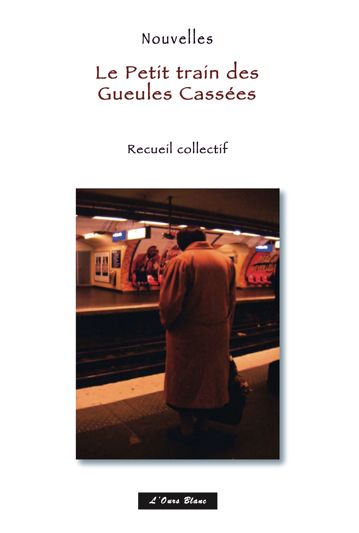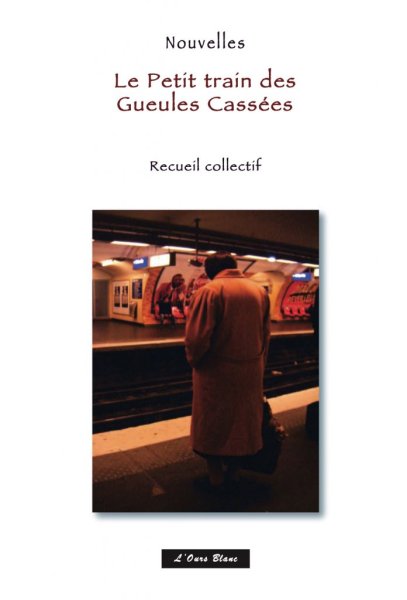Texte d’introduction de Raphaël Monticelli au livre Né de la déchirure, cyanotypes de Laurent Dubois, textes de Michel Diaz, publié aux éditons Cénomane en mai 2015.
Oraison des suaires
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras;
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas;
Ne vois-tu pas le sang lequel dégoutte à force
Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ?
Quelle ancienne complicité avons-nous avec les arbres ? Depuis quand savons-nous qu’ils sont sensibles ? Depuis quand sommes-nous fascinés par les danses qui les animent dans leur apparente immobilité ? Et depuis quand avons-nous appris à les craindre, les chérir, les écouter, et nous confier à eux ?
Nous savons aussi combien ils peuvent être indifférents -majestueux, disons-nous. Ils sont remparts, citadelles, labyrinthes, gouffres, cathédrales. Nous les savons tenaces et résistants au temps, capables de traverser années et millénaires.
Nous connaissons leur pudeur, leur réserve; la façon dont ils s’enfouissent dans la terre; leur manière de boire les eaux, qu’elles soient profondes ou aériennes, de rameuter autour d’eux les grandes nations des eaux, dans le remuement des airs et le vacarme des peuples oiseaux.
Et, si nous savons, parfois, nous incliner devant eux, nous savons aussi les abattre.
Ce livre nous parle d’arbres abattus. Deux voix en dialogue : celle du photographe, Laurent Dubois, et celle du poète, Michel Diaz. Laurent Dubois a approché leurs restes: corps meurtris, déchirés, démembrés, morcelés, veines à vif. Il n’a usé d’aucun artifice, n’a pas sacrifié au goût de l’instantané et de la surprise. Sans mise en scène, il a fait, lentement, le portrait des arbres désolés.
Au fur et à mesure, patiemment, Michel Diaz a regardé ces portraits, a écouté des voix que l’on croyait éteintes. Des silences de pierre pure et des gisements de braise assoupie. Il confie qu’il a écrit ses textes en marchant (…) sur les sentiers des bords de Loire, à travers bois, en communion avec l’espace, le ciel, dans la confidence et la complicité du fleuve et des arbres.
*
Et ce sera bleu. La profondeur dont parle Bachelard ? Voire ! Le bleu de Laurent Dubois est celui de l’ancienne photographie, celui que les architectes utilisaient, il y a peu encore, pour dupliquer leurs plans.
Ce bleu-là est aussi celui qui garde traces de la vie, de la souffrance et de la mort des arbres, le bleu des ecchymoses, la mémoire des coups reçus.
La technique de l’artiste m’importe: elle se plie au respect dont il entoure son sujet, elle donne du temps à la photographie, elle impose une nécessaire lenteur. J’imagine Laurent Dubois posant, directement sur la feuille enduite de solution photosensible, son négatif mis aux dimensions de l’image finale. Nous ne sommes pas dans le laboratoire du tirage argentique. Ni devant l’écran de l’image numérique… C’est la seule lumière du soleil qui marque la feuille, pendant que l’artiste passe tout le temps de l’insolation au-dessus de l’image à faire danser (s)es mains, pour éclaircir ou renforcer le bleu, obtenir des blancs purs, en un mot, modeler l’image. Après l’insolation, c’est l’eau qui révèle et fixe l’image bleue. Elle restitue fidèlement le tracé des veines et des fibres, la morsure des outils, les éclats et les pertes.
Le bleu s’est fait suaire des arbres; l’artiste nous le présente: Voici l’arbre vaincu et couché dans le cercueil de ses propres branches, avec pour épitaphe, la plaie béante à fleur de souche.
Dans les suaires de Laurent Dubois, Michel Diaz découvre non seulement le corps meurtri des arbres, mais tout ce dont ce corps est porteur: la terre où il s’ancre, l’eau qu’il aspire depuis les gouttes, flaques ou mares jusqu’aux mers et aux océans, et le ciel que vont habiter ses branches. On entre dans le bleu, dit-il, comme on confie sa voix au vent. Dans l’image de l’arbre livré au fer de l’abattage, dans les œuvres de Laurent Dubois, il reconnaît cet espace où s’exorbite la pensée, vers l’infini du bleu où elle s’enfonce en nageant, un édifice mouvant bâti sur un abîme, (…) qui nous lave de l’effroi risible du silence, et où se joue l’énigme insondable de notre propre vie.
*
Images et textes sont ici liés comme on le voit rarement, dans la lenteur, la précaution ou la suspension.
Ils proposent une double méditation sur notre présence au monde: éphémère dans sa réalité physique, défiant ou méprisant le temps quand montent le bleu et le chant. C’est ce mépris du temps que je dis « lenteur ».
Lenteur végétale, lenteur dans l’arbre, lenteur du photographe, lenteur de l’écrivain dans sa marche; le monde est à son premier jour. Chacun d’eux sait lire l’arbre en son suaire: le temps accumulé dans ses veines, ses stries, l’alternance des années, la ponctuation des saisons, les coups de sécheresse, et les montées de l’eau. Cette lenteur musicale qui se fait langue, comme un défroissé de silence. Les tremblements du bleu nous donnent à voir ce qui nous avait d’abord échappé.
Le duo est harmonique, organique, nécessaire. Et de cet arbre corps, rendu par l’artiste dans sa douleur de corps, le poète fait voix du corps sentant et souffrant, corps humain qui dans le bleu cherche l’apaisement. Sous ce double regard, l’arbre connaît métamorphoses et renaissances, d’où l’on en tire grands secrets, d’épiphaniques rumeurs de nuages.
L’arbre-homme devient poète et musicien, et si l’on tend l’oreille, comme le font l’artiste et le poète, on discerne le furtif staccato de son pouls, l’adagio ample de son souffle, dans l’air bleu comme l’eau d’un lac de montagne où passe l’ombre d’un oiseau et l’on renonce à sa pesanteur comme on entre dans la prière adressée non à un dieu mais à l’esprit végétal qui désormais palpite au cœur du bleu, l’arbre transfiguré.
*
Aussitôt que l’idée de déluge se fut rassise,
Un lièvre s’arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l’arc en ciel à travers la toile de l’araignée.
Pourquoi ce début des Illuminations m’accompagne-t-il chaque fois que j’ouvre ce livre ? Souvenir des enluminures, tant images et textes s’enluminent mutuellement. Pour cette impression de lumière qui en émane… Ça pourrait n’être que désolation de forêt saccagée et c’est Parole. Dialogue de vivants. Parole par delà la douleur et la mort. Prière d’après le déluge, « née de la déchirure » qui nous installe dans l’indolore d’un instant sans fêlure qui ne doit jamais s’achever.
Raphaël Monticelli
Né à Nice en 1948, Raphaêl Monticelli est écrivain et critique d’art. Son travail littéraire, construit autour de la notion de « bribes », s’est constamment nourri de ses relations avec les artistes. Critique d’art, il a défendu le travail des avant-gardes des années 60, avant de développer « une critique en sympathie » qui l’a conduit à faire œuvres communes avec de nombreux artistes.
R. Monticelli a publié de nombreux textes, chez plusieurs éditeurs, dont ses Bribes et des textes poétiques aux éditions L’Amourier et d’autres à La Passe du vent.