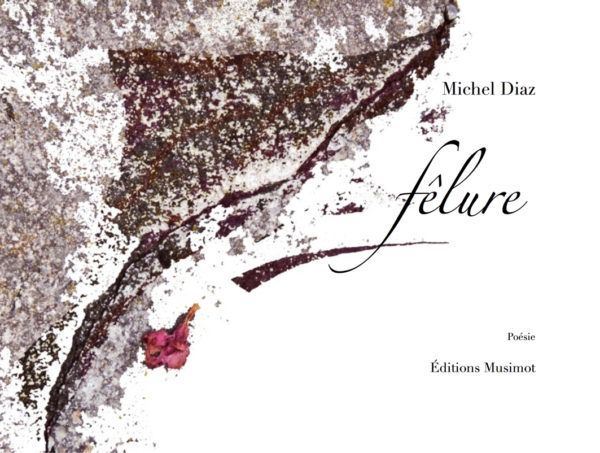
Chronique publiée sur le site des éditions Musimot (janv. 2017)
FÊLURE, lu par Claire Dethomas-Demange
C’est si beau, c’est si vrai…
Sur le site de Michel Diaz, on lit que son travail d’écriture est conduit par « le désir de trouer cette « part d’inconnu » qui s’ouvre devant soi, d’explorer l’être humain au plus intime de lui-même, ses aspects les plus ténébreux, tout en gardant les yeux ouverts sans s’embarrasser de s’enfoncer parfois dans des impasses ».
Son dernier recueil Fêlure nous raconte cette exploration. Ou plus précisément comme le suggère l’épigraphe :
« Le chemin pris parmi Choisi ? Consenti plutôt. Vertige de cela
Vertige
Que mourir apaisera. »
Alain Guillard
Le ton et la trame sont donnés. Nous comprenons qu’il n’y aura pas de choix à faire.
D’abord parce que ce chemin commence un 21 décembre, à l’orée de l’hiver, et dans la solitude. Le poète-narrareur écrit : « Ces longs flocons qui tombent, je suis seul à pouvoir les entendre », sans la dispersion qu’un autre pourrait apporter. Le chemin sera froid et blanc. On en pressent l’opacité, pré-figurative d’impasse.
Aussi parce que l’alternative est un pari impossible, qui tiendrait du miracle : le 5 janvier, on peut lire : « Pour se sentir vivant, il faudrait convoquer ce miracle : être là, sans parole, pas trop en avant de soi et pas trop en arrière non plus,mais juste en équilibre sur la ligne de crête du souffle […] Libre de toute attente et de toute désespérance ». Même ce qui pourrait rassurer et freiner la descente vers le vide — le bol de café fumant qui « restitue au monde ce foyer de chaleur dont le cœur toujours s’alimente » et brûle les deux paumes qui l’enserrent lit-on le 5 janvier — participe et contribue à la douleur d’être.
Ce cheminement est donc aride et au fil du temps qui passe, du début de l’hiver, le 21 décembre jusque au début du printemps, le 26 mars, tout espoir se consume. Le 11 mars le poète constate : « on ne peut avancer qu’en brûlant ce que l’on a jadis aimé, qu’en détruisant, l’un après l’autre, ses anciens visages ». Mais il n’y aura pas la possibilité d’un nouveau visage, car au tout début du printemps, le 26 mars le narrateur écrit : « Ce sera l’un de ces jours tristes où le crépuscule sera sans visage » où il regardera « le sang glisser sur (ses) poignets pour inonder (ses) paumes […] Sang qui n’est que le prix de la cendre ». Un sang qui n’est pas sève, sang sans vie, sans printemps. Pourtant le poète espérait le 25 mars « qu’enfin s’ouvre une porte ».
Ironie d’un printemps où la vie s’enfuira lentement par la bouche du lavabo.
Il ne s’agit pas d’une tragédie car la mort était attendue, inévitable. Le 11 mars, le poète dit clairement : « je ne suis que nuit pour moi-même » et s’il avance ce n’est que selon la logique de «l’Ange de la Mort », toujours dans la douleur, « sur la roue de souffrance » — 25 mars —, « dans la douleur d’être » — 2 février —, toujours sur la corde raide « en danseur de corde, au-dessus de l’abîme et d’un centre vertigineux ».
Il n’y a donc pas de choix à faire. La fêlure est trop profonde, avec son corollaire le doute «s’insinuant profond pour me persécuter ». Elle est trop enkystée. Enfant déjà, le poète était «serré contre les bouées noires de l’angoisse ». La fêlure déjà le submergeait, devenait « liquide visqueux l’emprisonnant comme un oiseau mort », préfigurant l’adulte lui aussi « blotti dans le silence et recroquevillé » cédant à la nuit qui ira s’épaississant, prolongeant la métaphore du liquide visqueux. La seule issue possible étant bien celle du sang, de la vie s’enfuyant par la bouche du lavabo. Il y aura alors enfin possibilité de fluidité. Le sang, la vie vont glisser hors de lui, libération ultime. Avec cela en plus : cette prise de conscience lorsque on abandonne ce qui nous interpelle encore.
Michel Diaz saisit ce moment précis où la vie s’enfuit avec une précision et une finesse d’écriture fulgurante et romantique à la fois. 21 mars : « Je la regarderai glisser […] avec l’intérêt que l’on porte, quand on a perdu l’usage des mots, à ce qui, sur le bord des lèvres, réclame encore qu’on le nomme. Seulement déchiré par ce sentiment de légèreté que nous donne ce qui nous quitte». Le balancement de ces deux phrases repose sur la subtile évocation du paradoxe psychologique au cœur de nos vies et de nous- mêmes : le désir d’un au-delà malheureusement inconcevable dans le hic et nunc. Cette évocation sera sublimée par la formulation délicate et exquise consacrée au moment précis de l’adieu à la vie : « En cette heure qui sonne, où le pas fait défaut sous les jambes et où toute fleur s’abandonne. Où l’amour même au revers de toute lumière, a fini, sans regret, d’effeuiller les pétales de sa dernière lampe ».
C’est beau à en pleurer et si ce cheminement dans la désespérance conduit irrémédiablement à la mort, s’il est inévitable pour l’auteur de « renoncer à avancer, ici, sous le ciel nu », l’écriture du recueil est empreinte d’une telle intensité d’émotion et de réflexion,— « Quel Dédale a conçu cet espace où veille un Minotaure qui ne trouve jamais le sommeil » 8 février —, d’une telle inébranlable lucidité — « Et toujours au fond de l’orchestre, on entend les mâchoires qui mastiquent la partition, les dents qui mordent dans la chair des heures » 8 février —, d’un tel respect pour la nature et paradoxalement pour la vie tout court, le 2 janvier l’auteur met en exergue le miracle de la nature —, que le lecteur refuse d’admettre la fêlure et voudrait retenir la nuit. C’est si beau, c’est si vrai, si logique que cela en est inacceptable… et que l’on voudrait crier au poète, pour le convaincre de ne pas nous quitter, de passer du conditionnel au futur et d’affirmer : « Il voudra vivre simplement, comme un soir de septembre, quand il vente dehors et qu’on entend les fruits tomber dans l’herbe. »
Mais cela est impossible.
J’ai reçu la vie comme une blessure et j’ai défendu au suicide de guérir la cicatrice ». Lautréamont
Claire Desthomas Demange
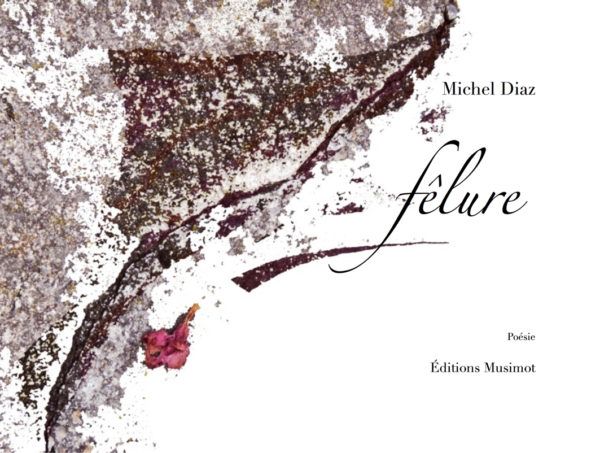
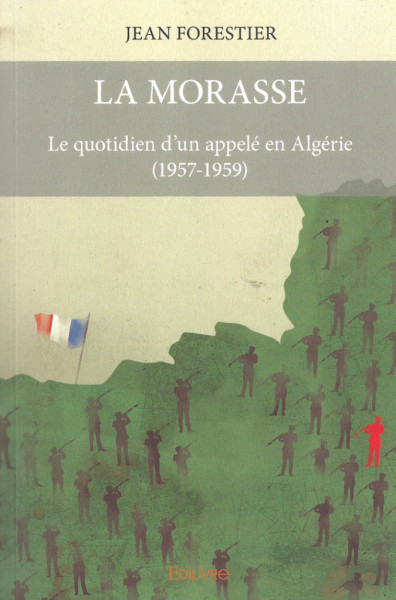 LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959)
LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959)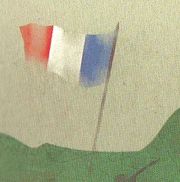 Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ».
Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ». Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne.
Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne. Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace.
Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace. Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre.
Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre. Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. »
Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. »
 10 janvier
10 janvier 4 février
4 février 5 mars
5 mars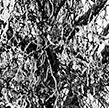 11 mars
11 mars 14 mars
14 mars 25 mars
25 mars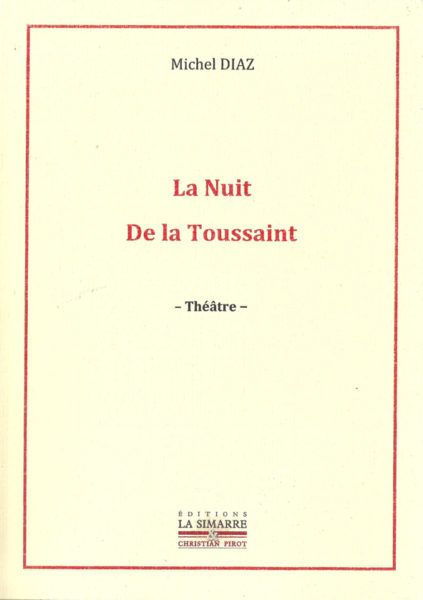 La Nuit de la Toussaint
La Nuit de la Toussaint