
Texte publié dans L’Iresuthe N° 26, janvier 2013.
DERNIERES NOUVELLES DU PRINTEMPS
« A chacun de nos rêves, nous
faisons avancer l’humanité.«
Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle
« On dit qu’il va partir… qu’il ne partira pas… qu’il est déjà parti… » C’est bien ce que l’on se disait chez les commerçants du village, les rares qui restaient (ou autour du souper familial), ce qui, dans les rumeurs de l’actualité, son roulis incessant de cailloux, ne faisait guère plus de bruit qu’un simple bruissement de feuilles.
Cette traversée serait la dernière. Une traversée sans retour. Qu’il avait patiemment préparée, une fois qu’il eut décidé de ne pas revenir en arrière. Résolu maintenant à ne plus s’attarder, de même qu’on franchit un pont qui mène jusqu’à l’autre rive, sans consoler ni regretter celle qu’on abandonne, ni se retourner pour la regarder une dernière fois par dessus son épaule.
Il pleut depuis des jours… des semaines peut-être…
Dès la moindre éclaircie (qui ne dure jamais très longtemps), on entend s’ébrouer le silence, qui s’égoutte et se lisse aux rayons du soleil. Alors, à une imperceptible vibration de l’air et aux palpitations de la lumière, tremblant au bord de la paupière comme un éclat de vitre, on sent que le printemps arrive. Qu’il est là, frais encore, mais obstiné à frayer son chemin dans les veines du monde.
Il est encore tôt, en ce matin de mars. La pluie accorde son répit aux premières heures du jour. L’homme, le philosophe, habite la maison dont il vient de descendre le seuil, située en retrait de la route et protégée à peine des regards par une mince haie de ronces mêlées de noisetiers. Il marche sur la route d’Aléria, qui mène vers la mer, tandis que le soleil, agacé de nuages, se hisse dans le ciel. Voilà bientôt un an qu’il a passé la mer, dit adieu à l’autre maison, celle du continent. La maison où il a vécu, pendant des décennies, face aux montagnes et au verger qu’il avait lui-même planté. Le Sage dit que l’on ne doit jamais quitter un lieu où l’on a pris la peine de planter des arbres. Lui pourtant a passé la mer, n’emportant de sa vieille demeure, de sa vaste bibliothèque, qu’une pile de livres, seulement quelques-uns, mais aussi nécessaires à sa méditation qu’est le vol d’un oiseau à l’ardoise du ciel.
Il marche sur la route d’Aléria. Dans l’une de ses poches, un petit calepin qui lui sert à prendre des notes, et dans une autre un livre, Les Essais de Montaigne. Si on lui demandait pourquoi ce livre-là, il répondrait au questionneur, en lui souriant malicieusement, que son auteur est le seul homme auquel il n’hésiterait pas à demander sa route s’il lui arrivait d’aventure de s’égarer sur un improbable chemin.
… Marie avait tenté, d’abord, des études de médecine. Elle se voyait bien en chirurgien-anesthésiste. Manière de ne pas se dérober aux souffrances humaines, des les empoigner à mains presque nues, dans l’espérance de les soulager peut-être. Elle ne savait trop que penser de la mort. Elle y avait été maintes fois confrontée. Comme à celle de ses parents. Ou de ces inconnus que l’on amenait de la morgue en salle d’autopsie. Elle la constatait, mais sans jamais pouvoir toucher ce qui en faisait la nature, et elle la trouvait étrange. Aussi étrange et incompréhensible que le ululement d’une chouette dans la nuit des bois, ou que le battement de son cœur même, ou la déflagration soudaine de l’amour. Pourquoi la vie était, et pourquoi n’était-elle plus ? Pourquoi ne restait-il qu’un nom de ce qui avait existé ? Qui aurait pu lui dire quelque chose de sérieux (c’est-à-dire de vérifiable) concernant la vie et la mort ? Et en quoi surtout elles sont distinctes ?…
Puis, n’étant plus tout à fait sûre de vouloir embrasser cette carrière (mais n’ayant pas, en vérité, la patience d’attendre le terme de sa formation), elle a fébrilement corrigé son destin. Et, un diplôme d’infirmière en poche, s’est jetée dans l’humanitaire.
Un an plus tôt (mais c’est déjà aussi une autre vie), le philosophe a dit adieu à sa vieille demeure, mis deux ou trois valises dans le coffre de sa Clio, et s’est embarqué à Marseille, par un beau jour d’avril. Après une existence consacrée à l’étude, et dans la compagnie des philosophes qu’on appelle « Présocratiques », ou encore « Sophistes », il lui fallait se rapprocher des Grecs. Davantage encore. Plus près.
… A cette époque-là, depuis un certain temps déjà, Marie avait rompu avec la vie et les années qui l’avaient vue donner ses forces sans compter. Une vie professionnelle très dense dans le secours aux autres, chargée comme une barque sur le point, toujours, de trop s’incliner à fleur d’eau et de se retourner. Dense mais éprouvante à se confronter constamment aux malheurs et misères, à porter le poids de la compassion et de la révolte impuissante. Vie qui l’avait menée dans les contrées les plus cruelles et les plus éprouvées du monde, en Angola et au Tadjiskistan, en Géorgie et en Anatolie, en Bosnie et au Kosovo, puis au Bengladesh et en Inde. Qui lui avait lancé en pleine face les désastres du monde et l’odeur des massacres. Qui l’avait aussi ballottée, comme une bouée dérivante sur le ressaut des vagues.
C’est en Inde qu’elle a découvert la grande poésie persane de Rûmî, et ce chemin spirituel qui mène de l’Orient jusqu’aux portes de l’Occident, dans l’espace ébloui de la Grèce. Celle des dieux et des aèdes, et des penseurs anciens qui ont légué aux hommes le fruit rare de leur esprit.
C’est après avoir dit adieu à sa maison, à ces murs et aux lieux où il avait passé des décennies et planté son verger, qu’il est parti enfin, n’emportant avec lui que le strict nécessaire. Les Essais de Montaigne. Mais Héraclite aussi, bien sûr, Parménide et Anaximandre…
… Une fois revenue en France, Marie a décidé de tout abandonner. De s’éloigner des catastrophes et des ravages de la pauvreté. Non pour les oublier, mais pour se risquer à tenter l’aventure d’un autre chemin. Elle a cherché alors un lieu selon son âme, un lieu qui la rapprocherait d’Homère… Et jeté d’abord son ancre à Corte, où, tout en choisissant de vivre de petits boulots auprès des paysans et des bergers, elle s’inscrit à l’université et suit des cours de grec ancien.
Elle sait qu’elle vient d’ailleurs. Même si, aujourd’hui, après avoir vécu autant d’années, ici et là, dans tous ces coins du monde, elle sait bien « qu’ailleurs » ça ne veut plus dire grand chose. Que c’est « là-bas » où l’on n’est plus. Partout encore où l’on n’est pas, et même ici, une fois qu’on en sera parti. Or c’est « ici » qu’elle veut désormais enfoncer ses moignons de racines. Pour éviter que son futur et ses penchants à tout donner se perdent à force dans le « nulle part ».
Elle est encore jeune (trente six ans à peine). Elle a, croit-elle, été une bonne fille pour ses parents. Aimante et généreuse, mais volontiers rebelle. En tout cas ne s’est jamais vue dans la peau d’une épouse. Elle sait bien aussi que des gens l’ont aimée, « ailleurs », d’où elle vient, qu’elle a laissés tomber, des hommes qu’elle aussi a sûrement aimés, et qui ne savent même plus où elle est aujourd’hui.
Non, il ne s’agit pas, pour ce philosophe de la nature, on s’en douterait bien, d’une simple affaire de paysage, de climat, de clarté de l’air. Ou il ne s’agit pas que de cela. Il a emménagé dans un modeste pavillon, juste à la sortie d’Aléria, sur la route qui mène à la mer. Un petit pavillon sans attraits… du moins pour les touristes et les vacanciers en quête de coins pittoresques. La région d’Aléria n’a rien, non plus, de la force et de la beauté que tant de paysages corses revendiquent si hautement. Mais nul besoin pour lui que le maquis sente les romarins en fleurs, les bruyères, les myrtes et les cistes, que l’aurore soit rose sur les monts de Corte, ni la mer transparente comme l’azur du ciel et les nuits plus luisantes d’étoiles, pour penser avec Héraclite l’absolu du monde immédiat et de « la Nature infinie ». Et assez se désole-t-il que nous ne soyons « plus capables de retrouver ce qu’était la vie grecque » et que nous ayons perdu le sens du sacré.
Il se contente d’être là où il sait, désormais, qu’il finira ses jours.
… Malgré ses maigres revenus, mais avec un petit pécule, elle a pu acheter un terrain (s’endettant pour longtemps), pas loin du pavillon où habite le philosophe. Un terrain sur lequel se dresse une bicoque, une ancienne maison de berger, laissée à l’abandon, où il n’y a ni eau courante ni électricité. C’est sur ce terrain-là qu’elle a planté des oliviers, aligné quelques ruches, bâtira sa maison. De ses mains. La tâche ne lui fait pas peur. Elle fera creuser les fondations, couler la dalle de béton, apprendra à monter des murs, à fabriquer une charpente, à la couvrir de tuiles, à poser portes et fenêtres, et ne s’éclairera qu’avec la complicité du soleil, ou celle des bougies et des lampes à pétrole. Et cela prendra le temps qu’il faudra.
Marie n’est pas pressée. Elle ne veut rien d’autre qu’accorder son existence au pas du vagabond qui rêve d’échapper à la tyrannie de l’utile et ne se fixe d’autre tâche que celle d’arpenter la vie, lentement, en en contemplant les mille nuances, et regarder pousser ses arbres, travailler ses abeilles.
Il marche sur la route, laisse derrière lui les dernières maisons. Puis part à travers champs vers les étangs, sur des chemins qui le connaissent bien. Il s’arrête, de temps à autre, griffonne quelques mots sur son petit carnet.
Lui qui, depuis toujours, préfère la recherche de la vérité à celle du bonheur, et la métaphysique à la quête de la sagesse (mais la métaphysique envisagée comme une libre création de la raison), il note, par exemple, d’une écriture hâtive : « Qu’est-ce qu’un philosophe de l’incroyance ?… » Et il écrit aussi, déjà pressé de repartir, de n’accorder à sa pensée aucun temps de repos : « Peut-être celui qui s’avance au bord des gouffres de l’incertitude de l’être, ce chemin en à-pic où l’on côtoie les religions… » Puis il s’arrête un peu loin, pour ajouter : « Dieu n’est pas un problème philosophique, puisque son existence ou sa non-existence ne changent rien au fait que nous savons bien comment vivre… c’est-à-dire selon l’amour ».
… Elle suit donc, à l’Université, des cours de grec ancien. Des cours qui la déçoivent. Et un jour est tombée sur l’un de ses ouvrages. A la bibliothèque de l’Université, où elle était venue lire les lettres d’Epicure à Hérodote, Pythoclès et Ménécée. Entrant ainsi, sans le savoir, dans ce cénacle de lecteurs, une manière de famille qui le considère secrètement comme l’un des plus grands philosophes du temps présent… Peut-être le plus grand… C’est, en tout cas, ce qu’elle pense. Et peut-être n’a-t-elle pas tort…
Il a, depuis ce jour déjà lointain, où il découvert Les Essais de Montaigne, pris le parti de l’ignorance inéluctable, qui est le propre de la condition humaine. Parce qu’il sait que, sous les lumières de la raison, aucune certitude ni proposition métaphysique n’est absolument indiscutable.
C’est pourquoi, à Descartes ou Kant, penseurs « qui ont usé de leur raison pour la mettre au service de ce que leur foi leur dictait », et à tout autre justificateur de Dieu, il préfère la compagnie des Antésocratiques, Héraclite et Anaximandre, Parmédide, Empédocle, Démocrite, Zénon d’Elée, vrais philosophes, selon lui, « qui n’ont pas eu à rompre le carcan des dogmes et des idéologies », mais qui ont seulement observé la nature et « éprouvé pour la première fois la liberté de la raison devant les choses ».
Quand il décide de ne pas aller plus loin, il s’arrête et s’assied. Sur un tas de cailloux, un tronc d’arbre couché. Il sort le livre de sa poche, lit quelques phrases de Montaigne, au hasard de ses pages, comme on s’arrête regarder les détails d’une fleur ou écouter le bruissement du vent dans les feuillages. Ou bien, les yeux mi-clos, il pense aux vagues de la mer qui, une à une, arrivent là-bas, sur la grève. Il fait entrer en lui tout l’espace du ciel, qui coule au fond de lui comme une eau de fontaine. Petite silhouette, immobile au bord du chemin. De loin, on se sait s’il médite, s’il dort, ou s’il est venu là pour mourir.
… Voilà donc qu’elle tombe, un beau jour, par hasard, venue lire Epicure, sur sa traduction des fragments d’Héraclite et les commentaires qu’il en a faits. Celui qui marche sur la route d’Aléria, et qui mène à la mer. Et aussitôt, elle pressent que seul cet homme-là pourra la faire entrer dans la pensée des Grecs et dans la sensation vivante de leur monde.
Après sa promenade matinale, quotidienne (et quel que soit le temps), le philosophe rentrera chez lui, ce si modeste pavillon, pour aller s’enfermer dans son petit bureau, devant une fenêtre qui ouvre sur les champs, de l’autre côté de la route. Le ciel surabondant, et la lumière, s’y invitent souvent, libérant un peu plus son esprit et sa main. Et chaque jour, jusqu’à midi, il s’occupe à relire ses notes et écrit sur de grands cahiers, les remplissant d’une écriture fine et claire, presque sans repentirs, dans un style parfait qui ne se paie jamais de mots. Heures lentes accordées aux pulsations mêmes du temps. Qui dérivent du même silence. Il ne se pose pas, dans ces moments, la question de la trahison de la langue. Il voit les choses, les mots suivent, tout simplement. Il connaît leur insuffisance, s’en méfie sans la redouter. Le langage n’est fait, selon lui, que pour nous parler du réel. Il écrit donc, de même qu’on avance dans l’amour de la lumière, en suivant une flamme droite, simple et précise comme celle d’une chandelle. Depuis plusieurs années, tel Montaigne, dans ses Essais, il compose ainsi un journal qu’il a intitulé « Hier déjà, et encore demain », dont il a publié déjà trois ou quatre volumes. Ni chronologique ni thématique (mais composé à sauts et à gambades), il forme comme le pendant de son œuvre savante et continue de l’éclairer de ces réflexions vagabondes.
Mais peut-être que cette histoire pouvait commencer autrement…
… Il pleuvait depuis des semaines… L’automne n’en finissait pas.
A l’abri de son parapluie, mais pieds nus dans ses charentaises et vêtu de sa robe de chambre, il se décida à sortir. Silhouette cassée au pas traînant sur le gravier (à cause d’un vieux lumbago qui réapparaissait de temps à autre et le faisait cruellement souffrir), Marcelin traversa le petit jardin qui le séparait de la rue, ouvrit la boîte à lettres et en extirpa le courrier qui s’accumulait depuis quelques jours. Il avait scotché sur la boîte un papier qui avertissait, en lettres majuscules tracées au marqueur rouge : Pas de publicité. Aussi ne tira-t-il de ce cube de tôle que deux ou trois journaux, une grande enveloppe et un paquet de lettres sur lesquelles il négligea de jeter le moindre coup d’œil. Ses reins lui faisaient bien trop mal pour qu’il prît seulement la peine de regarder qui lui avait écrit.
Puis il revint vers la maison, bonhomme de quatre-vingts ans, du même pas traînant et laborieux, déjà trempé de pluie.
… En écrivant sa lettre, elle a pleuré. Pas de chagrin, ni de douleur. Mais juste parce qu’elle pensait qu’il pourrait ne jamais venir, et que s’il acceptait de la rejoindre, elle resterait près de lui aussi longtemps qu’il le faudrait… Même si on sait que « longtemps » ce n’est jamais l’éternité. Elle a pleuré aussi, sachant que les larmes la laveraient, jusqu’au fond d’elle-même, et une fois pour toutes, de sa possible déception ou du lent poison de l’attente.
Marcelin s’était alité, pendant presque trois jours, ne pouvant presque plus bouger, et ne s’était levé, pendant tout ce temps-là, avec beaucoup d’efforts et mille précautions, que pour aller au petit coin et se faire chauffer un potage. Il avait certes ingurgité, pour tenter d’apaiser sa douleur, une quantité assez appréciable de cachets d’aspirine, mais il aurait bien supporté (malgré son caractère d’ours et sa vocation à la solitude) qu’une main charitable acceptât de masser ses reins et appliquât sur ses lombaires une crème décontractante.
… Marie est attentive à l’opéra du monde, avide d’en nourrir ses sens, comme le font les vrais poètes, et à en célébrer la splendeur matérielle. Elle, qui n’a jamais écrit le moindre vers. Mais mystique, elle l’est aussi, à coup sûr, comme le sont toujours les poètes les plus inspirés. Elle n’en est pas moins (elle nous dirait « d’autant plus ») les deux pieds dans la vie. Aimant, souffrant et travaillant. Comme un être de chair ordinaire. Commune des mortelles parmi le commun des vivants. N’était cette lumière qui l’habite.
D’ailleurs la poésie, pour elle, avant d’être dans la manière dont on pétrit la langue, est d’abord une certaine façon de regarder le monde, d’envisager les jours, d’orienter sa vie, de la tourner vers ce que l’apparence ordinaire des choses recèle d’essentiel. Au-delà aussi du visible.
Comme elle l’est encore dans l’attention têtue qu’elle met à surveiller ses ruches, à tailler ses rosiers, dans la lente houle des draps qui sèchent sur la corde à linge, ou la voix des crapauds qui coassent, la nuit, dans les herbes, en bas de sa fenêtre.
Marcelin Baudelot était un universitaire à la retraite. Depuis près de quinze ans. Professeur émérite de la Sorbonne, il avait adoré exercer son métier, partager ses passions, transmettre son savoir, le plus longtemps possible, jusqu’à ce qu’on lui signifiât qu’il ne pouvait pas aller au-delà de la limite d’âge. Il ne s’éloignait guère désormais de la vieille demeure où il vivait depuis des décennies, dans ce village du Jura, face à la montagne et aux arbres fruitiers qu’il avait lui-même plantés.
Parlant d’elle, le philosophe aurait dit volontiers : « Son dieu n’est pas du tout transcendant. Il est comme l’aspect divin de la nature. En cela, elle est plus grecque que moi, puisqu’elle ressent comme les Grecs le divin dans les éléments, la lumière, les plantes et les animaux. La vie est un don, sous toutes ses formes. Elle a élu un terrain qu’elle plante d’oliviers et où elle veut construire sa maison. »
Marcelin Baudelot vivait seul, et presque retiré de tout. Il ne se mêlait pas à la vie du village (ne s’y était vraiment jamais mêlé) et se contentait de sortir pour se rendre à la supérette acheter de quoi se nourrir, ou rapporter son pain de la boulangerie, ou s’en aller marcher, solide encore, sur les chemins de terre qui se perdent dans la campagne. Il avait été marié, le couple n’avait jamais eu d’enfants, et c’est dans ce village jurassien qu’il avait enterré sa femme, quelque dix ans plus tôt, son indéfectible compagne. Depuis ce temps, sa seule et propre compagnie paraissait lui suffire, et il demeurait là, vivant en presque ermite, ayant rompu tout lien avec ce qui lui restait de famille et avec ses anciens collègues. Il n’avait pourtant pas délaissé ses routes intellectuelles et étudiait toujours. Dans la patience et le retrait.
Parlant d’elle, le philosophe aurait encore dit : « Lorsque Marie soigne ses oliviers, s’occupe de ses ruches et s’active parmi ses abeilles, elle a l’impression d’accomplir un service divin. Elle appelle ce champ le « téméros », qui est pour les Grecs le lieu sacré. »
Le sacré, serait-ce donc cela qu’il est venu chercher ici ?… Et que, peut-être, il a trouvé ?…
Marcelin déposa le courrier sur la table, s’empara de la grande enveloppe et la décacheta. Il en tira une revue hebdomadaire consacrée aux programmes télévisés et à l’actualité culturelle (théâtre, livres, cinéma…). Il crut d’abord à une erreur. Il n’avait jamais eu de poste de télévision, et l’idée même d’en avoir ne l’avait jamais effleuré. Il se contentait d’un gros transistor qui lui permettait d’écouter les nouvelles et les émissions de France-Musique. Une lettre était insérée entre les pages du journal. Elle l’informait que le magazine lui avait fait l’hommage d’un article, signé par une journaliste, C. P… La suite de la lettre était écrite dans un français tourné au gré d’une inspiration aérienne, où chacun des mots ressemblait à un coquillage ramassé au bord de la mer. Des mots qu’une pensée sans fard semblait redécouvrir sous la patine de l’usage. Qui délivraient enfin un message ferme mais audacieux : « Venez donc vivre en Corse pour m’apprendre le grec ».
… Elle a pu acheter un terrain, pas loin du pavillon où habite le philosophe. Planté d’une bicoque, une ancienne maison de berger où il n’y a ni eau courante ni électricité. C’est sur ce terrain-là qu’elle construira sa maison. De ses mains. Cela prendra du temps, peut-être des années. Marie pourtant n’est pas pressée. Elle ne veut rien d’autre qu’accorder son existence au pas du vagabond qui rêve d’échapper à la tyrannie de l’utile et ne se fixe d’autre tâche que celle d’arpenter la vie, lentement, en regardant pousser ses arbres et vivre ses abeilles.
Elle est encore jeune (trente six ans à peine). Des hommes l’ont aimée, qu’elle aussi a aimés sûrement, et qui ne savent même plus où elle est aujourd’hui.
En écrivant sa lettre, elle a pleuré. Sachant aussi que les larmes la laveraient, jusqu’au fond d’elle-même, et une fois pour toutes, de sa possible déception ou du lent poison de l’attente.
Bouleversé par une aspiration si impérieuse, le philosophe mit cinq ans à se décider à larguer les amarres.
Cinq ans, cela paraîtra long, sans doute, concernant une décision qui en appelait à ses sentiments. Ou très court, au regard de ce que tout autre aurait considéré comme pure gageure.
D’autres lettres avaient suivi, nombreuses et réciproques, qui leur donnaient à déchiffrer, un peu plus chaque fois, dans la grande énigme qu’est « l’autre ».
Dans ce qu’elle avait à lui dire, Marie semblait brûler d’un feu perpétuel, voulant jeter sur tout comme une lumière implacable. Celle qu’elle a d’ailleurs au fond de son regard. Lui, qui pensait l’air de ce temps assez irrespirable, qui se désolait que la vie atteigne si peu les vivants, lui parlait de son amitié avec Epicure, mais aussi de l’incertitude, ce foyer rougeoyant au centre des esprits toujours en quête de la vérité. Les hommes, lui écrivait-il, n’aiment pas vivre dans l’incertitude, car ils ne saisissent ni la raison ni le sens de leur vie. Ce vide qui les fragilise les pousse alors à enfourcher les chimères qu’on leur propose. Et c’est ainsi qu’ils se retrouvent à portée des capteurs de conscience, car la confiance et non la méfiance est l’attitude primitive de l’esprit. Ce sont, lui disait-il, les cibles consentantes et privilégiées des religions, des sectes, des pseudosciences, des politiques sans hauteur de vue, des médias, des publicitaires, et des arnaqueurs de tout poil…
Cinq ans.
C’est cependant ce qu’il fallait de temps de réflexion pour cet esprit, enflammé mais déterminé, par éthique de philosophe, depuis toujours, pour choisir la raison contre le désir. Le temps aussi de se procurer les Rubâi’yât de Rûmî, la poésie de Ferdowsi, d’Attar, puis la Bhabavad-Gîta, puis, plus loin encore vers l’Orient, les philosophes taoïstes, jusqu’à s’user les yeux et se brûler l’intelligence à déchiffrer ces pages de chinois pour retraduire et commenter, de Lao-Tseu, le Ta-Tö-King, et enfin publier ses travaux. Le temps donc, si cruellement court et long tout à la fois, d’atteindre quatre-vingt cinq ans et d’oser enfin accueillir l’aventure à la hauteur où la lui proposait Marie.
Non pas une amitié admirative, et qui n’aurait été qu’aveugle, ni une passion amoureuse, qui les aurait contraints, mais le chemin de la vraie vie. Pas moins.
Un chemin où Marie avait pris sur lui déjà beaucoup d’avance.
Marcelin Baudelot retourne vers son pavillon. Il marche sur la route d’Aléria, qui va vers le Levant, jusqu’au bord de la mer.
Voilà bientôt un an qu’il s’est décidé à partir, qu’il a dit adieu à l’autre maison, celle du continent. La maison où il a vécu, pendant des décennies, face aux montagnes du Jura et au verger qu’il avait lui-même planté. Qu’il a passé la mer, n’emportant de sa vieille demeure du continent, de sa vaste bibliothèque, qu’une pile de livres, seulement quelques-uns, mais nécessaires à sa méditation. Il marche sur la route d’Aléria, en tenant dans ses mains son petit calepin dont il a noirci quelques pages.
Après la pluie nocturne, qui n’a cessé qu’au petit jour, le soleil lui paraît plus chaud qu’il n’est en vérité, plus éclatant aussi, malgré l’air vaporeux de ce matin de mars et la pluie qui, déjà, menace.
Il y a un an qu’il est là. Marcelin maintenant, a quatre-vingt six ans, et pour lui, désormais, le sacré a un nom. Valable pour lui seul. Tu au bord de ses lèvres. Mais qui a envahi la réalité sensible où il existe. Qui déborde au-delà. Pas le nom de la Corse, même si mieux qu’ailleurs on y trouve les traces de cette « Nature infinie », on y respire mieux l’odeur lourde et poivrée de la tragédie. Cette odeur de sang et d’encens mêlés. Mais celui de Marie.
Le sacré a les traits, désormais, d’une jeune femme brune, active, contemplative et lumineuse. Une jeune femme à la beauté grave, au corps souple et aux muscles durs, et dont le rire claque comme un coup de cravache sur l’échine des mauvais jours, de la tristesse et du malheur.
Il est depuis des mois au bras de son bonheur (il dirait plutôt de l’apaisement), comme au bras d’une épouse qui l’accompagnerait sur les chemins, dont la quiétude et la douceur le rassureraient sur la secrète appréhension d’une séparation qui n’aura jamais lieu. Il hésite à parler de sérénité, car il faut ce qu’il faut d’inquiétude à la vie, pense-t-il, pour conserver à son esprit les yeux et les oreilles de la sentinelle, et garder le cœur vigilant. Il sourit parfois en lui-même de l’espièglerie du destin qui a, d’un coup de dés, jeté dans son prénom les lettres contenues dans celui de Marie. Plus trois autres, C, L, N, dont il s’amuse encore à interpréter le message : « c’est elle, c’est Hélène », cette Hellène, fille de Léda et de Zeus, dont la beauté ne déclencha pas moins que la guerre de Troie.
Elle, qui ne ressemble à aucune des autres femmes qu’il a pu côtoyer, veille sur ses besoins avec un soin discret, des attentions d’amie, de grande sœur… ou d’amoureuse. Délicatement, elle l’aide à tourner la page de ces jours, lisant à ses côtés, et parfois par dessus son épaule, dans ce livre ouvert à ciel nu où la lumière du soleil, les arbres et les oiseaux leur parlent de l’éternité d’un monde qui n’en finit pas de les étonner.
Ils déjeunent parfois en plein air, au pied de la colline, sous un grand parasol, buvant à gorgées lentes un petit vin de Corse. Ecoutent en même temps, sur un lecteur C.D. à piles, des cantates de Bach, les sonates de Beethoven, ou un opéra de Mozart, s’amusant de la gravité qu’ils mettent à cette occupation et du sérieux avec lequel ils délivrent leurs commentaires.
Eperdus, ils le sont pourtant, chacun à sa manière. Chacun brûlant, au fond de lui, de son propre feu solitaire. Sans qu’aucun ne semble perdu cependant. Ayant acquis, chacun de son côté, la connaissance des désirs, partagés ou inassouvis, l’expérience de l’amitié et des âmes humaines, des choix sûrs et des voies incertaines.
Il a écrit dans son journal : « Avec toi, Marie, tout devient intense ». Et encore : « Pour devenir grec, c’est-à-dire pour philosopher vraiment, il faudrait avoir bénéficié d’une éducation où l’on ne vous a pas infligé les réponses avant même que vous vous soyez posé les questions : qu’est-ce que je fais là ? qu’est-ce qu’être vraiment ? pourquoi le monde existe-t-il ? qu’y a-t-il au-delà du monde ?… »
Au moment d’écrire ces phrases, lui est revenu en mémoire que son premier geste de philosophe fut la fugue qu’il avait faite quand il était encore un gamin de six ans. Ses parents étaient dans les champs, occupés à faucher un pré de regain. Il était parti sur la route, droit devant, sans regarder derrière lui, jusqu’à un grand tournant, là-bas, un peu plus loin, juste pour vérifier si la terre continuait. Il avait fait, quatre-vingts ans plus tard, une seconde fugue. Pour aller, cette fois, jusqu’au bout du chemin. Sur lequel l’attendait Marie.
Un chemin bien plus long que celui qu’avait parcouru le bambin qu’il était.
Puisqu’il a mis cinq ans à la rejoindre. Tellement plus, en vérité. Bien plus d’années encore que n’en mit Ulysse lui-même pour s’en revenir à Ithaque, et y retrouver Pénélope.
Il a pu constater, une fois encore, que la terre continuait, au-delà de la courbe de l’horizon, et que le vrai chemin n’est que celui du temps qui nous est accordé.
C’est ici, sur cette île, que Marcelin voudrait mourir. Et quand il le décidera. Avant que d’en subir l’implacable désir. Ou avant qu’Elle vienne rôder autour de sa maison, furtivement, avec des glapissements de chacal, escortée par les ombres de la faiblesse ou de la maladie. Il voudrait que Marie l’enterre au fond de son champ d’oliviers, au milieu des ruches qui bruissent de la vie appliquée des abeilles. Marie préfèrerait en haut de la colline, sur l’esplanade herbeuse où s’élèvera sa maison.
Il est à cet instant dans son bureau, celui de son modeste pavillon. Il travaille sur son journal qu’il a intitulé « Hier déjà, et encore demain ». Il retape le manuscrit du volume à venir sur une vieille Remington, modèle 1960. Il le complètera sur une autre machine, munie des caractères grecs dont il besoin pour les citations.
Quand Marie lui a suggéré qu’il pourrait s’équiper d’un ordinateur, et d’un traitement de texte adapté, il lui a répondu que l’idée n’était pas mauvaise. Qu’il avait encore pas mal à faire, n’en aurait peut-être jamais fini…
A dire vrai, à cet instant, mais cela restera entre vous et moi, il est en train de composer, en grec ancien, un poème d’amour aux accents éternels, qu’il n’osera jamais lui lire, par pudeur…
… et qu’il déchirera sans doute.
MD.
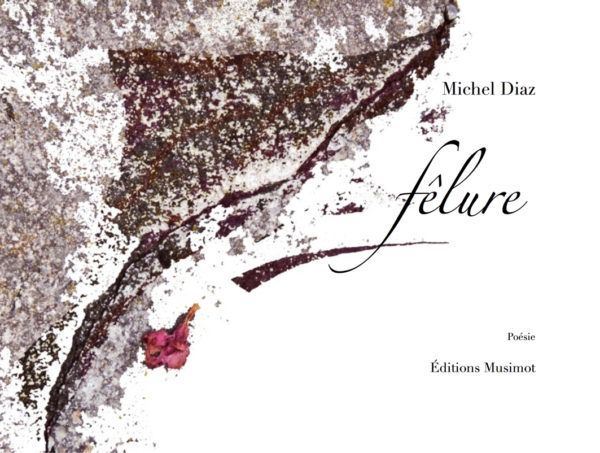

 Vient de paraître aux éditions de L’Ours Blanc, Le Cœur endurant de Michel Diaz
Vient de paraître aux éditions de L’Ours Blanc, Le Cœur endurant de Michel Diaz




