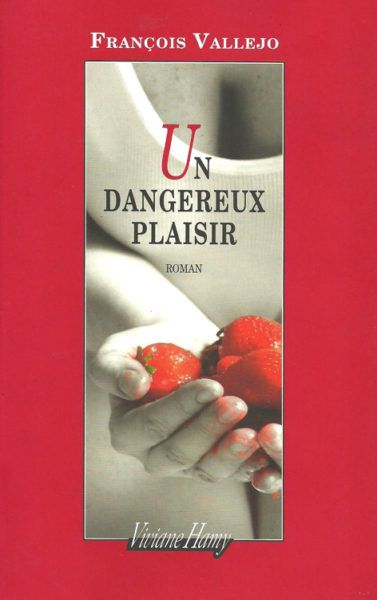 UN DANGEREUX PLAISIR
UN DANGEREUX PLAISIR
François Vallejo
Editions Viviane Hamy (2016)
Chronique publiée dans le numéro 40 de L’Iresuthe.
« En dépit de la nourriture infâme que ses parents lui imposent et qu’il rejette, Elie Elian s’attarde à l’arrière du restaurant qui vient de s’ouvrir dans leur quartier. Les gestes qu’il observe et les effluves qu’il inhale sont une révélation. La découverte des saveurs d’une tarte aux fraises offerte par une voisine achève de le décider: il sera cuisinier. Dans un premier temps, il offrira son inventivité aux oiseaux et aux errants avant d’oser proposer ses services dans divers établissements. Là, tout en récurant verres et casseroles, il ne cessera d’étudier et d’apprendre avec les yeux.
Mais à force de casser la vaisselle, Elie est renvoyé à la rue, où il côtoie des individus louches, prêts à tout pour s’en mettre plein la panse et qui tenteront de lui enseigner les principes de la grivèlerie. Sa première tentative dans un restaurant modeste lui vaudra la rencontre de sa vie: Jeanne Maudor, veuve d’un chef de qualité mort à la tâche, lui permettra de mettre en pratique ses recettes les plus folles tout en l’initiant à l’amour, la sensualité. Chassé une fois de plus, il renoue avec la vraie faim, jusqu’au jour où, au cœur d’un Paris en émeutes, il aboutira sur le seuil du restaurant Le Trapèze, dirigé par le couple Jaland… »
C’est par ce résumé, insuffisant à rendre compte du contenu foisonnant de ce roman, que l’éditrice nous présente le livre, et je n’essaierai pas d’en dire plus sur les péripéties, les rebondissements et les coups de théâtre qui le composent.
Ce livre nous raconte donc l’histoire d’un gamin mal nourri (et mal aimé aussi) qui, à force de persévérance, aidé souvent par le hasard et le concours parfois heureux de quelques circonstances, deviendra un chef réputé, un cuisinier hors pair, un esthète des casseroles. Serait-ce donc là un hommage à l’art de la cuisine ? Le récit d’une vie qui fait d’un rien-du-tout un artiste dans son métier ?
Il y a certes des recettes tout au long de ce livre. De blanquettes et de sautés de veau, de volailles farcies et de savants rôtis. Il y a, tout du long, l’évocation appétissante de viandes douces et rosées ou rouges et saignantes, de poissons aux « yeux globuleux », de parfums d’oignons rissolés, d’artichauts frottés à la truffe, de filets et pilons de chair tendre qui roussissent « dans une fumée crépitante », de légumes étincelants de toutes les couleurs. On y découpe, on y émince, on y trousse, on y barde, on y blanchit, écume, échaude, y gratine, y fricasse, y mitonne, on y fait mijoter, on y fait revenir. Il y a des effluves de sauces, des exhalaisons de saveurs, des efflorescences d’épices, des combinaisons surprenantes de textures et de goûts qui font tourner la tête. On y mange donc, on s’y régale, on y déguste, on s’y pourlèche, on y revient et on en redemande.
Et pourtant, malgré tout, l’essentiel du roman n’est pas là. Il est, en premier lieu, dans le rythme haletant d’un récit, proche du roman picaresque et que l’on pourrait encore ranger, au même titre, par exemple, que le Candide de Voltaire, dans le genre des romans d’initiation. Pas seulement initiation d’un tout jeune homme à l’art subtil de la cuisine, parcours d’un personnage qui ne vit que par et pour sa passion, pour l’assemblement inédit des divers ingrédients culinaires et l’ajustement savant des saveurs. Mais initiation avant tout, et surtout, à la vie, ce toboggan vertigineux qui, d’un confus et primitif chaos, d’une innocence seulement guidée par son instinct et ses obscures forces, finit par révéler, par l’apprentissage du bien et du mal, de la faim, de l’amour, des bonheurs et de leurs coups tordus, les nerveuses lignes de vie qu’on appelle un « destin ».
Et qu’est-ce que le destin ? Il est, selon les Grecs anciens, ce qui nous détermine, nous dépasse, fait de nous les jouets des dieux malicieux qui, se désennuyant à nos dépens, nous conduisent là où ils veulent.
On n’échappe pas aux décrets divins qui ont tout prévu à l’avance et tout calculé. Elie Elian n’a rien, dès sa naissance, pour être cuisinier, devenir un grand chef. La destinée qui l’attendrait, selon toute logique, ce serait celle de rester toute sa vie « un ventre creux », un errant affamé ou un petit escroc survivant de grivèlerie ou de petits boulots, condamné le reste du temps à faire les poubelles, à se nourrir des restes du repas des autres. On m’objectera que le personnage est doué, qu’en lui dort un talent, un bagage précieux qui ne demande qu’à s’épanouir, qu’il persiste en dépit de tout et s’obstine, s’acharne à s’arracher de lui ce qu’il pense être le meilleur. Que sa passion le tient aux tripes, que tout repose sur son caractère, son opiniâtreté, ses obsessions… Il y a tout cela chez ce personnage, mais, en vérité, si l’on accepte de me suivre sur ce terrain-là, on peut aussi bien croire que dans ce récit la volonté des dieux (que l’on pourra confondre avec celle du romancier) se joue du personnage, le maltraite, le manipule et en fait sa marionnette. Elie Elian se croit peut-être libre, mais il ne l’est pas plus qu’œdipe ne l’était de contrarier les « desseins supérieurs ». L’ironie de ces mêmes desseins est de faire naître le personnage Elie Elian dans cet espace familial, étroit et étouffant, hostile à toute véritable nourriture et même à tout bonheur, aussi humble fût-il. Et les calculs de ces desseins sont aussi de distribuer (comme distraitement) des « hasards » de rencontres qui trament le filet dans lequel le destin se resserre: des effluves qui le conduisent comme un chien famélique vers l’antre rougeoyant des arrière-cuisines d’un restaurant, une part de tarte aux fraises, aumône d’une voisine, un étrange ballet d’oiseaux suscité par ce crève-la-faim, un plat en sauce déposé, pendant son sommeil, par une anonyme (ou un ange) qui a pris le clochard en pitié, des émeutes urbaines qui lui ouvrent les portes du paradis… Tout, ici, fait signe et, au bout du compte, fait sens. Le puzzle dispose ses pièces et découvre à mesure ce que le personnage, par manque de recul et de discernement, aveugle sur ce qui se trame au-dessus de sa tête, est bien incapable de voir. Au mieux a-t-il l’intelligence d’en tirer le meilleur parti. Il n’empêche: « Il n’a jamais résolu la question de la jeune femme ou de l’ange qui l’a forcé à s’extraire de son trou pour se retrouver dans le quartier Montorgueil. Il aimerait croire qu’une sorte de destin l’a promené ce jour-là, l’a placé devant la porte des Jaland. » Il ne saurait penser plus juste qu’à cet instant-là; en effet, le destin le promène, mais depuis le début.
L’un des charmes de ce roman est de nous montrer, comme à ciel ouvert, la « cuisine » du romancier, celle d’une écriture qui poursuit son projet, feint de nous égarer pour mieux tirer son fil, tisser sa toile et construire sa mécanique. A sa manière, François Vallejo déconstruit la fiction à mesure qu’il la compose, nous prenant dans la chaîne de son récit, mené tambour battant, mais toujours se penchant par-dessus notre épaule pour nous rappeler qu’il demeure le seul maître du jeu, que cet emboîtement de circonstances, heureuses ou malheureuses, n’est que le produit, jouissif et jubilatoire, de ses inventions littéraires.
Je parlais, plus haut, de « destin », et de celui que suit Œdipe. Quitte, là encore, à interpréter ce qui n’entre pas dans les intentions de l’auteur, j’avancerai (dans une parenthèse) que notre Elie Elian-Œdipe tue en quelque sorte son père en acceptant d’abandonner le patronyme familial (puis en oubliant sa famille), et couche avec sa mère, ou en tout cas son substitut, la « mère nourricière », quand il se fourre dans les jupes de la veuve Maudor.
Mais ce qui fait encore l’intérêt de ce livre (et n’est pas éloigné de ce que j’écrivais plus haut), c’est qu’il est, avant tout, je crois, celui d’une quête du nom et de l’identité. Tout au long de ces 300 pages, le personnage ne cessera de chercher et d’interroger qui il est, ce qu’il veut, ce qu’il vaut, d’où il vient et où il veut aller, jusqu’où il peut aller. Quête du nom, d’identité, et quête existentielle qui nous fait dépasser largement le simple « récit d’aventure ».
La quête signifie, d’abord, que l’on recherche ce que l’on n’a pas, ou ce qu’on a perdu. Ou ce que l’on soupçonne qui peut être. Et tout commence dans cette famille où l’enfant, mal nourri et toujours affamé, chipote sur les plats immangeables qu’on lui impose. L’enfant ne sait pas ce qu’il veut mais, à coup sûr, sait ce qu’il ne veut pas. La première révélation, comme une épiphanie des sens, sera celle de ces odeurs qui l’attirent à la porte d’un restaurant. La seconde viendra de cette tarte aux fraises offerte par une inconnue (une autre incarnation de l’ange), grâce à laquelle Elie Elian éprouve « un coup de force de haut en bas, la tête farcie d’un mélange de rouge, de sirop, de granuleux, de duvet, de rond, de coulant, de glissant, et ça descend jusque là, sans s’arrêter. Il n’avait jamais associé le manger à une glissade sans fin… » Ce sont là les premières révélations de ce qui va ouvrir l’inconnu d’une voie qu’il ne cessera plus de questionner.
 Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.
Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.
Cependant, une fois son nom recouvré, comme le sentiment d’être enfin devenu lui-même, il sombrera encore dans les failles du doute, se demandant s’il est vraiment celui que l’on admire et dont le nom est devenu célèbre dans le milieu de la restauration. En effet, à A la fin du roman son identité sera encore menacée par Agathe Maudor, la fille de la veuve, qui s’acharnera à lui faire croire qu’il n’est pas qui il prétend être. Héros « sans feu ni lieu », même au plus fort de son succès, il ne sera pas loin, parfois, de se prendre lui-même pour un imposteur et de croire qu’il a usurpé un rôle. « Tu es David Audierne, je suis Agathe Audierne », lui martèle Agathe avec assurance et devant témoins Le voici marié, sans qu’il l’ait jamais su ! Et voici que deux autres comparses s’en mêlent, qu’il évacue d’autorité. « Un instant de déséquilibre, un éblouissement inhabituel, une suée… Il ne sait plus s’il est devenu le patron d’un grand restaurant grâce à ces deux imbéciles ou malgré eux. » Et sa prétendue femme, Agathe, d’insister: « Maintenant, tu sais. Tu ne veux pas perdre la face devant tes petits fidèles, je te comprends. Je reviendrai. » En faut-il davantage pour ne pas se sentir glisser sur la pente de la folie ? Qui suis-je ? se demande-t-il alors. Qui est ce « je » dont j’aurais pris la place, ce « il » qui n’est pas moi et dans lequel je ne sais pas me reconnaître ? « Il en vient à douter de lui, à accepter les arguments d’Agathe, à admettre qu’il ait pu signer un acte officiel avec elle, puis rompre son engagement et l’effacer de sa mémoire. » Chemin de croix de qui cherche, tout simplement, à habiter son nom, à devenir ce qu’il croit être, à être qui il est.
Il me semble que c’est cette quête, hésitante, parfois douloureuse, qui fait aussi le fond de cet ouvrage. Il pose la question de l’être, et de son rapport à soi et au monde, explore les difficultés qu’il y a à être soi-même et à le devenir. Nous rappelle qu’être est une aventure incertaine, et qu’on ne se connaît qu’au risque de se perdre dans cette nuit sans nom qu’est l’ignorance de soi-même et de celui que l’on n’aura jamais su être.
Quand ce n’est pas le cas, comme dans l’histoire d’Elie Elian, faut-il alors en remercier les dieux ?
Michel Diaz, 19/02/17
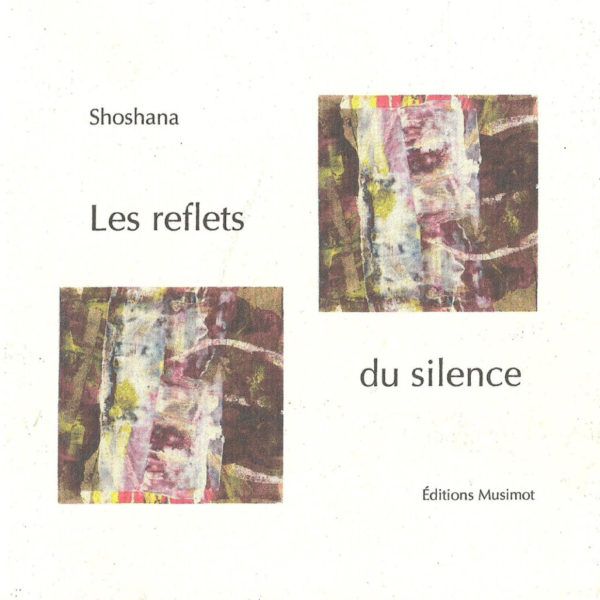 LES REFLETS DU SILENCE
LES REFLETS DU SILENCE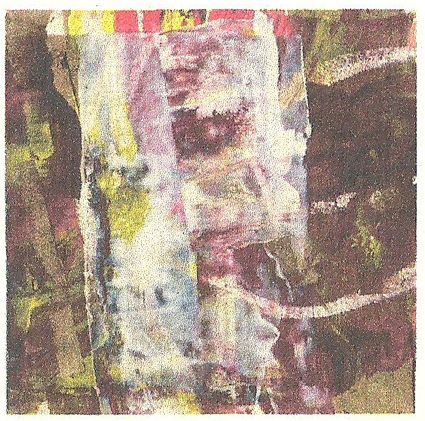 Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. »
Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. »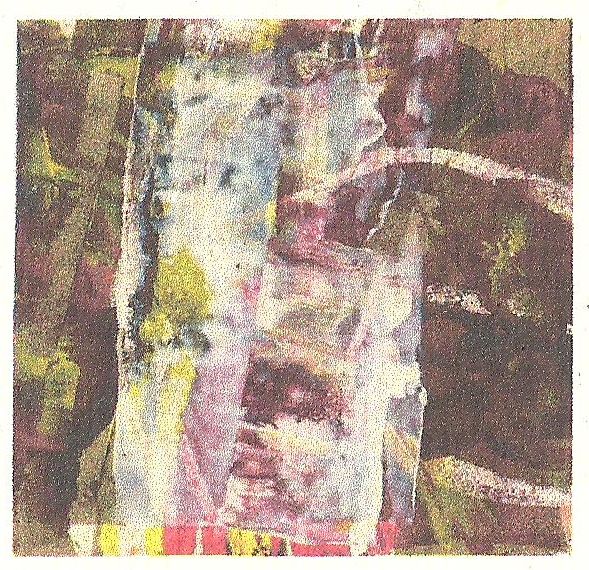 C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.
C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.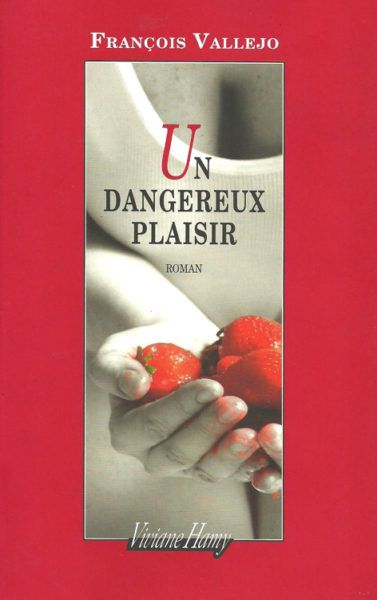 UN DANGEREUX PLAISIR
UN DANGEREUX PLAISIR Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.
Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.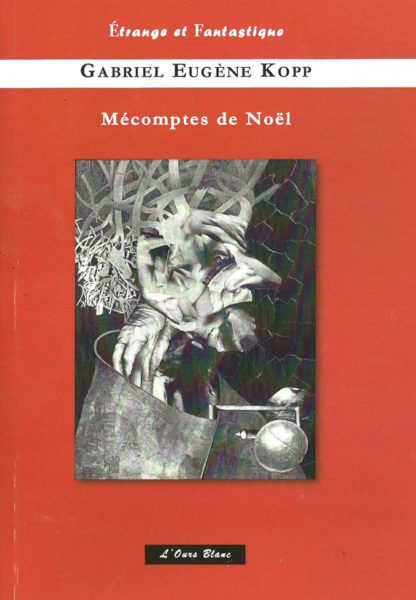 MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)
MÉCOMPTES DE NOËL – Gabriel Eugène Kopp – Editions de L’Ours Blanc (2016)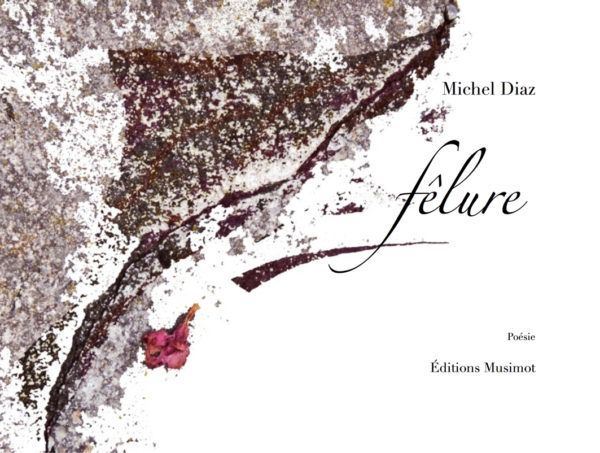

 Vient de paraître aux éditions de L’Ours Blanc, Le Cœur endurant de Michel Diaz
Vient de paraître aux éditions de L’Ours Blanc, Le Cœur endurant de Michel Diaz