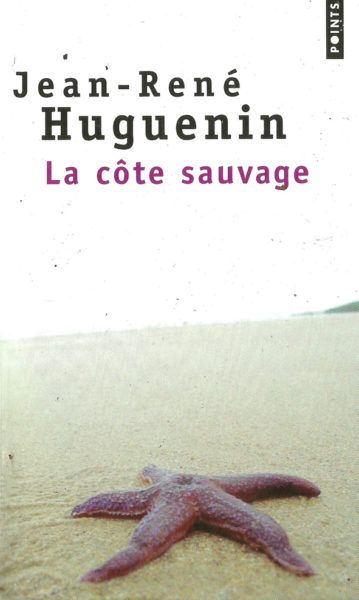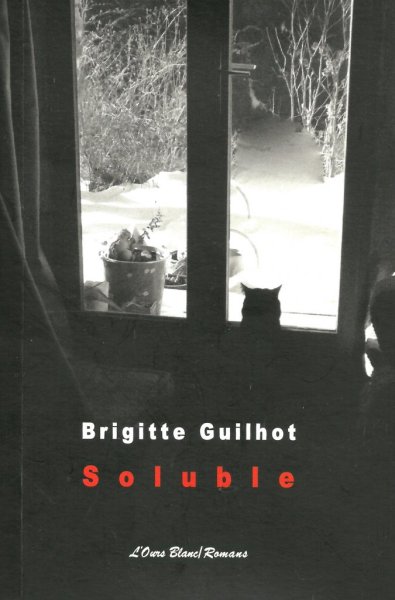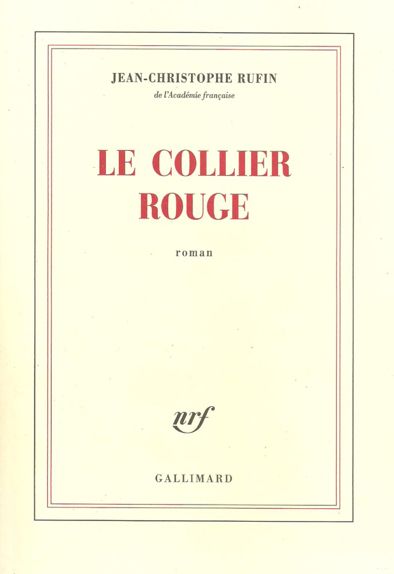 LE COLLIER ROUGE
LE COLLIER ROUGE
Jean-Christophe Rufin
Editions Gallimard (2014)
Chronique publiée dans L’Iresuthe N° 40 (août 2017)
« Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clé du drame. » (4ème de couverture)
Je ne révélerai rien du secret de ce drame dans lequel le chien Guillaume occupe une place essentielle. D’une anecdote véridique, « simple et courte », qui a pour fond de scène la première Guerre mondiale, l’auteur tire une histoire assez alambiquée dont l’intrigue, les implications politiques, les nœuds sentimentaux (c’est aussi une histoire d’amour) paraissent plutôt « tirés par les cheveux ».
Essayer de rendre la réalité « romanesque » en la dramatisant et en l’embellissant des festons de l’imagination, peut aboutir à en proposer une image qui, parce que « fabriquée » de manière trop apparente, ne peut que sonner faux. Si le privilège du romancier est de faire de nous les participants de ce qu’il raconte, de construire, comme le disait Jean Cocteau, « un mensonge qui dit la vérité », encore faut-il que ce « mensonge » qu’est la littérature prenne les accents d’une vérité qui nous pousse à y adhérer.
Le Collier rouge est l’exemple même de la production romanesque qui, de nos jours, règne sans partage sur le paysage littéraire, écrasant tout le reste et ce qu’il peut y avoir encore de véritable création.
On trouve, dans cet ouvrage, tous les éléments qui expliquent le succès de ces œuvres, leurs tirages à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’exemplaires, leur couverture médiatique, leur surexposition parfois et les diverses récompenses qui leur sont décernées.
En premier lieu, « l’histoire ». Le texte de présentation évoque le contexte de celle-ci (l’après-guerre 14-18) qui, a priori, ne manque pas d’intérêt. Mais les procédés mis en œuvre pour la dérouler, maintenir le suspense, relèvent d’un conformisme narratif usé jusqu’à la corde, héritage aujourd’hui dégradé du bon vieux roman balzacien (la chronologie, l’unité de ton, l’alternance descriptions-dialogues, la psychologie, la volonté de réalisme, le point de vue omniscient du narrateur, etc.). Mais Balzac était, en son temps, un auteur moderne, un génie littéraire qui a inventé une forme de roman dont le modèle a prévalu jusqu’au milieu du XXème siècle. Vouloir le prolonger, comme sous perfusion, et sans le talent de celui qui l’a initié ni celui de certains de ses continuateurs (Bernanos, Mauriac, par exemple), c’est faire perdurer une forme de création qui nous semble, aujourd’hui, vieillotte et a perdu tout intérêt. De plus, dans cet ouvrage, c’est comme si le XXème siècle n’avait connu aucun de ces « mouvements » littéraires, ni aucun auteur qui ait essayé de secouer les bases d’un genre aux « recettes » plus qu’éculées. Car, tout de même, après Balzac, nous avons eu Zola et Huysmans, le Camus de L’Etranger ou le Sartre de La Nausée, Faulkner et Joyce, Vian et Queneau, V. Wolf et M. Duras, Gary, Butor et Le Clézio, Genêt, Sollers ou Guyotat, et nous pourrions encore en citer beaucoup d’autres.
On peut ne pas reprocher à J.-Christophe Rufin d’user d’un art de la narration qui ignore toute notion de modernité, ni qu’il nous serve cette soupe sans surprise, le grand public l’attend et la réclame, soucieux de ne pas être dérangé dans ses vieilles habitudes digestives.
Mais, au moins, pourrait-on espérer un certain travail d’écriture digne d’un écrivain qui se confronte aux mots, aux phrases, à la matière de la langue, entreprise qui permet de révéler un « style » (on pense au travail acharné de Flaubert, attaché à ciseler chacune de ses phrases, à celui de Proust ou de Céline). Il ne s’agit certes pas d’essayer d’égaler Montherlant, Martin du Gard, Giono, Jouhandeau ou Gracq, mais il s’agit seulement de trouver une manière d’écrire qui signe le tempérament d’un créateur. Or, ici, le style est plutôt une absence effarante de style, une écriture on ne saurait plus « plate », sans aucun relief ni aspérité.
En voici quelques exemples :
« Quand Lantier se mit en route, le soleil filtrait à travers les bouchures, comme une pelote d’épines brillantes. Passé la gare, il fut tout de suite dans la campagne et c’était plus animé qu’en ville. Des carrioles circulaient sur la route, des chevaux attelés commençaient à travailler dans les champs. On entendait les claquements de langue des paysans qui les faisaient avancer. Dans le ciel encore frais, les hirondelles volaient en cercles affolés. »
Cette description, d’une absolue fadeur, bourrée de clichés, semble celle d’un citadin qui n’aurait jamais vu la campagne, s’étonnerait que des gens y vivent et y travaillent, qu’on puisse y voir des animaux ! Ou celle-là encore :
« Lantier actionna le heurtoir qui avait la forme d’une main de bronze. Aussitôt, une voix de femme à l’intérieur lui cria d’entrer. Il pénétra dans un vestibule obscur qui communiquait avec un minuscule salon. Des remugles de tapis moisis se mêlaient à une odeur de graisse froide, incrustée dans les rideaux et les tissus qui couvraient les fauteuils. Les beaux jours, dans ce réduit, n’étaient qu’une parenthèse vite oubliée. En temps normal, c’est-à-dire toute l’année, l’air confiné ne devait jamais être renouvelé. C’était à se demander si les fenêtres ouvraient encore. »
Autre guirlande de clichés ! Car la demeure d’une pauvre (et vieille femme) ne saurait, n’est-ce pas, que sentir la graisse et le renfermé. La condition sociale, ici, est résumée dans ces images d’un milieu sale et insalubre. Clichés encore que ceux qui servent à l’auteur à décrire cette autre femme, la paysanne Valentine, protagoniste de l’histoire :
« C’était une grande fille maigre. Elle avait beau être vêtue d’une pauvre robe en toile bleue, elle n’avait pas l’air d’une fermière. Ses longs bras nus, ruisselant de veines épaisses (on appréciera l’élégance de l’image !), ses cheveux bruns sans apprêt, taillés avec les mêmes ciseaux sans doute qu’elle appliquait à ses moutons, son visage osseux, tout en elle évoquait non la nature paisible mais plutôt le supplice qu’elle peut faire endurer quand elle est rude et qu’il faut en tirer sa subsistance. Les outrages de l’hiver et du travail n’avaient pourtant pas fait disparaître la beauté et la noblesse du corps qu’ils offensaient. »
On croirait presque lire, dans ces lignes, la description des paysans telle que nous la livre La Bruyère pour dénoncer leur sort d’êtres humains ravalés au rang d’animaux. Ce n’est sans doute pas intentionnel, mais cette description apitoyée a tout de même quelque chose d’assez méprisant pour ces pauvres « damnés de la terre » qui taillent leurs cheveux avec des ciseaux à moutons (!) et que leur dure existence relègue dans une espèce de sous-humanité. Quelle vision du monde paysan ! Quelle déception aussi de comprendre que ce qu’il y a chez Valentine de « beauté » et de « noblesse » ne tient pas à sa propre nature, mais au fait qu’en vérité elle est née dans « la grande ville » et qu’elle sait lire et écrire ! Elle n’est donc pas de ce monde !
Pour ne pas emprunter le titre d’un ouvrage de Roland Barthes (ce qui serait bien désobligeant), on peut se contenter de dire que l’emploi de cette écriture « basique » tient du minimum du travail littéraire. Une écriture sèche et dépouillée n’est pas, pour autant, une écriture pauvre. Celle d’Annie Ernaux est une merveille d’efficacité. Celle de Samuel Beckett recèle des merveilles de trouvailles stylistiques, à presque chaque phrase.
Cet ouvrage appartient, hélas, à la vaste catégorie de ce qui s’écrit et se publie aujourd’hui, sous les pleins feux de la critique, des médias qui l’encensent, avec la complicité des éditeurs et la paresse consentante des lecteurs : une écriture sans saveur (on dirait « formatée)), qui n’offre aucune résistance à l’esprit du lecteur, se lit sans ces efforts de la pensée que réclame l’affrontement avec l’exigence, de la forme et du contenu, s’absorbe comme une nourriture inconsistante et ne laisse aucune trace.
Après tout, pourquoi pas ? L’œuvre de J.-Chr. Rufin est peut-être sans prétention littéraire (ce qui serait tout de même dommage pour quelqu’un qui fait partie de l’Académie française où a siégé, par exemple, Marguerite Yourcenar). L’homme est intelligent, cultivé, courageux, on peut le trouver sympathique, et son parcours d’individu engagé dans le monde est assez remarquable. Mais cela suffit-il à faire un écrivain ?… L’auteur de ce Collier rouge est peut-être lucide sur les moyens d’en être vraiment un.
Cela dit, on peut encore regretter qu’abordant le sujet des mutineries qui ont eu lieu à la fin de la Grande Guerre et des idéaux révolutionnaires de ceux qui se sont engagés pour tenter de changer le monde, J.-Chr. Rufin se fasse lui aussi (à l’instar de son personnage d’aristocrate) le juge de ces « rouges » qui ont mis le monde en péril, celui de l’argent, de l’Ordre et de l’Autorité, de la Patrie et de la République, des valeurs établies et du pouvoir de ces puissants qui tiennent dans leurs mains la destinée des peuples et n’hésitent jamais, au nom de ces « intérêts supérieurs » dont dépend la Nation, à les expédier au massacre. Certes, il prend soin de faire de Lantier, cet « aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes », un personnage humain et même bienveillant, et de Morlac, ce paysan passé au « socialisme » et révolté contre la classe dominante, un pauvre bougre sympathique et naïf, un crédule rêveur à qui Lantier a la bonté d’éviter la peine de mort ou le bagne, mais il ne remet, tout compte fait, pas grand chose en question de ces immenses injustices qui gouvernent le monde. L’humanisme de notre auteur a aussi ses limites. Et on est très heureux que le chien Guillaume, lui aussi, soit sauvé. Quelle grandeur d’âme l’on trouve dans le cœur de cet « aristo », qui épargne la vie d’un cul terreux et adopte son chien ! On a envie de l’embrasser !… Mais on voit que la morale de ce roman ne va pas très loin. On en en sort, à coup sûr, ni meilleur, ni plus intelligent.
Il est, enfin, assez irritant de constater que, sous prétexte de nous raconter l’histoire d’un individu qui s’est dressé contre la guerre et a rêvé d’un avenir meilleur, de justice et de paix, J.-Chr. Rufin défende, avec l’air de ne pas y toucher, ce vieux monde « d’ordre » où l’économie libérale et les lois du marché persistent à vouloir ruiner ce qui demeure encore en nous d’espérance et d’humanité. « Médecin du monde », oui, dévoué, généreux, nul ne peut sur ces aspects-là le remettre en question, mais dans le cadre d’une idéologie conservatrice dont on peut fortement douter qu’elle soit favorable à toute tentative de « révolution sociale et progressiste ».
Michel Diaz, 23/05/17
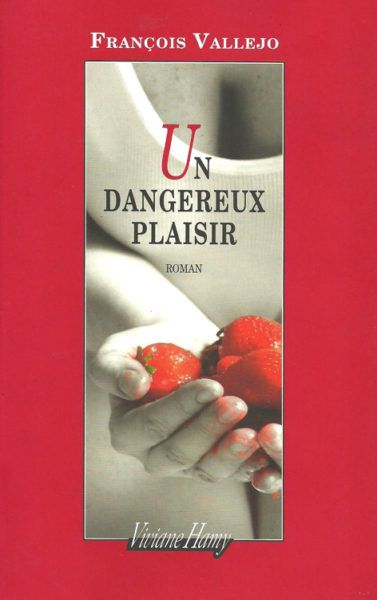 UN DANGEREUX PLAISIR
UN DANGEREUX PLAISIR Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.
Pourtant, pour se trouver, dit-on, il faut d’abord se perdre. Elie Elian promet à ses parents de renoncer au nom qu’il porte pour ne pas le déshonorer dans les trivialités de la cuisine. Puis il endossera, plus tard, celui d’un autre pour échapper aux conséquences de sa filouterie, puis il n’en aura plus aucun et il deviendra ce clochard affamé agrippé aux quais de la Seine. Pendant longtemps, Elie Elian, sans nom ni origine reconnue, ne sera plus personne et il lui faudra des années avant qu’il réintègre son identité.