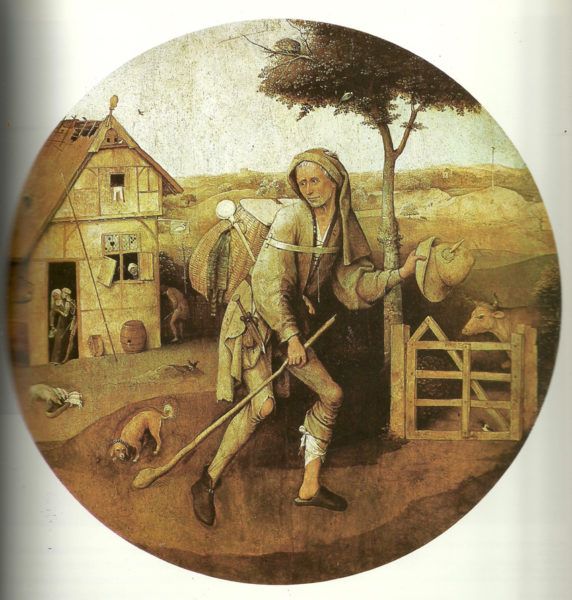L’AUTRE CŌTÉ DU PONT
“ Rien n’avait changé mais tout avait vieilli en même temps que temps que mes tempes et mes yeux…”
Robert Desnos, Fortunes
« Je serai honnête avec vous, vous êtes un homme digne et courageux : vous perdez peu à peu la mémoire, m’a dit le docteur D. Rien de trop inquiétant pour l’instant. Vous la perdrez pourtant de plus en plus. Jusqu’à ne plus vous souvenir de votre nom. De celui de vos proches. Des événements de votre passé. Vous savez très bien tout cela, inutile de vous mentir… Il y a des traitements qui contribuent à retarder les effets de la maladie, et elle évoluera peut-être lentement. Mais elle est là, en vous, en route. Inéluctablement…A moins, sait-on jamais, qu’elle se stabilise, et cela arrive parfois. Aussi gardez espoir, je crois que vous avez encore devant vous quelques belles années. »
Peut-être ne m’a-t-il pas dit exactement cela, mais en tout cas c’est ce que j’ai compris. Et c’est peut-être tout ce qu’il y avait à comprendre… On avait parlé à l’adulte – celui qu’on croit capable d’encaisser la gifle de la vérité, aussi brutale qu’elle soit et, une fois passé le choc, de rester dans le jeu et d’utiliser pour le mieux les cartes qui lui restent. Mais c’est l’enfant que l’on avait livré à la cruauté du destin. Mains nues et sans défense… Aux fauves qui hantaient les forêts primitives. Qui survivent au fond des caves et dans le noir des corridors. Qu’aucun appel à la raison ne parvient à chasser…
C’est pourquoi je suis revenu. Pendant qu’il était temps encore. Et me voilà ici. De l’autre côté de la mer. De retour au pays natal. Dans la ville de mon enfance. Là-même où j’ai grandi… Aujourd’hui, j’ai revu le quartier où j’allais à l’école, la rue où je jouais jusqu’à la tombée de la nuit. La maison qui était la nôtre. D’où la chienne Mirka se sauvait, pour me rejoindre dans les terrains vagues où on construisait des cabanes… Et je me souviens de tout ça… Tant d’années se sont écoulées !… Bon Dieu, ce n’est pas vrai ! Un demi-siècle !… Je pourrais me pincer sans y croire !…
Aussitôt débarqués, nous avons foncé jusque ici. Quatre cent quatre-vingts kilomètres. D’une seule traite… Nous nous sommes passé le volant, toutes les heures à peu de chose près. En conduisant, j’essayais bien de concentrer toute mon attention sur la route, mais ne cessais de regarder dans le rétroviseur. Comme si s’ouvrait devant moi le grand livre d’un paysage dont le verso des pages allait me révéler quelque poignant secret. Ou, plus exactement, comme si le passé était encore inscrit dans l’envers du décor…
J’ai laissé Carole à l’hôtel. Elle dormait profondément, sans se douter de rien. Elle ne m’aurait pas laissé sortir. Le voyage avait été fatigant. Il aurait fallu que je me repose. Une bonne nuit de sommeil était la seule chose raisonnable que nous pouvions envisager. Et pourtant il fallait que j’y aille !… Je me suis habillé dans le noir. En veillant à ne faire aucun bruit. Pas le moindre. J’ai lentement tourné la clé dans la serrure, enfilé mon imperméable, enfoncé mon chapeau sur la tête, et je suis parti dans la nuit. Dans le labyrinthe assoupi de la ville, la même qu’après tant d’années, mais pourtant métamorphosée en une autre, devenue un espace inconnu, ai-je constaté en la traversant, pleine d’immeubles neufs et débordant sur des quartiers que je ne connaissais pas… Je voulais retrouver le chemin du théâtre municipal. Il y a si longtemps !… Bon sang ! quelle idée que d’aller dégoter une chambre d’hôtel dans la périphérie touffue d’une cité où je ne reconnais plus rien !…
… Il pleut. Ici. En ce mois de décembre.
Sur l’enfance abolie. Et ses minuscules jardins piétinés. Sur ces carrefours de silence. Sur la solitude jaune des réverbères. Sur ces rues vides, mortes, qui s’enfoncent dans l’ombre creuse des faubourgs. Sur les broussailles de mes souvenirs qui s’ouvrent et se ferment sur le bruit de mes pas…
Par moments, du coin d’une rue, surgissent de lentes rafales qui soulèvent la nuit comme un pan de rideau, provoquent des remous de détritus qui s’en vont en tourbillonnant le long du caniveau, et la langue froide du vent vient lécher mon visage avant de repartir, emportant un paquet de pluie sur l’asphalte luisant du trottoir. Au pied des réverbères stagnent des flaques de lumière, comme si le vent les avait aplaties et qu’elles eussent été incapables de se soulever pour s’enfuir.
… Les prunelles ensablées de temps, de rêve, de tristesse, je marche dans les rues… Horizon d’échiquier. Devant. Derrière. Du plus loin au plus loin qu’on regarde. Avec les yeux de la mémoire… Jours blancs. Nuits noires. Nuits déchirées de nuit. Jours torréfiés de soleil implacable… Souvenirs d’une longue, si longue bataille… Et de ses desseins hasardés sur ses routes imprévisibles… Je me souviens… Je me veux me souvenir… Qui m’a prédit que j’allais perdre la mémoire ?… Je me souviens de tout…
… Il pleut… Il ne pleut plus… Il pleut encore… Et le monde étendu, devant, partout, à portée de parole, accessible partout à mes mains !… Il suffit de fermer les yeux… Ici, la ville obscure, comme une vache ruminant dans la paix de l’étable. Et il me suffit d’imaginer, là-bas, au-delà du regard, l’eau, l’herbe, le soleil sur les étendues sombres et touffues des orangeraies…Là-bas, les neiges de l’Atlas, ces crêtes blanches que je contemplais du haut de la terrasse… Des massifs montagneux, coupés de gorges verticales, d’éboulis gigantesques, et couverts de buissons d’épineux ou de forêts de pins sauvages… Et à perte de vue, devant, plus loin, je ne sais plus, au-delà du regard, des collines trapues, râpées, pelées, grisâtres, désertes. Leurs coulées de pierres dorées sous la lumière fauve. Lèpre du maquis sur les pentes. Touffes de thym, d’alfa sauvage, chênes nains rabougris, arbres à gingembre, oliviers tourmentés… Et le vent rouge qui se lève sur le djébel ! L’haleine du désert si proche !… Qui m’a prédit que la mémoire allait me déserter ?… Je me souviens de tout cela, comme si je l’avais quitté hier !…
… 1954… 1955…
… J’avais six ans alors…
… Clartés abruptes aux fenêtres de la mémoire… car tant d’odeurs soudain, de visages, de gestes, de murmures, qui battent par bouffées à ces brèches obscurcies de tant de lumière… se déforment et se tordent en flammes… fragments de mains, de sourires, de rues qui agitent sous mes paupières leurs fantômes déchiquetés… souvenirs lapidés par le temps, éclats d’êtres pétris d’absence… et tant d’heures rongées de soleil, de sommeils et de lampes, qui ne font qu’une flaque d’ombre où le passé fermente et brûle sous la pierre noire des mots…
Je me souviens… et je me demande soudain de qui je me souviens… et qui cherche à parler par ma bouche ?… et de qui j’essaie de prendre les yeux ?…
… Et pourtant me voici… Ici, et maintenant. Pataugeant jusqu’au cou dans les égouts du temps et de ma ville disparue… dans son labyrinthe nocturne, envahi par les souvenirs sans cesse bourdonnants, tourbillonnants, mordants, vrombissement multiplié, toujours multiplié sur la pourriture et la décomposition !… Que de cadavres sous les mots !… Quelle puanteur dans la bouche !… Et quels essaims de mouches aux lèvres !… Je veux me souvenir pourtant ! Je veux… je voudrais tant… mais de moi à moi-même quel espace de mort à franchir… et quels chemins ?… et à qui demander, s’il vous plaît, le chemin du théâtre municipal ?… J’espère que Carole ne s’est pas réveillée… qu’elle n’est pas partie à ma recherche… La voiture de location est sur le parking de l’hôtel… et la clé de contact dans son sac à main… que je n’ai pas osé ouvrir… idiot… de crainte de la réveiller…
… 1955… 1956…
… Pourquoi est-ce si loin déjà ?…
… Qu’importe tout ce temps à la mémoire et à ses labyrinthes d’ossements ?…
Mais on se bat déjà dans les montagnes d’Algérie. Depuis des mois… Et les rues de ma ville s’emplissent elles aussi du fracas des chenilles, de ces fumées, de cet acharnement !… Ce sera, cette guerre, la démence une fois de plus accoudée aux terrasses torrides !… Ce sera l’homme titubant sous l’œil fou de midi ! Perdu, hagard, traqué de mort ! Comme si le mal, une fois de plus, redevenait sa seule essence !…
… Embuscades. Accrochages. Embuscades. Ratissages. Accrochages. Attentats… Ce seront les bilans de guerre. Jour après jour, nuit après nuit, la radio qu’on écoute où les furies glapissent. Bilans faussés, truqués, propagande, bourrage de crâne. Opérations de « pacification ». Un petit militaire français blessé légèrement contre cinq terroristes mis « hors de combat ». Un petit militaire tué contre dix fellaghas mis « hors d’état de nuire ». Un attentat sauvage perpétré en pleine ville par un « fou sanguinaire » contre d’innocentes victimes. Mais folie et terreur, atrocité, partout. Ce sera ce feu noir au cœur aveuglant de la transe… Charniers dans les montagnes des Aurès, douars dévastés, rasés au lance-flammes… Et au début de tout cela, presque comme si de rien n’était, rues caquetantes de la ville, persiennes ouvertes à la fraîcheur du soir, ruelles de tumulte éblouissant, boulevards livrés aux brochettes, à l’anisette, aux tangos et aux rires…
Ce sera ce feu noir au long des routes balbutiantes de l’espoir et de l’acharnement. Horizon ravagé, soleil en fuite, membres brisés. Le temps multipliant cette fragmentation !… Et la ruine des hommes laissera des taches de crépuscule sur les portes, sur les trottoirs et les escaliers de ma ville… Ma ville, où même les enseignes et les rideaux de fer composeront avec la mort… Plutôt que de penser Carole réveillée, inquiète de mon sort et tapotant fébrilement, sur le clavier du téléphone, le numéro du poste de police, celui de l’hôpital, je préfère l’imaginer accoudée à la balustrade de fer forgé du balcon de l’hôtel, immobile, ses longs cheveux qui pendent devant elle lui cachent les épaules, et son regard rêveur perdu au loin, vers l’horizon… Non, impossible ça… je ne peux que l’imaginer endormie… simplement endormie…
… Ici, présent, passé, futur, s’interceptent et s’interrogent. S’entrelacent au fil des pensées et des mots qui se bousculent dans ma tête. Le temps multiple tresse ici une identique solitude où j’avance à contre courant… Mais je veux aller sans repos. N’être plus rien qu’un souvenir meurtri… Au fil des mots qui pactisent ou s’entremêlent, je veux me souvenir ! Et m’enfoncer dans la blessure d’une bouche, dans la pénombre d’un visage, à la rencontre de je ne sais quel cri qui jaillira de moi comme une régurgitation irrépressible !…
Car voici que je marche dans les avenues décharnées de ma ville, ici, dans l’immobilité pétrie de tant de mouvements à jamais suspendus, dans les rues déchirées de mes souvenirs, dans les quartiers brûlés de ma mémoire… Et voici que j’avance, à la recherche d’une bouche ensevelie, d’un visage détruit, d’une ville de cendres…
Je lui avais parlé de mon projet, l’an dernier, en Espagne, à l’ombre d’un patio ombreux où nous nous reposions en sirotant des bières. Je lui parlais, les yeux fixés sur une corde à linge où Carole avait mis à sécher quelques sous-vêtements, un soutien-gorge, trois ou quatre slips en dentelle, rien de très érotique, mais dans lesquels j’aimais la voir se promener dans l’intimité de l’appartement. Corps à peine vieilli, toujours si désirable. A me voir ainsi regarder les choses sans paraître les voir vraiment, elle avait deviné que ce que je disais était très important pour moi. Elle m’a laissé parler, en silence, et quand j’ai eu fini, elle m’a pris la main : « Si on allait se balader sur les ramblas ?
– Ça me paraît une bonne idée, je lui ai répondu. Et j’ai pensé que j’étais encore très amoureux d’elle.
– Et puis, après, j’ai proposé, nous attabler devant une bonne bouteille de vin.
– Ça va, elle me dit », et les choses en restèrent là.
… 1958… 1959…
… Il ne pleut plus…
Je marche dans les rues désertes.
… Absence d’un passé pur où se fonder… De là, l’exil… Un exil à perpétuité. Le mien, jusque en ces lieux, après l’opiniâtre tumulte de la guerre et ces années qui auront épuisé leur horreur jusque dans les rues longues et blanches de ma ville… dont je me remémore la lumière sur les murs, les façades laides, les quartiers pauvres et leurs odeurs, les bazars misérables, les mendiants aux paumes crispées, les chiens maigres et la tristesse errant dans le crépuscule des terrains vagues, parmi les détritus et les tas de ferraille…
… Poussière des troupeaux, le soir, dans le rougeoiement âcre des banlieues, l’odeur pesante du suint… Je me souviens aussi du jappement furtif des chacals qui venaient renverser les poubelles dans les rues endormies du faubourg, sur le seuil des maisons éteintes… et l’hiver le vent qui venait siffler à la porte comme si c’étaient eux qui soufflaient leur haleine par la serrure…
… Des bidonvilles, oui, j’ai dit à Carole, il y avait cela aussi… un peu partout… aux portes de la ville… je me souviens… de ceux qui vivaient là… parmi les détritus… centaines et milliers de sous-développés, illettrés, chômeurs et mendiants, petits bras corvéables à merci, ramasseurs de ferraille, de cartons usagés, rémouleurs de misère et vendeurs de n’importe quoi… et qui vivaient là, entassés, abandonnés aux mauvaises herbes… et où ? pour qui ? l’œuvre si bénéfique de la Mère Patrie ?… les hôpitaux ? les routes ? les barrages ? les écoles ? l’hygiène ? l’aide au chômage ?… mais vivent là, triant les détritus, et pour tuer le temps fument du kif et boivent du vin rouge… les mains vides d’espoir, de courage, d’avenir… dorment au fond des terrains vagues, sur des lits de cartons empilés, les pieds dans l’eau puante, la tête sous la tôle ondulée… corps entassés dans la misère, pliés dans l’ombre
… C’est ainsi que beaucoup vivaient, je lui ai raconté encore, congédiés de la « ville blanche », relégués dans les ronces, les cailloux, les bidons… à l’écart d’un ville qui les oublie… dédale de visages, et les enfants qui traînent leurs pieds nus dans toutes les poussières, les petits ramasseurs de mégots, les petits cireurs de chaussures qui arpentent, dès le matin, les trottoirs des grands magasins et des bars de la ville française… et si peu de pluie pour laver ces crasses saignantes… d’un jour à l’autre, rien que la vie qui continue dans l’atroce banalité de sa violence, de son ordre qui continue…
… Il faut passer le pont. Le premier repère fiable !
Je n’ai pas dû user de beaucoup d’arguments pour la persuader de faire ce voyage. Nous avons préféré le bateau à l’avion. Non par goût de la nostalgie, mais pour mieux nous inscrire dans le temps de ce que Carole appelait mon « pèlerinage » … Cette nuit, à l’hôtel, j’ai instinctivement inspecté le lit avant de me glisser entre les draps. Je me suis allongé sur le dos et j’ai longuement fixé le plafond, comme si je devais y découvrir des fragments de réponses aux questions qui me traversaient l’esprit sans jamais prendre forme. Carole était entrée dans la salle de bains, et j’ai entendu l’eau couler longuement dans l’étroite cabine de douche. Quand elle revenue s’allonger à côté de moi, j’avais les yeux fermés et faisais semblant de dormir. Elle a éteint la lampe de chevet …
… Je me suis avancé sur le pont. Cette fois, c’était bon !… La Mékerra, mince serpent d’eau noire, se frayait un chemin parmi l’amas des pierres qui encombrent son lit. Appuyé à la balustrade de fer, j’ai regardé le fond de la rivière, les yeux tout grands ouverts, face à ce ruban de suie miroitante qui ne reflétait rien que le maigre plumet de lumière qui suintait du réverbère installé au milieu du pont… Accoudé sur le garde-fou, le dos tourné au vent, je me suis arrêté un moment pour entendre son sifflement descendre la rivière, comme s’il filait en glissant à la surface d’un miroir gelé. Puis j’ai continué, et mis le pied sur l’autre rive…
… Je marche, maintenant, le long des anciens remparts de la ville. Sur les glacis. Plantés de platanes musclés et paisibles. D’où s’égoutte la pluie en un chuchotement de source… Des cigognes habituées à la rumeur humaine s’y promenaient le jour, lentement, parmi les passants et les légionnaires en vadrouille… Là, voilà, le quartier massif des casernes. Ses bâtiments trapus, ses murs ocres, ses hautes grilles. N’y manque que ses sentinelles aux épaulettes rouges, debout dans leur guérite, la mitraillette sur le ventre, le képi blanc vissé au crâne, retenu par la mentonnière qui boursouflait légèrement leur bouche, leur donnant cette moue hautaine qu’ont aussi les soldats de la Reine sous leur bonnet de poils… Et la longue avenue qui remonte vers la Casbah, ici… Temps aboli… Voilà le centre de la ville « européenne », et ses vitrines provinciales… La voilà, la place Carnot. Et son kiosque à musique en toit de pagode… Tout autour, le Palais de justice, le cinéma Versailles, la bijouterie, des boutiques de vêtements, d’électroménager, le théâtre municipal… exactement le même avec, de chaque côté du fronton, les masques réjouis et tristes de la comédie… ses grandes portes en bois massif en haut d’une volée de marches…
Plus loin, là-bas, se perd la ville, dans les ruelles du quartier arabe… Murs tessonnés. Maisons éteintes. Places secrètes. Loupiotes taciturnes pendant aux encoignures pétrifiées. Labyrinthes d’arcades. Rideaux métalliques posés comme un doigt sur la bouche cousue des façades…
… Je marche, cette nuit, dans une ville ouverte comme un rêve. Et comme un rêve pleine de fantômes de bruits. Au milieu d’impalpables présences… Ville couchée au creux du souvenir comme une seule masse de sommeil… Des pas claquant sur les trottoirs, des radios qui s’épuisent au fond des couloirs, des patios engourdis de chaleur, des plaintes et des chants jaillissant enlacés des bazars, des carrioles grinçantes, des ânes graves, et des femmes voilées qui ne montrent de leur visage qu’un œil de chardon, il ne me reste, cette nuit, de toi, que ces monuments somnambules, ces voix transpercées d’ombre, ces heures éboulées… Mais voici que je vais, dans la nuit ample de tes rues, dans le silence de ton couvre-feu, t’invoquant dans un va-et-vient d’images qui meurent aussitôt qu’ils reviennent à ma mémoire… Dans le silence de ton couvre-feu, je fais halte, je n’en peux plus, ville aux carrefours tourmentés de guérites, de barbelés, de sacs de sable entre lesquels émerge le dard sombre des mitrailleuses… où résonne le pas des patrouilles…
… Elle a éteint la lampe de chevet sans abolir la nuit blanchâtre qui passait par la porte-fenêtre. Ma main a eu envie d’escalader sa hanche et d’attirer son corps tout contre moi. Mais je l’ai laissée s’endormir. Elle s’est retournée vers moi, puis a tourné sur elle-même, s’est retournée encore avec une lenteur de rêve et j’ai vu, en effet, aux palpitations spasmodiques de ses paupières, qu’elle avait commencé à rêver…
… Perquisitions, arrestations, interrogatoires, condamnations, sévices, tortures, viols… Auxquels répondent et s’enchaînent les attentats aveugles dans les brasseries, les bars, les cinémas, sur les boulevards, les marchés, bombes cachées dans les couffins d’oranges, grenades jetées dans la foule, et les égorgements, kidnappings, assassinats en pleine rue, familles de colons massacrées la nuit dans leur lit… Et encore, toujours, descentes de police, opérations de ratissage ouvrant leurs bras de pieuvres bardés de mitrailleuses et de canons… Villages bombardés, roquettes et tirs d’artillerie, napalm… On fouille le pays, on encercle, on ratisse, on réprime, on patrouille, on pilonne, on fusille, on incendie les douars, on viole, on viole…
… Bruits de jeeps, de camions, de chars dans le buvard de l’aube, qui descendent vers le djébel… Des oliveraies de la plaine aux forêts de chênes-lièges et de frênes, du maquis broussailleux des basses pentes de Djurjura aux massifs de cèdres et de pins, partout, poussés vers la bataille, vendus aux violences et livrés à la peur, partout, les petits militaires français aux visages d’adolescents, leur gros casque lourd sur la tête. Conduits coûte que coûte vers le rebelle, l’Arabe, le melon, le raton, le bicot, le crouillat, le bougnoul, le fellagha, le fellouze, le salopard, en un mot, un seul, l’ennemi…
… Paniers de haine. Chuchotements, imprécations, supplications et appels au secours, cages thoraciques écrasées sous les bottes, gorges tranchées, couilles coupées enfoncées dans la bouche… gémissements… Le sang se casse au bord des routes… La basse continue du temps…
J’ai, un jour, raconté à Carole, une fois, une seule fois, ce jour brûlant d’été… au début de l’après-midi… le panier à salade… Elle a été malade, au début de la traversée. Pas très longtemps, deux ou trois heures, mais suffisamment pour se retourner l’estomac comme un gant. La mer était pourtant peu agitée, à peine formée comme on dit, du même gris ardoise que le ciel. Le temps était humide et brouillasseux, mais nous avions tenu à passer la nuit sur le pont, couchés dans des transats et enveloppés dans des couvertures. Evidemment, une nuit douce et étoilée nous aurait convenu davantage, une de ces nuits en bateau, inoubliablement charmeuse, qui nous installe dans le cœur ce sentiment divin d’être au sommet du monde et de se déplacer sans bouger d’un centre immobile. En vérité, ce temps maussade s’accordait parfaitement avec notre état d’âme. Nous avons somnolé un peu, dans le bruit des machines et du vent, échangé peu de mots, prudemment, pour ne pas nous laisser déborder par ce qu’il y avait en nous d’angoisse contenue. De temps à autre, sans ouvrir les yeux, je cherchais la main de Carole et je la prenais dans la mienne, me mettais à la tapoter et à la serrer doucement pour la consoler d’un chagrin contre lequel je me sentais tout à fait impuissant. De temps à autre aussi, de l’autre main, elle tamponnait son visage avec un mouchoir pour y essuyer la poussière d’embruns que le vent y avait collée, avec les gestes de quelqu’un qui, subrepticement, éponge sur ses joues les larmes qui y ont coulé…
… Villes quadrillées de patrouilles, vérifiant les identités, fouillant les passants musulmans… Rafles, perquisitions, arrestations, interrogatoires… Les paras, leur « centre de tri”»… Coups de poings, coups de bottes, passages à tabac, seins brûlés, règle triangulaire placée sous la plante des pieds, tuyau d’eau enfoncé au fond de la gorge, robinet grand ouvert sur la tête enveloppée de linges, et encore les coups, l’électricité, la baignoire, le tuyau d’eau, le goulot de bouteille ou le manche à balai qui empale… Et jusqu’à l’aube, chaque nuit, les hurlements et les plaintes des suppliciés, étouffés sous le bâillon, les jurons et les coups…
Nous avions eu des mots, une semaine avant. A propos d’une stupide histoire de réfrigérateur. J’avais déjà dû renoncer à remplacer notre vieux canapé auquel elle semblait aussi attachée qu’à la prunelle de ses yeux. Va pour le canapé ! Mais je ne pouvais concevoir qu’il y eût une histoire d’amour entre elle et ce frigo, vétéran des révolutions électroménagères !… Je dis son, mais c’est tout aussi bien le mien. Je pensais donc avoir mon mot à dire là-dessus et, à mon humble avis, il était bon à recycler. Il y avait pas mal de temps déjà qu’il nous donnait des signes évidents de faiblesse : il faisait un peu trop de givre, décongelait sans crier gare ou parfois se mettait à craquer dans la nuit comme si un cambrioleur marchait dans la maison en faisant crier le parquet… Il n’y a pas une semaine, pendant les six derniers mois, où je ne sois revenu à la charge… Elle se contentait, la plupart du temps, de hausser les épaules et d’affecter une attitude de désinvolte négligence, excepté ses yeux et les plis de sa bouche qui trahissaient, plus qu’aucun mot ne l’aurait fait, sa détermination farouche à ne céder en rien un pouce de terrain. Je n’allais tout de même pas m’agenouiller à ses pieds pour qu’elle consente à changer d’avis.
« Après tout, fais comme bon te semble, je m’en fiche », elle finissait par me dire.
Il n’y avait rien, entre nous, qui ne m’apparût plus stupide que ce genre de discussions. Mais il n’y avait rien de tel, non plus, que ce genre de phrases pour me mettre en pétard pour toute la soirée…
… J’ai, un jour, raconté à Carole, une fois, une seule fois, ce jour brûlant d’été… au début de l’après-midi… le panier à salade garé devant la porte… la police dans la maison, la même que je suis allé revoir… les policiers zélés renversant les tiroirs, vidant brutalement armoires et placards, jetant bas les piles de linge, fouillant tous les recoins, feuilletant tous les livres, épluchant les papiers et les lettres, arrachant les photos des albums… Perquisition, arrestation, interrogatoire… ce jour d’été… Mon père qu’on emmène… communiste et sympathisant F.L.N., dénoncé par un “camarade ” qui avait craqué sous les coups… qu’on emmène… et qui ne reviendra que bien plus tard… presque cinq ans après… dans un si pitoyable état…
« Accorde-moi deux heures, s’il te plaît, je lui disais. Ne serait-ce que ça. Le temps d’aller au magasin, d’en choisir un autre et de revenir. Ils livreront un frigo neuf et se chargeront d’emmener cette vieille carcasse qui, un jour ou l’autre, c’est à prévoir, s’oubliera à faire sous elle.
– Je tiens à ce frigo, voilà, elle me rétorquait à bout d’agacement. J’y suis habituée. Je ne supporterai pas de voir un autre réfrigérateur prendre sa place. C’est comme si tu me demandais… d’abandonner mon chien ! Je n’en aurais pas le cran, ni l’envie d’ailleurs… Il faut le faire réparer, c’est tout. »
Voilà le genre d’arguments absurdes qu’elle me mettait sous le nez.
« Bon sang, Carole ! j’insistais. C’est insensé ! On ne compare pas un frigo et un chien ! Et puis, d’abord, nous n’avons pas de chien ! Mais ce frigo, il est foutu, et bien foutu ! bon pour la casse ! Personne ne voudra, ou ne pourra le réparer !… Suppose qu’il nous lâche, pendant que nous serons absents, une semaine, quinze jours… Nous retrouverions, au retour, la cuisine inondée, un frigo plein de moisissures, à gratter au couteau, de la nourriture pourrie dans le congélateur, sans parler de l’odeur !… J’ose à peine y penser !
– Il suffira de le vider au moment de partir et de le débrancher, ce n’est pas compliqué. »
Si je retournais à l’assaut de son obstination, elle me répondait : « Non, pas question de perdre deux heures de mon temps pour remplacer un appareil qui marche bien encore et qui, jamais, tout au long de sa longue vie, ne nous a posé le moindre problème !… Quand je m’attache aux choses, comme aux gens, je le les trahis pas… Je ne parlerai pas de compassion, ce serait excessif, mais ce frigo, tout inerte et stupide qu’il soit, a une vie bien à lui, comme toutes les choses… Je l’aime, voilà tout, et j’y tiens parce que je l’aime, à moins que je ne l’aime parce que j’y tiens, tout ça au fond revient au même, il n’y a rien d’autre à comprendre sinon que, là-dedans, il est question de sentiments. »
La semaine dernière, je m’étais contenté d’ajouter, pour conclure la discussion : « Je respecte tes sentiments, je m’y efforce chaque jour qui passe, mais je ne comprends tout de même pas ton entêtement à garder ce tas de ferraille… Je ne te demande pourtant pas grand chose si on prend la situation sous un angle… disons, un peu plus raisonnable… »
Elle s’est énervée, de manière incompréhensible, je dirais même irrationnelle, et comme je lâchais je ne sais plus quels mots cinglants et sûrement injustes, elle a fondu en larmes, brusquement, affalée sur le canapé, la tête dans les poings, secouée de sanglots qu’elle arrachait de sa poitrine entre de brefs gémissements… « Mais, après tout, fais comme tu veux, je m’en fiche » a-t-elle gémi. Cette fois, ma colère a crevé aussitôt, comme une bulle de savon, mais je l’ai regardée pleurer, un bon moment, parce que je ne savais pas quoi faire. Après, elle est allée dans la salle de bains, s’est lavée le visage et, revenue dans le séjour, je lui ai demandé pardon. C’est le moins que je pouvais faire…
… 1959… 60… 61…
… J’ai marché, cette nuit, d’un souvenir à l’autre, peu à peu transpercé par la pluie… Et rien qu’effondrements… D’un souvenir à l’autre… effondrements… effondrements… J’ai marché, cette nuit, sur les traces de mon passé. Sur la mort de tous ceux que je fus. Sur ces débris de ma mémoire qui se précipitaient au-devant de mes pas, et derrière moi s’effaçaient comme des vestiges de rêve… Cette distance entre eux et moi, c’est celle qui existe entre nous et la vie. La franchir demande du temps. Il ne faut surtout pas se hâter… Et pourtant il est là, le théâtre municipal, là où je voulais revenir… exactement le même avec, de chaque côté du fronton, les masques tristes et joyeux de la comédie éternelle… ses grandes portes en bois massif en haut d’une volée de marches… Et si la vie est là aussi, étrange et immédiate dans la silhouette des chiens errants qui s’en vont au hasard des rues, dont l’ombre se découpe au bas des palissades, il nous faut nous aventurer dans ce qui en nous, comme dans le silence de la nuit, brûle de la lumière moribonde des réverbères…
… En allant au lycée, ce matin de juin, je l’ai vu sur les marches du théâtre municipal. Depuis un mois, la ville arabe était cernée par les paras qui en interdisaient l’accès, et qui défendaient qu’on la quitte. Il avait dû sortir, pendant la nuit, en trompant sa peur et sa faim, et la vigilance des sentinelles. Il avait trouvé un pain quelque part, pour nourrir sa famille sans doute, un gros pain rond de trois kilos qu’il avait coincé sous son bras, et il regagnait le quartier assiégé. Chacal furtif qui s’arrêtait dans l’ombre plus épaisse des platanes, dans l’encoignure des portails, repartait en rasant les murs. Pour échapper, sans doute aussi, aux tueurs en maraude de l’O.A.S., il avait dû se réfugier en haut des marches du théâtre, dans l’encoignure de la porte. Le pistolet automatique avait déchargé sa rafale dans les linges gris du petit matin. L’Arabe était tombé, tête en avant, bras battant l’air, sur les marches de marbre, et il avait lâché son pain qui avait roulé jusque en bas… Je suis passé ce matin-là, sur la place Carnot, comme je le fais chaque jour, pour aller au lycée. Je contourne le kiosque à musique, je passe au pied des marches du théâtre. Le soleil était déjà haut, le sang avait séché. Il faisait sous son ventre une tache noirâtre qui avait glissé jusqu’à son visage… Au retour du lycée, à la fin de l’après-midi, il était toujours là, dans le silence morne de la place où aucun des rares passants n’osait poser les yeux sur lui. Au bas des marches on avait mis un écriteau, un morceau de carton où il était écrit, en lettres de charbon : il est interdit de jeter des ordures, et encore plus de les ramasser… Le lendemain, il était là, toujours. Et le surlendemain. Une semaine après, encore, et le soleil d’été liquéfiait ces chairs de cadavre dont s’étaient emparées les mouches… Pour « l’exemple », on l’aurait volontiers laissé une semaine encore, mais finalement on l’a enlevé, par mesure d’hygiène…
Cette nuit – déjà le matin, je suis revenu voir si on avait lavé les marches. S’il restait des traces du sang incrusté dans la pierre. Mais, malgré l’aube qui se lève, il fait trop sombre encore pour être sûr de ce que l’on croit voir… Il y en a un autre encore, dans la rue, pas très loin de chez nous, sur l’Avenue de l’Hôpital. Tombé sur le trottoir. D’une rafale dans le dos. Mais lui y est encore, je l’ai vu, hier matin, en partant au lycée, les genoux repliés sous lui, la tête entre les bras, le front contre le sol, comme s’il faisait sa prière. On l’avait sûrement laissé sortir de l’hôpital, au début de l’après-midi. En sachant qu’il n’avait pas la moindre chance d’arriver chez lui vivant. Ou, plus exactement, on l’a poussé jusqu’à la porte : il n’avait plus besoin de soins. On l’a laissé partir dans la nature, comme ça, un lapin dans la ville, un chevreuil sur le macadam, du vrai gibier traqué, apeuré, condamné d’avance, livré à découvert, que les chasseurs d’Arabes n’ont pas tardé à débusquer… Il n’avait pas fait cinq cents mètres…
Carole ne peut pas supporter ça. Ce sont des choses qui la font pleurer. Qui lui donnent envie de hurler. Comme à moi. Vaudrait-il mieux se taire ? Protester, montrer sa révolte, ce serait à coup sûr s’exposer à je ne sais quelles représailles, un enlèvement, comme il y en a tous les jours, ou risquer encore, plus simplement, de prendre quelques balles dans la peau. Ça ne vaudrait pas mieux. Pas mal de gens ont disparu, ces derniers temps, des Européens, des Arabes… des opposants, des traîtres, des gêneurs, enlevés, dans chacun des camps, par ceux du camp d’en face… et qu’on retrouvera, un jour, dans un charnier, liquidés d’un coup de couteau ou d’une balle dans la nuque, ou jetés dans un four à chaux, ou emmurés vivants dans une grotte… Et nous, qui sommes pour l’Indépendance, nous sommes du mauvais côté ! Les Pieds-Noirs sont devenus fous !… Littéralement enragés !… et les tueurs courent les rues… Je ferai quand même étudier aux élèves, demain, Le dormeur du val, de Rimbaud, ce jeune homme allongé dans l’herbe avec ses deux trous rouges au côté droit, c’est inscrit au programme, et puis merde au proviseur et aux parents qui me chercheraient des poux dans la tête !… Ou au petit cercueil qu’on m’enverra peut-être par la poste… Au moins, j’aurais servi la poésie, et aurai ma conscience pour moi… Histoire de ne pas avoir, un jour, trop honte de moi-même…
Bon sang ! la guerre un jour s’achèvera, c’est sûr. Le plus tôt possible, j’espère. Nous ne quitterons pas le navire. Comme des rats saisis par la panique. Pas de raison à ça. Nous resterons ici, dans cette ville, où nous avons toujours vécu… Il faudra tout recommencer… La guerre finira bientôt, il faudra bien qu’elle finisse. J’ai traversé la place, tout à l’heure. Je suis allé jeter un œil à la vitrine d’électroménager, et j’ai vu un frigo qui me plaît beaucoup. Ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. Le temps d’aller au magasin, demain, de constater que celui-là fera tout à fait notre affaire, et de rentrer à la maison. Ils livreront le frigo neuf et se chargeront d’emmener l’autre vieille carcasse… Je n’ai plus qu’à rentrer me coucher, jusqu’à l’ouverture de la boutique… Je suppose qu’elle dort encore. Peut-être dans la même position que tout à l’heure. Je lui en en parlerai, dès qu’elle se réveillera. Je mettrai la radio pour la réveiller doucement en musique… Je suis sûr que, cette fois-ci, elle me donnera raison… Peut-être même qu’on interrompra la chanson, entre deux couplets, pour nous annoncer la fin de la guerre et donner l’ordre du cessez-le-feu.

 10 janvier
10 janvier 4 février
4 février 5 mars
5 mars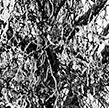 11 mars
11 mars 14 mars
14 mars 25 mars
25 mars