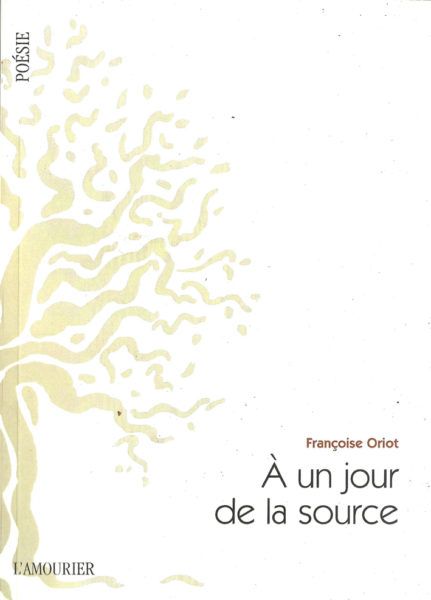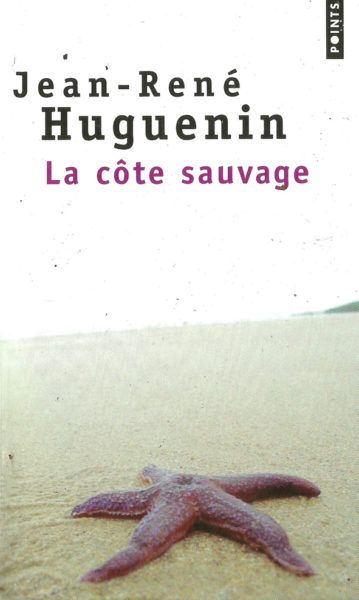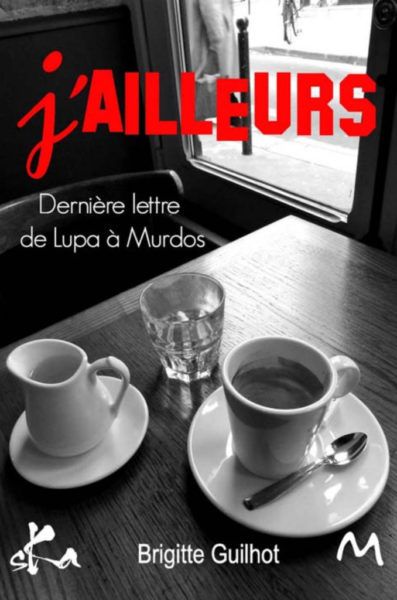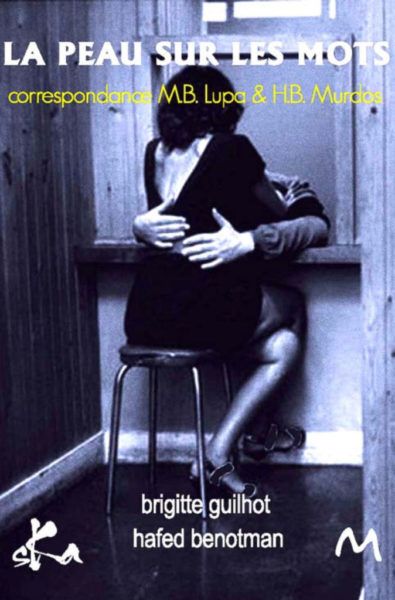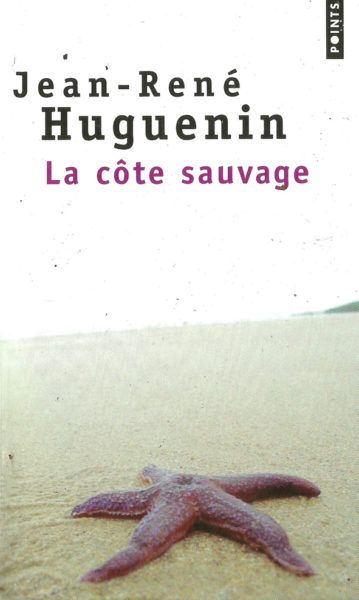
LA COTE SAUVAGE – Jean-René Huguenin
(Points-Seuil, P119)
Chronique publiée dans la revue Les Cahiers de la rue Ventura, N° 30, décembre 2015
« Les souffrances du jeune Olivier »
« Jean-René Huguenin est né en 1936 à Paris. A l’âge de vingt ans, il fait ses débuts dans l’écriture en publiant des article dans la revue La Table ronde. Peu de temps après, il prépare sa licence en philosophie et son diplôme en politique qu’il obtient en 1957. Il publie son premier roman, La Côte sauvage, qui connaît un succès exceptionnel. Jean-René Huguenin trouve la mort dans un accident de voiture le 22 septembre 1962 alors qu’il est à peine âgé de vingt-six ans. » (Note Folio Points-Seuil)
Ce roman, le seul écrit par Jean-René Huguenin, a été publié en 1960, aux éditions du Seuil, à la juste charnière de deux décennies qui ont littéralement bouleversé, mis sens dessus dessous, tout autant la littérature que les sciences humaines et les exercices de la critique. Mais essayons, ne serait-ce qu’en quelques mots, d’évoquer le contexte culturel de cette époque, pour situer ce livre dans un paysage qui entrera bientôt en totale révolution. En effet, dans ces années d’après-conflit mondial, nous sommes dans une France en plein bouleversement politique, social, intellectuel, artistique et, dans tous les domaines de l’expression, sur fond de guerre d’Algérie, dans une période de prospère et active modernité. Une modernité encombrée déjà, il faut le dire, harnachée même de besogneuses théories, et alourdie d’un arsenal souvent bien nébuleux de notions et concepts élaborés dans des « laboratoires » de pensée par des « techniciens » de la langue, toutes choses qui ne tarderont pas à retourner pour la plupart (le temps d’une génération à peine) au néant de l’oubli et de l’indifférence.
Au cours de ces années cinquante, cependant, le sang neuf et le plus précieux nous est alors donné par des poètes comme Bonnefoy, Du Bouchet, Jaccottet ou Dupin, tandis que dans le domaine dramatique le théâtre dit de « l’Absurde » finit de s’imposer sous la plume d’Adamov, Ionesco et Beckett. Ce que l’on appelle « Nouveau Roman » a fait aussi son apparition sur la scène littéraire, et en mars 1960 est publié le premier numéro de la revue Tel Quel dont, avec Sollers (qui a publié Une curieuse solitude en 1957), Jean-Edern Hallier et Renaud Matignon, Huguenin est le co-fondateur, même si leurs routes vont vite diverger. Déjà, la linguistique, la sémiologie ou le structuralisme proposent de nouvelles approches de la langue, d’autres modèles de pensée, et R. Barthes, dès 1964, s’attachera à définir « la nouvelle critique ». Tout cela est assez pour dire que La Côte sauvage, ce roman d’un jeune homme de vingt-quatre ans, et publié en 1960, nous l’avons dit plus haut, s’inscrit dans un contexte où innovations, avant-gardes diverses, explosion des recherches en sciences humaines, nous laissent, avec le recul, comme une impression de vertige.
Mais, d’abord, de quoi s’agit-il ?… Nous sommes au cœur de l’été, en Bretagne, éternel été de vacances qui ne devrait jamais finir, près de la plage de Portsaint où s’agite une bande de jeunes gens. Denis Gombert, dans une chronique de 2012, résume ainsi l’ouvrage : « Quand de retour de son service militaire (rappelons qu’à l’époque la chose durait 2 ans) Olivier pénètre dans la maison familiale, il apprend que sa jeune sœur Anne compte se marier avec Pierre. Et qu’ils iront s’installer dans la foulée à Beyrouth, là où Pierre vient d’être nommé. Pierre est le meilleur ami d’Olivier. (…) Tout est bien qui commence bien, n’était le caractère étrange d’Olivier. Le jeune homme à la sempiternelle mèche débordant du front, aux yeux félins et au triste et sinueux sourire est une âme blessée. Quelle en est la cause ? On ne le saura jamais. Le roman tourne autour de ce mystère. D’où Olivier tient-il son caractère ? » Quoi qu’il en soit, l’auteur prend soin d’évacuer toute analyse psychologique qui réduirait son personnage à quelques traits de caractère où il perdrait la densité de son énigme, ou en ferait au pire un cas « pathologique ». Le narrateur s’en tient à détailler ses attitudes et ses gestes, à rapporter ses phrases, souvent lapidaires et cyniques. Ce qui nous apparaît assez rapidement, dans ce récit, c’est qu’Olivier nourrit envers sa sœur des relations suspectes, une espèce d’amour convulsif et morbide, au-delà de ce que tolèrent d’ordinaire les liens fraternels. « Et même, ajoute D. Gombert, au-delà du sensuel. Inceste ? Terre du tabou. Il est peu d’auteurs qui ont su exprimer si fortement la rage des amants. » Il y a, en effet, çà et là, qui jalonnent ces pages, des échanges de gestes entre frère et sœur, des caresses furtives, des baisers qui se veulent chastes, une nuit partagée dans un hôtel désert, autant de scènes qui s’avancent sur le fil de l’interdit et dégagent toujours un étrange malaise. Au fil des pages, où ne se passe rien, si peu de choses, des séances de plage, des excursions en bord de mer, des soirées désœuvrées passées, comme on dit aujourd’hui, à « faire la fête » entre jeunes, Olivier, en diabolique manipulateur et chef de bande « naturel », qui divise « négligemment » pour mieux régner sur tous, en séducteur qui ne veut pas se laisser prendre aux pièges de la séduction, mettra tout en œuvre, et sans avoir l’air d’y toucher, pour empêcher l’union de sa sœur avec Pierre, même s’il doit pour cela se fâcher à mort avec lui. De quoi souffre Olivier, qui tenaille ses chairs, laboure son esprit ? Jalousie maladive à l’égard de Pierre, son « meilleur ami », amour coupable envers sa sœur, désirs inavoués qu’il s’efforce de réprimer, désir aussi peut-être de détruire en l’autre l’objet de ses souffrances et désir, qu’on devine, de s’oublier lui-même dans la mort… ? Le récit entretient ce mystère sans jamais y répondre de manière définitive. Même les derniers mots du livre ne nous livrent rien de certain, on ne voit qu’Olivier marcher vers le bord de la falaise : « En bas la marée montante recouvre à chaque vague les rochers. Se peut-il que cette mer si pure, si lissée, lassée de soleil – cette mer tant aimée… ? »
Il y a sans nul doute quelque chose de Jean-René dans le personnage d’Olivier. Julien Gracq, dont il fut l’élève, nous décrit ainsi ce jeune homme aux allures un peu ténébreuses, quelque peu différent de ses autres disciples : « … il avait une physionomie, je me rappelle très bien qu’il tranchait sur les autres – d’abord par une espèce d’aisance physique, et puis un certain détachement coupant. C’était une personnalité, qui devait en imposer à ce groupe. » Jean-Edern Hallier, l’un de ses camarades de classe, débarquant dans la cour du lycée Claude-Bernard où Huguenin régnait sur ces adolescents d’Auteuil, fils de bonnes familles, l’évoque aussi dans ces termes : « Tout de suite, je remarquai Jean-René, plus grand que les autres, et aussi le plus entouré. Il émanait de lui une autorité indéfinissable, surnaturelle. C’était le chef, ou plutôt le jeune maître de vie. » Et Jérôme Michel, dans son ouvrage Un jeune mort d’autrefois, complète ainsi le portrait : « Jean-René distribuait ses faveurs selon son bon plaisir, recevait les hommages qu’il n’avait pas demandés. Beau, élancé, à l’aise en tout, il était l’archange blond font tous étaient inconsciemment amoureux, le petit prince que tous voulaient servir. » Comme Jean-René aussi, qui pratiquait la boxe, parce que le combat de la vie exige que l’on donne des coups et que l’on sache en recevoir, Olivier est sportif et nage mieux, plus loin que tous les autres. Et comme lui encore, il mène la danse dans ce groupe d’amis auxquels il dicte la plupart des décisions et dont il règle le tempo en imposant, même dans ces jours de farniente, des « plans d’action » qui obéissent à on ne sait quelle urgence. Aller plus vite que le temps qui passe et coiffer la mort au poteau ? Enfin, presque comme Jean-René, qui avec sa sœur Jacqueline entretenait une relation privilégiée, Olivier voue à la sienne, Anne, un amour exclusif…
Evidents parallèles, nous nous en tiendrons là, entre l’auteur (qui, on l’a vu, adolescent « se la jouait » James Dean des beaux quartiers) et la créature qu’il tire de sa propre substance, et qui ne doivent pas nous étonner puisqu’on sait que l’auteur est toujours dans son œuvre qu’il nourrit de lui-même. Ainsi, nous le voyons chez Huguenin, l’auteur, dans ce mélange de panache et de mélancolie, comment s’ébauche le portrait d’un personnage romantique, un jeune homme qui pressentait que l’entrée de l’Occident dans l’âge du nihilisme signait « la fin d’un monde », et ne semblait pourtant pas prêt, dans ce qu’il éprouvait de révolte contre la trahison du temps, à renoncer à l’idéal, ni à l’amour, ni à l’enfance, et n’était nullement prédisposé au consensus. « Intransigeance, colère, impatience, nostalgie de la grandeur et soif d’absolu propres à la jeunesse » écrit Bruno de Cessole en avril 2013( in Valeurs actuelles), posture de jeune premier romantique certes, mais marquée du sceau de l’urgence, du sentiment tragique de la précarité et animée du sentiment bernanosien de ne pas se dérober à son « devoir d’insurrection ». Voilà qui explique en partie pourquoi Jean-René Huguenin, habité par la mélancolie brûlante des enfants privés d’histoire, était plus proche dans ses positions morales, esthétiques et romanesques, de Bernanos, Mauriac (qui l’a adoubé) et Nimier que du sillon intellectuel qu’allaient tracer Tel Quel , les défenseurs de « la nouvelle gauche » et les tenants d’une avant-garde dans laquelle il ne pouvait ni se situer, ni se reconnaître. Et il écrit dans son Journal qu’il voulait être « la Force, la Résolution et la Foi », ou encore « Il est clair que je n’ai pas ma place dans ce monde, parmi ma génération, au sein de cette civilisation. Je vais écrire quelques romans, et puis j’éclaterai comme un feu d’artifice et j’irai et j’irai chercher la mort quelque part ». Mais il y pousse aussi ce cri d’une âme blessée par l’image d’un monde qui ne peut être que désespérance mais qui nous est la seule planche de salut : « Je mourrai en croyant que tout pouvait être sauvé ». C’est Jean-Paul Enthoven (Le Point, mai 2013) qui résume le mieux, non sans quelque ironie pourtant, ces positions et la fulgurance de ce parcours : « Huguenin, bourgeois antibourgeois, est sympathique et séduisant; il veut se cambrer comme Bernanos dans une France gouvernée par René Pleven; se fabrique une bande de copains (dont Jean-Edern Hallier, son double malfaisant); participe à la création de Tel Quel (mauvaises relations, d’emblée, avec Sollers); s’énerve devant l’avachissement national et la guerre d’Algérie; étoile filante, il possède sur le champ la panoplie complète d’un Grand Meaulnes en colère et vaguement hussard. «
Cette approche, un peu trop sommaire que nous avons faite de l’auteur et de l’œuvre, nous invite à lire cette dernière avec un regard autre que celui de la seule lecture romanesque. Au-delà de l’histoire concernant le trio Olivier, Anne, Pierre, par superposition, et métaphoriquement, une vision morale s’impose, celle d’une humanité en perte de repères et d’un monde qui se défait, un monde où la valeur des sentiments ne peut que sonner faux et où l’amour n’a plus sa place, sinon celui de la Chevalerie qui interdit aux corps de se toucher, fait de la chasteté l’Idéal absolu où se reconnaissent les âmes pures, les êtres délestées du poids de toute hypocrisie sociale.
Roman de facture « traditionnelle » (malgré le choix d’une structure narrative qui joue avec talent des raccourcis et des ellipses pour créer des effets de « fondus enchaînés », mais aussi des effets de rythme, accélérations, ralentissements ou « arrêts sur image »), La Côte sauvage n’est peut-être pas une œuvre majeure, mais s’inscrivant dans l’héritage de Mauriac, elle privilégie le style sur la technique, sait capter l’essentiel, ces secrets qui nous constituent, distille un charme vénéneux qui en fait une œuvre attachante, même plus, importante.
Michel Diaz
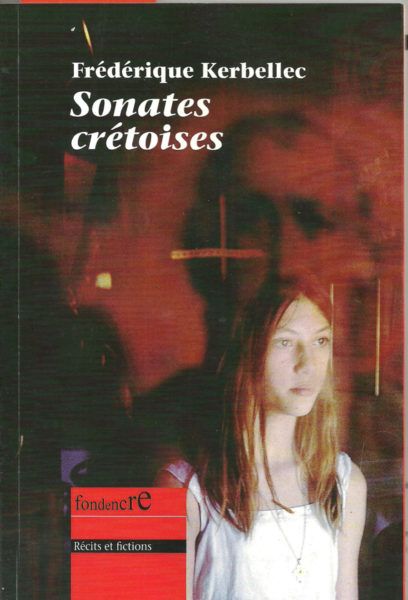 SONATES CRETOISES – Frédérique Kerbellec
SONATES CRETOISES – Frédérique Kerbellec