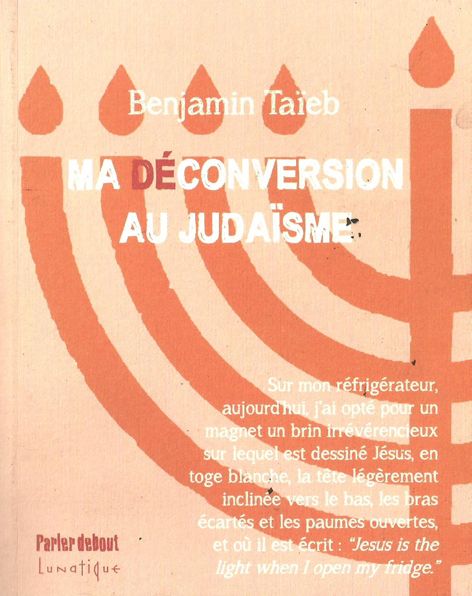« Les mots savent de nous ce que nous ignorons d’eux. » (René Char)
De temps à autre, je « chronique » des livres que j’ai aimés, ceux qui m’ont procuré un plaisir de lecture et ceux qui, à mes yeux (ce sont souvent les mêmes), valent la peine qu’on les décortique un peu et qu’on y aille voir « un peu plus loin ».
Il y a quelques semaines, je commettais une nouvelle note de lecture à propos d’un recueil poétique *. Voici ce que j’en écrivais:
« Le recueil d’A. Y., Des jours à tes côtés, petit livre de 37 pages, est composé de poèmes brefs, d’une dizaine de lignes au plus, à l’écriture sobre et fluide, presque minimaliste dans son dépouillement. Pas d’effets stylistiques ici, d’images ambiguës à interprétations variables, de métaphores funambules et de tournures réticentes à s’ouvrir à qui s’avance dans ces pages:
des crépuscules
des nuits
des jours et des nuits/
avec
sans
gorgés de sens/
des saisons
des aubes de neige
des midis au zénith
Jours, saisons, années, cycles des heures, ramassé fulgurant des repères chronologiques, ceux qui scandent nos existences, en sont la basse continue et la ligne obstinée. Nous voici, dès les premiers mots, confrontés au Temps et à l’exercice si difficile de la mémoire. Pas de la nôtre, mais celle de l’auteure, de ce qu’elle doit conserver, l’écume des jours et des ans, et de tout ce encore qu’elle ne peut délivrer au lecteur que dans le creux des mots et le blanc de la page, ce qui ne sera pas écrit et ne pourra pas l’être, mais le sera pourtant, dans la vibration du silence, comme se prolonge le bruit de l’écho bien après qu’il s’est tu:
tous les trente six du mois
cent ans de dimanches
côte à côte/
près
très proches/
contre à contre
au septième ciel
sur un petit nuage
Images claires de bonheur. De moments partagés, dans le plein de ce qu’offrent les jours et dans ce qui, parfois, s’écorche à leurs arêtes. Pudeur qui se contente d’évoquer l’amour sans d’abord prononcer le mot.
Et c’est bien cela, en effet, qui se dit, dans le ressac de la mémoire, la pulsation des jours, battements de la vie qui passe, et vers quoi il faut tendre l’oreille. Car on n’écoute jamais mieux, nous le savons, que ce qui se murmure, qui impose qu’on fasse silence, en soi et autour de soi, pour mieux le recevoir. Cette simplicité dans l’écriture n’est pas facilement donnée à qui essaierait d’en user. Il faut être une auteure sûre de ses moyens, pour parvenir ainsi à évider le texte de tout mot inutile, à le réduire à l’os de l’expression, tout en préservant, dans le même creuset poétique, gravité du propos et qualité de l’émotion.
Il faut dire aussi que l’enjeu de ce texte n’était pas mince: quelques pages pour y faire tenir une vie, regrets et joies mêlés, bonheurs et peines enlacés, blessures sitôt oubliées et plaisirs minuscules des jours, l’essentiel que l’on doit retenir quand on fait le bilan des années. Et que l’on doit restituer du bout des lèvres, comme l’on se parle à soi-même, en s’efforçant d’être au plus juste et au plus près de ce qui monte dans la voix, souvenirs comme en vrac, tout en ellipses temporelles, mais autant de points de couture posés là où il faut dans le tissu flottant de la mémoire:
on se donne des petites choses
des bouts de rien
du bout des doigts/
les étoiles émerveillent
Ces quelques mots, tout simples, comme posés du bout des lèvres, disent bien, en effet, l’émerveillement que l’on peut éprouver, quelquefois, de sa seule présence au monde et de ce bonheur ordinaire que nourrit la présence de l’être aimé. Ou qu’elle a nourri
Car, en effet, nous le saurons très vite, dès les pages suivantes, ce recueil est texte de deuil, hommage à une absence, déambulation dans la solitude obligée du poème dans la compagnie d’un fantôme. Cette nudité d’écriture peut toucher d’autant plus qu’elle est dense de présence humaine, qu’elle charrie une douleur paisible, d’une voix basse et retenue, comme un chuchotement de confidence qui nous saisit d’emblée au cœur. Douleur qui, au-delà de celle qui l’exprime, fait écho à ce qu’il y a en nous de plus intime et de plus partageable: le chagrin de la perte, le vide de l’absence, la nostalgie de la présence disparue, la vie qui continue pourtant et à laquelle il faut continuer à croire, à donner quelque sens.
Douleur « paisible », car la traverse une mémoire qui, comme la lumière le fait sur un prisme, décompose le spectre des sentiments et en révèle les couleurs, quelquefois les plus vives. Toutefois l’ombre gagne, comme dans cette page, la dernière, si chargée d’émotion contenue:
tu t’absentes
tu manques au monde/
au cyprès
au mimosas
à la voussure du ciel
aux bateaux en partance
aux étendues
au grain du vent
aux symphonies de Beethoven/
à mes yeux
orphelins «
Tutoiement au-delà de l’absence, présent d’éternité, comme on continue parfois de parler à ces présences invisibles qui nous accompagnent dans nos jours et nos nuits. Ces pages ne pouvaient être écrites que sous la lumière de la mélancolie. Lumière qui peut être sombre, avare de clarté, complice de la mort, ou clarté douce, bienveillante et amie. Cette lumière-là est celle que fréquentent volontiers les poètes, un espace de mi-pénombre offert à la lucidité de leur questionnement, d’eux-mêmes et du monde. Lumière dans laquelle la douleur, tenue à sa juste distance, se fait territoire fertile où vient puiser ce qui persiste de l’amour, et où s’alimente la source de la création. De toute création peut-être.
Ce qui importe, dans la parole poétique, c’est la justesse de la voix, un timbre qui s’impose, une musique qui, en nous, fait son chemin, même après que l’on a refermé le livre. Ce qui nous accompagne, plus loin que la lecture et nous aide un peu plus à comprendre et à vivre. Comme ce qui nous revient, par exemple, des mots d’A. Y. ceux-là, entre autres, que l’on n’avait rien fait pour retenir,
et nous infatigables
épaule contre épaule. »
* * *
Voilà donc ce que j’écrivais dans cette note de lecture à propos de ce livre.
Cependant, quelque peu contrariée par ce que j’en avais compris, l’auteure du recueil m’a vite fait savoir que « l’absent » était bien vivant et qu’il n’y avait dans son texte, m’écrivait-elle aussi, « nommé, seulement nommé, ce qui fait l’absence des choses, parfois celle de l’aimé, le temps qui passe, les menudailles de l’ordinaire », ajoutant que c’était là « une écriture de l’épure, dans la forme, dans la langue », et que « les séparations, les retours, les pertes, sont du côté de la vie. » Non, elle n’adhérait pas à ce que j’en avais écrit, son texte n’était que de « gaieté », seulement de « gaieté ». Je répondis que ma lecture ne contenait pas de grossier contresens, que ce que j’en avais compris ne pouvait qu’ajouter une autre dimension à son ouvrage, comme ce qui d’abord échappe à l’esprit de tous ceux qui écrivent, cette obscure part de sens que tout auteur met dans ses livres sans toujours en avoir conscience, mais qu’un regard critique s’offre à lui « révéler », Mais l’auteure déjà s’agaçait, elle ne pouvait pas accepter mon regard sur son livre, l’air se chargeait d’orage, l’éditrice était alertée, en très inconfortable position d’arbitre, prise entre deux auteurs qu’elle prend soin de publier, et il lui fallait au plus vite apaiser l’écrivaine.
Dans ce livre, il ne fallait donc voir que « gaieté » ?… Soit. Pourtant je n’y vois pas cette « gaieté » revendiquée, mais plutôt (confirmée par ma relecture), une sorte de lamento sur le bonheur passé. D’autre part, il me semble que l’interprétation d’un livre appartient à celui qui le lit et que l’auteur n’a pas à se mêler des impressions de son lecteur pour infléchir (encore moins lui imposer) son point de vue. L’auteur(e) qui publie s’expose consciemment au regard de ce même lecteur qui lira son ouvrage selon sa sensibilité, ses outils d’analyse, le poids de son vécu (avec ce qu’il pourra, ou devra, en tout cas justifier), et y posera son jugement en toute liberté.
Et à propos de celui-ci, quelle contradiction nous faudrait-il arbitrairement (et absurdement) entretenir entre bonheur présent et nostalgie de son bonheur passé, entre joie et mélancolie ? Ne peut-on pas rire à travers son chagrin et pleurer à l’évocation de bonheurs perdus dont notre cœur s’emballe encore ? Et cette évocation, se voulût-elle lumineuse, et douce, et apaisée, toute dédiée à la vie, n’est-ce pas aussi, en dépit de la volonté de l’auteure, celle de ce temps qui a été, ne sera plus, dont on peut s’enchanter encore et conserver le souvenir radieux, mais qui est pourtant ce que le cours des jours nous a définitivement ravi ? En écrivant ce qui précède, je repense à ces vers du poète Adonis:
Le pays dont nous étions/ le pays dont nous sommes encore/ ils ne sont que le même/ cet horizon blessé par des paupières timides/ et celui qui brûle nos cils…
hier j’ai eu faim de lui/ et j’ai dessiné en son nom/ un portrait, une auréole/ Je lui ai écrit une lettre pour lui rendre hommage/ Mais toute lettre écrite/ en souvenir de ce qui fut/ en hommage à ce qui en reste/ est toujours une lettre d’adieu/ à ce dont nous devrons prendre congé
Peut-on mieux dire que cela pour comprendre le sens de ma lecture ?
La richesse d’un texte tient à sa capacité de s’ouvrir à de multiples interprétations, fussent-elles contradictoires. Celui-ci le permet, et il est toujours bon qu’un livre suscite des confrontations d’idées.
Le rôle du chroniqueur, s’il fait bien et honnêtement son travail, est d’ouvrir un ouvrage à ses autres possibles lectures et d’en examiner les strates, non de s’en tenir au « mode d’emploi » proposé par l’auteur(e). Et s’il lui arrive le mettre le doigt sur des zones sensibles du texte, ce qu’en a refoulé son auteur(e), doit-il alors faire silence, mettre une pierre sur sa bouche et son papier à la corbeille ? Ne serait-ce pas plutôt à l’auteur(e) d’assumer ce qu’il ou elle a écrit (avec ses conséquences) et de travailler à résoudre le nœud de son problème ? Celui, ici, en l’occurrence, de ne pas accepter de son chroniqueur qu’il débusque, dans ces zones d’ombre, ce quelque chose de l’insoutenable qui s’y trouvait tapi et que l’auteure, pour le confort de son esprit, et s’aveuglant sur ce qu’elle a écrit, se refuse à envisager en faisant obstruction à un autre regard que le sien ? Sur un ouvrage qui, rappelons-le, menant sa propre vie, ne lui appartient plus ?
Car, enfin, si l’auteur d’un ouvrage se contente de l’évocation sentimentale et toute personnelle de ses bonheurs passés et de ses menues peines, c’est qu’il n’a rien à nous dire, il se raconte, mais ne nous touche pas. L’ambition de la poésie est plus vaste, elle est de tendre vers l’universel et, dans le cas de ce recueil, l’universel serait de nous proposer de nous confronter à notre propre mémoire et à ce qui, en nous, regarde du côté de la nuit. Ce livre-là le fait, pour peu que nous lui accordions notre confiance, et que l’auteure, de son côté, lui accorde la sienne. Ce que l’on écrit, souvent, nous trahit, du côté que l’on n’avait su voir, et l’écriture de la poésie c’est aussi, c’est d’abord et surtout, prendre le risque de ses mots, accepter de les mettre en danger, et soi-même avec eux.
Michel Diaz, 26/02/2018
* Je me contenterai des initiales du nom de l’auteure, omettrai aussi de signaler le nom de la maison d’édition, à seule fin de n’embarrasser ni l’éditrice, ni une écrivaine qui se refuse à jouer le libre jeu de la critique (une critique qui, au demeurant, ici, n’était pas avare de compliments à l’égard de son livre et se proposait de lui apporter quelque chose qui en densifiait le propos !).
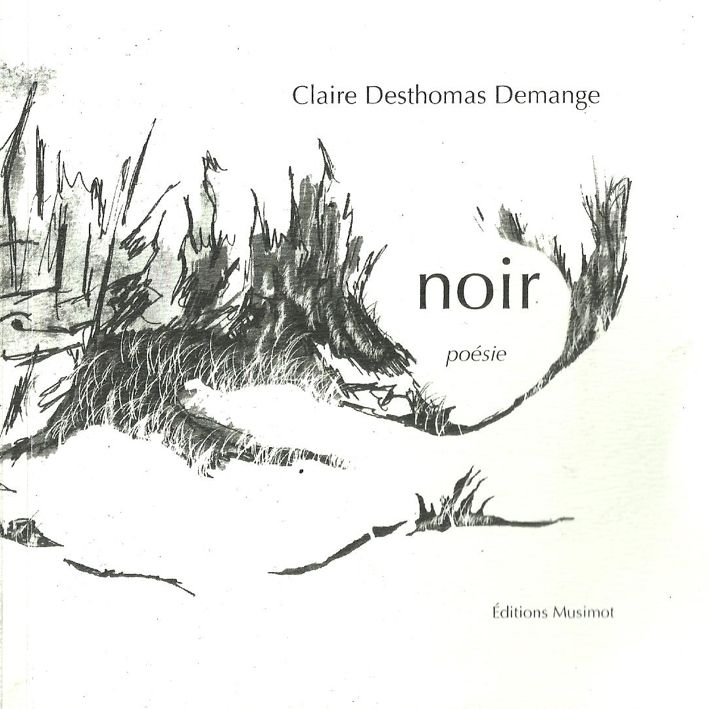 NOIR, Claire Desthomas-Demange, éd. Musimot (2017)
NOIR, Claire Desthomas-Demange, éd. Musimot (2017)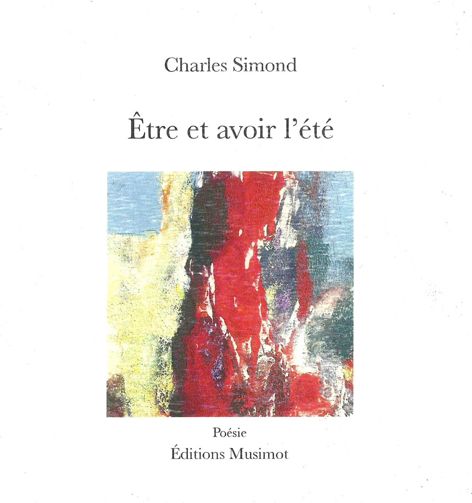

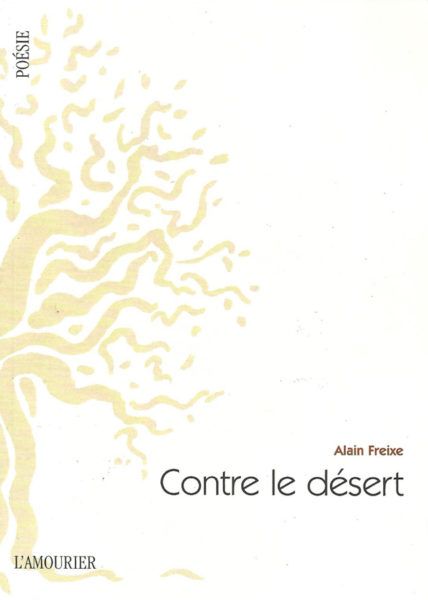 Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017
Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017