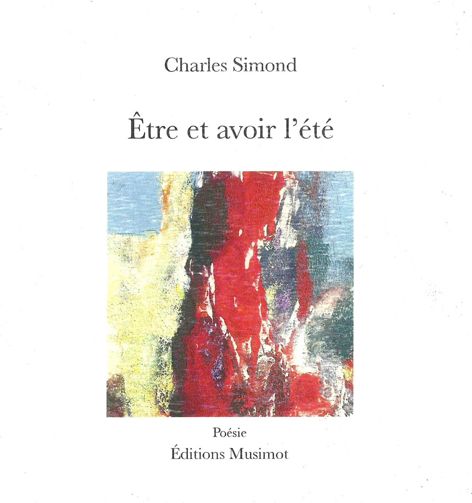ETRE ET AVOIR L’ÉTÉ – Charles Simond
Editions Musimot (2013)
Dans son très court recueil (à peine plus de cinquante pages composées de poèmes brefs à l’écriture lapidaire), Etre et avoir l’été, beau titre lourd de sens pour peu qu’on veuille bien s’y attarder, Charles Simond rend hommage au soleil triomphant et au bleu victorieux de l’été, au ciel saignant d’une lumière qui se noie dans cet inexorable monochrome, ciel insensé qui, quelquefois, suffoque, dépressif, entre deux agressions de gris, orages de saison dont la violence nous lave et nous rend à la pureté. Et en cela rien d’étonnant puisque Apollon, ce dieu de la Lumière, et identifié au soleil, est aussi dieu des purifications, autant celles du corps que celles de l’esprit.
Mais l’été, dans ce texte, c’est d’abord, impératif et maître de ses feux conjugués, midi l’exact (formule derrière laquelle on devine Paul Valéry), sa présence écrasante au zénith de ses feux, et ce poids vertical de lumière dont s’ossature sa géométrie solaire, celui d’un monde en équilibre qui tient ses deux plateaux, lumière et ombre, en égale faveur: les ombres accueillantes de l’été ne valant que par l’ardeur d’un feu dont le règne ignifie toute chose et l’épuise, comme ces arbres sont vaincus et exsangues ces pierres qui, sous le ciel, gisent comme des cadavres. Brûlure qui aveugle comme aveugle la certitude où se consume la raison et où s’égare tout repère. Et c’est encore, ici, le souffle de l’esprit apollinien plutôt que dionysiaque qui traverse ces pages où comme l’écrit Charles Simond,
la quadrature du bleu
m’encercle dans l’énigme.
Etre. L’auteur ne pose pas moins, en ces quelques mots qui précèdent, avec l’air de ne pas y toucher, que la question de notre relation au monde qui induit celle de l’être et de ce qui, sous les pleins feux du jour, implique de profonde remise en question. Ainsi, plus loin, quand il évoque le monde comme une équation à nœuds inconnus, on ne peut s’empêcher de penser à ce qu’écrivait Nietzsche à propos de ce que l’héritage de l’esprit apollinien lui inspirait: « Nous éprouvons une jouissance à comprendre directement les formes (…). Pourtant, même quand cette réalité de rêve atteint sa perfection, nous éprouvons le sentiment confus qu’elle est apparence. Telle est du moins mon expérience (…), comme le confirment maints témoignages et maintes déclarations de poètes. Un esprit philosophique a même le pressentiment que, sous la réalité où nous vivons, il en existe une autre, cachée, et que notre réalité aussi est une apparence.«
Faut-il alors douter des apparences dont la lumière nue du jour forge et souligne l’illusion ? La réalité à laquelle nous nous référons, sans toujours voir au-delà d’elle, serait-elle mirage de l’esprit abusé par ce que la lumière semble nous assurer comme certitude des sens et de l’esprit ? Car nous savons bien, et Platon ou Pascal nous l’ont déjà dit, que d’une part les images sensibles sont mouvantes et donc rationnellement inconnaissables, et que d’autre part elles accrochent et séduisent la pensée en excitant les désirs à l’infini jusqu’à la frénésie violente. Ainsi, notre perception du réel, soumise d’abord à nos sens, et relayée par le travail de la raison et de notre imagination, produit-elle des images d’objets absents ou inexistants qui nous enchaînent à nos désirs sensibles chaotiques et contradictoires. Mais c’est encore de la lumière incendiaire d’été que naît l’ombre sous les noyers, elle-même refuge dont on peut douter qu’il soit vraiment propice à apaiser nos yeux, à nous aider à rétablir la vérité des choses puisque cette ombre, dit l’auteur, est elle aussi l’illusion noire où je m’engouffre.
Pourtant l’ombre, comme la nuit, n’est-elle pas aussi porteuse d’une bonne part de la vérité déguisée ordinairement sous le masque des apparences ? C’est ce que l’on devine, d’expérience aussi, puisque
l’ombre
comme une moisissure
si sûre de sa nuit
si sûre de la nuit assidue et complice
ronge déjà le mur de lumière qui doute
sous le soleil écarquillé.
Et le poète annonce, quelques pages plus loin, que
dans la courbure du jour
l’ombre marginale
attend sa messe noire.
Avoir l’été. Mais la deuxième partie du titre de ce texte (sous la forme d’une apparente boutade) nous invite à une autre réflexion, et pas moins importante que la première. Ce qui est convoqué ici, c’est avant tout la nostalgie d’un paradis perdu, celui propre à l’enfance et à son insouciance, aux premiers émois du désir, ce qui ouvre à la perte d’un temps d’innocence dont on ne se remet jamais, ce regret douloureux de
mon enfance morte
en été
entre les attentes de foin
et les attentes de femme
déjà
de mes cousines pré-pubères
Perte où s’inscrit la marche vers la finitude, où le sentiment d’être au monde et en son éternité de lumière bascule vers la nuit, où le soleil en son zénith, dans un ciel sans miracles, devient le soleil sombre d’une abrupte mélancolie, et celui, plus noir, de la tragédie de vivre et de devoir mourir:
ce lointain été
calciné d’oubli
braise de mémoire
refusant cette mort
(…)
pour dire à hurle vent
à hurle mots vivants
l’été de chair de cette enfance
sous le masque mortuaire
Certes, dans ce recueil, on perçoit les échos d’une sensualité à fleur d’être, des rumeurs de bonheur, des instants fugitifs où le pain est bleu sous la voûte du ciel, où est dite en trois vers l’allégresse du blé, où les cigales (même celles d’après Fukushima) poursuivent dans les arbres leurs stridulations lancinantes, où les branches de chêne / entrelacées de nuit tamisent les étoiles, où s’exalte l’insolente certitude du thym, où la présence de la femme (le mille-feuilles à la framboise / de (son) sexe éventré), invite autant aux spasmes de l’amour qu’aux voluptueux plaisirs de la sieste, mais de ces cendres de mémoire naît une profonde musique qui ne peut que nous saisir au cœur.
C’est de cette nostalgie, traduite dans une écriture où chaque mot s’efforce de sonner clair et juste, que la poésie naît ici. Poésie grave et dense dans son ramassé d’images, où les hommes silencieux / arpentent l’hiver de leurs souvenirs, d’où l’on revient passablement meurtri. Car, en effet, dans ce livre on tutoie le tragique sous une lumière solaire telle que la mort qui rôde, plane et s’incruste dans l’angle obtus du ciel, n’est là que pour entretenir le sentiment que nous pouvons avoir d’appartenir et de participer au miracle de l’existence.
Mais le rôle de la poésie n’est pas de rendre les hommes heureux, il est juste (et c’est déjà beaucoup) de les rendre plus humains. Rendre quelqu’un plus humain, c’est lui donner la capacité de pouvoir se saisir comme mise en question de sa propre existence. Cela, la poésie le peut, qui sait libérer et tenir cet « inconnu devant soi », comme l’a écrit René Char.
Et Charles Simond, dans la sienne, nous prouve qu’il le peut aussi, comme il sait encore que la poésie doit être un « feu de voix » voué à tous les vents du vivant, à ses énergies, ses vertiges, et en dépit de cet implacable constat qui ouvre ce recueil, cette évocation désolée de ce
printemps en cendres
offert en holocauste
aux premiers feux d’été,
un feu voué aussi à ses opiniâtres surgissements.
Michel Diaz. 04/12/17