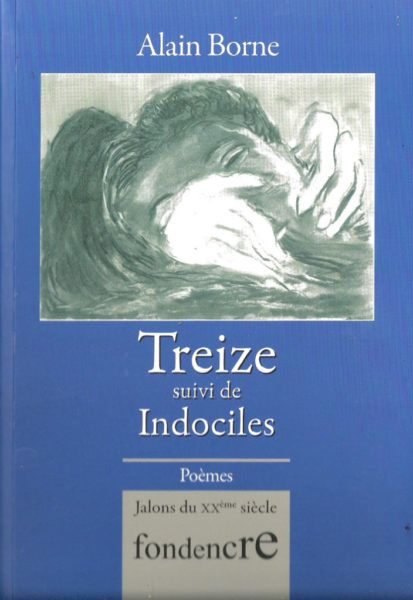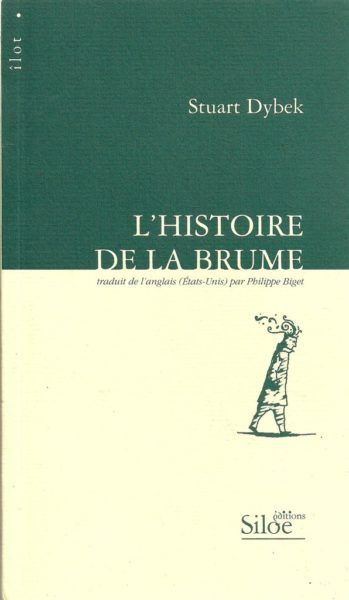 L’HISTOIRE DE LA BRUME
L’HISTOIRE DE LA BRUME
Stuart Dybek
Editions Siloé (2008)
Traduit de l’anglais et présenté par Philippe Biget
Chronique publiée dans le N° 48 de la revue Chemins de traverse (juin 2016)
« Né à Chicago en 1942, dans une famille d’origine polonaise, Stuart Dybek enseigne la littérature et le cinéma à la Northwest University de Chicago.
Bien qu’encore peu connu en France, il est considéré aux Etats-Unis comme un grand nouvelliste. Pour l’une de ses fictions, il a remporté le fameux O. HENRY AWARD (1985) et, en 2007, pour l’ensemble de son œuvre, deux prix d’importance nationale, le MAC ARTHUR FELLOWSHIP et le REA AWARD. » (4ème de couverture)
« The Story of Mist, ici présenté sous le titre L’Histoire de la brume, a été publié en 1993. Il s’agit d’un recueil exclusivement constitué de textes courts, parfois des poèmes en prose, des fragments insolites influencés par notre surréalisme ou des histoires de forme plus conventionnelle. Mélange intentionnel car, bien que chaque texte se suffise à lui-même, leur juxtaposition permet d’associer le lecteur à la composition, le laissant établir les relations de son choix entre différentes pièces du recueil. Susciter une lecture interactive, comme un rêve attend un rêveur, pour reprendre une formule extraite de « Brouillard », voilà bien l’une des ambitions de l’auteur. »
Comme l’écrit encore le préfacier, « ce qui cimente les agrégats disparates, c’est leur genèse, souvent fruit de flashs mémoriels. » Le regard du conteur, attentif à décrire parfois les détails les plus anodins (en apparence) de la réalité, comme, par exemple, les couleurs et l’étrange géographie d’une contusion sur la chair d’une cuisse, s’applique à estomper les frontières entre rêve et vie éveillée, entre songerie et observation attentive, entre souvenirs véritables et scènes reconstituées selon les caprices de la mémoire, comme s’il doutait que ce fussent là deux mondes qui s’ignorent ou, en tout cas, auraient leur mode propre de fonctionnement.
Ainsi nous maintient-il, de page en page et d’un texte à un autre, dans cette ambiguïté qui nous fait douter de la valeur et de la vérité de nos perceptions sensorielles. De même, son travail sur ce que la mémoire nous restitue d’entre le chaos de nos souvenirs, images fragmentaires et lambeaux de scènes vécues, qu’on pensait oubliées, « peut l’amener à retracer les mouvements de conscience les plus subtils, ce magma de pulsions en apparence dénué de sens mais qui forment, nous le savons bien, l’essentiel de notre vie intime. »
Enfin, la langue de Stuart Dybek, qui mêle étroitement des éléments de prose narrative, descriptions minutieusement réalistes et pure poésie, est de celles qui déposent sur nos lèvres les échos d’une savoureuse et subtile musique et, dans l’esprit de son lecteur, ce trouble dans lequel nous laissent, comme chaque fois qu’on nous y renvoie, le mystère des êtres et l’énigme de vivre.
Ainsi, ces lignes où Dybek se contente de nous décrire un homme en train de se raser devant sa glace : « Un homme se rase, avec précaution, à petits coups afin de compenser l’instabilité de sa main. […] Contrairement à son père, l’homme ne s’est jamais coupé au cours des nombreuses années pendant lesquelles il a perfectionné l’art de se raser de plus en plus près. Mais ce matin, alors qu’il rince les restes de mousse, son visage a disparu. Le miroir ne reflète plus qu’un sourire qui ressemble plutôt à une grimace, un sourire qui serait le dernier vestige d’une plaisanterie, et qui reste en suspension comme une fumée là où la nécessité d’un avenir s’est effacée. »
L’ayant lu, nous pouvons rejoindre sans mal Alice-Catherine Carls qui, dans une note de la revue Poésie/première, écrit que « magicien des mots, des images et des dialogues, Dybek les fait résonner dans la mémoire du lecteur où ils forment des passages souterrains propices à un ancrage/encrage durable. » Un ancrage dont seuls sont capables les textes qui, nous approchant au plus intime de nous-mêmes, nous confrontent à nos vertiges.
Michel Diaz. 01/04/2016
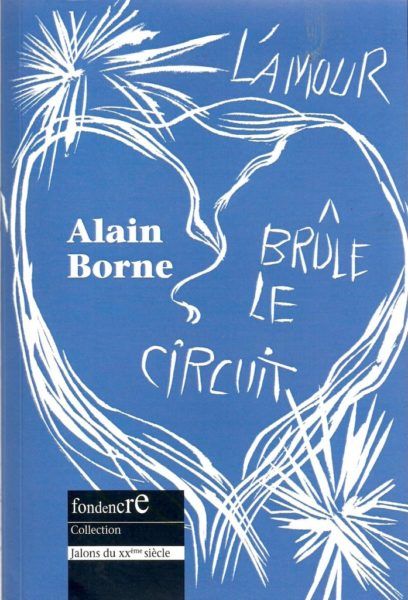 L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT
L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT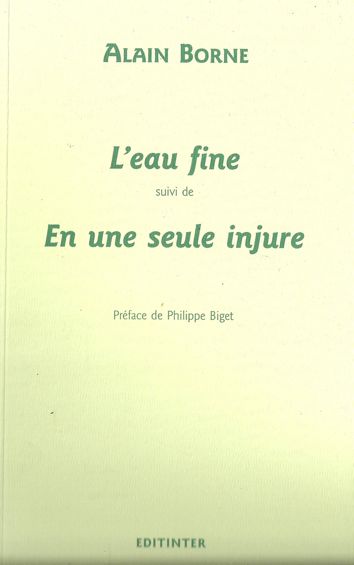 L’EAU FINE suivi de EN UNE SEULE INJURE
L’EAU FINE suivi de EN UNE SEULE INJURE