 DE SANG, DE NERFS ET D’OS – Patrice Blanc
DE SANG, DE NERFS ET D’OS – Patrice Blanc
Editions Le Contentieux (2018)
Chronique publiée dans le N° 75 de Diérèse
Ce recueil, De sang, de nerfs et d’os, nous met en garde, dès son titre: cette poésie-là, écrite dans l’à-vif des mots, des mots qui entrent en découverte/de la craie de vérité, n’est pas de celles qui ménagent leurs auteurs, pas plus, par voie(x) de conséquence, qu’elles ménagent leurs lecteurs.
Attendus,/prétendus,/les mots (en) verbes et (en) actes/(en) images et (en) fuites…/descendent/boire à la source/au nez//du poème//la courroie se délie/le poème s’exerce//et tire sur la vie/bravant la mort… Ainsi commence ce recueil, comme une déclaration d’intention qui se propose « d’en découdre » avec le langage et d’engager le corps physique, bouche, dents, crâne, poumons, vertèbres, nerfs et sang, de les mettre en scène et en acte sur l’arène de l’écriture. Corps et âme ne faisant qu’un, chair et souffle mêlés dans leur affrontement au verbe. Corps à corps annoncé, Les mots//en réussite ô charrette d’obstacles//balancent l’antidote/dans l’oracle perdu/de tes ongles/en chair//de l’eau de mes os
Aux lecteurs frileux de poésie, il faudrait dire: les poèmes de Patrice Blanc ne vous prennent pas par la main, ils sont hérissés d’épines et de clous, ouvrent des fenêtres sur l’ombre et des brèches sur le silence, ne leur résistez pas, laissez-vous transpercer de leurs mots, laissez-vous donc atteindre par les éclats de cette rage poétique et ses bourrasques de tristesse, ciel en croix/cœur naufragé//c’est la mort qui danse car, peut-on lire plus loin, les hommes sont veufs, sans mémoire/la lumière est cassée dans le ciel. Laissez-vous perdre pied, abdiquer certitude et raison, dans ces béances d’ombre et ses remous, happer vers ce qui s’ouvre, là-bas, plus loin, et fuit toujours devant, dans ce que la parole creuse et met à jour, son perpétuel inconnu, quelque chose de l’insondable en quoi se reconnaît la poésie, nuit dans la nuit de la parole, son véritable cœur battant, ce qu’on ne peut réduire ni atteindre, cet espace de découverte aux limites toujours repoussées, ce réel intérieur d’impossible saisie. Et Patrice Blanc nous dit cette quête insensée de la parole poétique dans un poème en prose: Le poème est un animal boiteux qui tourne en rond. J’ai soif d’animaux boiteux. J’ai envie de tourner en rond un homme-poème qui marche devant sa vie; qui châtie les mots de sa vie. J’ai faim de poèmes boiteux qui exaltent la richesse intérieure du vide et du temps. Et il ajoute, dans ce même texte simplement intitulé Prose et qui pourrait être son « art poétique »: La ronde flottante des mots dessine le poème dans la baignoire aux aiguilles transparentes, aux olives vagissantes. Le poème se fait rond de l’archer qui déloge nos yeux; qui déroule ses tissus fuligineux de prairies bondées, enflammées d’oiseaux amers. (…) L’homme marche sur le poème à chacun de ses pas. Dans chaque rue court l’homme-poème en marchant. Les cheveux du poème sont les mots de l’homme qui écrit. Chaque poème est un homme qui avance sur ses mots.
Ces textes avancent ainsi, mot par mot, non par déroulement d’une pensée, balisée pierre à pierre, mais par poussées brutales de leurs images, comme autant d’expulsions qui viennent fracturer le sens, disloquer la logique attendue, perturber l’ordre du discours, tu es nue à la fenêtre/l’eau est amère/les morts vont dormir comme une masse. Poussées fébriles des images, comme nécessités, cassures, disjonctions, courts-circuits successifs de la langue, mais poussées des images vers ces trous de nuit à combler, ce vide d’elles-mêmes, comme la mort nous bat aux tempes entre deux pulsations du cœur, territoire d’une pensée qui fonctionne par associations fulgurantes mais toujours dirigées vers la cible, cet œil de l’en-dedans, de l’outre-jour du sens, où le poème s’accomplit. Ces mots le disent: saisir le doute//les images jetées en bouche//le vide de ce que l’on a cru//et le sang de ce que nous sommes. Comme ceux-là aussi: l’ombre aux dents/changer de bouche/monde disparu//pensée minimum/alcool des mots/tenir sur l’oreille.
Il est peu contestable, comme on le lit sur la quatrième de couverture, que la voix de Patrice Blanc est l’une de celles qui se lèvent le plus brillamment « parmi les aurores surréalistes du XXIème siècle ». Mais il est vrai aussi (et le Surréalisme transposa cette conception de « l’inspiration » sans la renier) que cette voix semble habitée de la pure « fureur » poétique, celle théorisée par Ronsard selon la théorie néo-platonicienne. Fureur qui passait, disait-on, des Muses (ou des fonds chaotiques et tumultueux de l’inconscient) au poète et du poète au lecteur, à la manière des forces de l’aimant, archaïque fureur dionysiaque placée sous l’égide du dieu des mystères et des initiations. Et tout cas il y a, ici, d’évidence, quelque chose d’une « rage poétique », omniprésente dans la fonction expressive des textes de l’auteur, expression d’une subjectivité, de celles que l’on dit « écorchées », proche de ce « dérèglement de tous les sens » ainsi que l’entendait Rimbaud: sous le couteau d’une houleuse vie/j’irai par les chemins noirs/la gorge ouverte/les jambes serrées/m’incliner sourd muet aveugle/devant l’arbre et sur la terre.
Mais à cette figure du créateur « sauvage » dionysiaque, il faudrait ajouter, plus empathique, celle que, justement, signale Jacques Lucchesi dans son introduction à l’ouvrage, c’est-à-dire celle d’Orphée. Ainsi, écrit-il, « Ce n’est pas un hasard si la nuit, entre angoisse et fécondité, revient si souvent sous sa plume. Tel Orphée, cet indépassable archétype du poète, Patrice Blanc a fait et refait le chemin vers ses propres enfers. Eurydice à jamais perdue, demeure le tombeau idéal du livre. » Et il faudrait, à ce propos, se souvenir de la manière dont Maurice Blanchot « revisite » ce mythe à la lumière de ses réflexions sur l’écriture, sur le travail de l’écrivain ou du poète qui arrache chacun de ses pas, de ses mots, à la nuit et qui, s’il se retourne, quand il se retourne, ne peut, le surprenant, que contempler en face le visage de sa propre mort. Mort obsédante, incrustée dans la chair de ces textes où la lumière vient de ces mots-mêmes qui se retournent si souvent en nuit: la mort/chante ce soir/entre les lumières/ouvertes/couvertes d’eau/et de mots/vides/qui coulent/qui coulent.
Mais il est vrai encore que cette voix est traversée par les échos des voix profondes et insoumises de Baudelaire, de Lautréamont, de Rimbaud, ces autres dynamiteurs des pensées et formes d’expression convenues, parmi celles qui hantent notre mémoire littéraire comme majeures et fondatrices de la poésie moderne. Loin Baudelaire ? Pas si loin de Patrice Blanc dont le poème La danse des chiens pourrait aisément trouver place dans la série des Tableaux parisiens du premier: au bal des trottoirs dansent les feuilles/les fenêtres s’illuminent/la rue grince le soir//sur les façades glissent les pigeons//comme un serpent le désespoir fait/peau neuve//les rires de la veille coulent dans/la nuit//au bal des trottoirs les chiens caressent/l’aube… Et pas bien loin non plus, le poète du spleen, dans ces vers: La détresse m’habite comme un cafard creuse son trou. Les fleurs ont un rire pervers qui me donne la jaunisse. Je pisse sur les fleurs et les chats qui sifflent la nuit dans mes oreilles de tout leur sang jaune, putride et maladif. La détresse m’a déjà cassé toutes mes articulations !

La sidération que provoquent les poèmes de Patrice Blanc tient à leur côté nocturne autant qu’à la faim sourde de lumière qui les ronge et les anime. L’ombre de l’aile, menaçante toujours, d’une noire mélancolie qui pourrait, on le voit, virer en tentation de la désespérance, le dispute toujours à un élan vers la lumière, la promesse de quelque salut. Car, ainsi que l’écrit Jean-Paul Gavard-Perret, « Reste la fatalité de poursuivre plutôt que de battre en retraite. (…) demeure l’espoir du souffle dans la tresse de la geste poétique. Il oblitère des impuissances et laisse la claustration en sursis dans la périphérie rauque des âmes. » Et il ajoute, dans le même article, à juste titre: « Patrice Blanc parle contre le silence de mort et la passivité. Certes, il se rapproche d’où finit le désert, où il commence: à savoir l’ombre de la nuit que le crépuscule a plantée. » Mais apparaissent çà et là les gestes de l’amour, surgissent les formes du corps de la femme, une hanche, un sein, une nuque, s’immisce le glissé des mains de la caresse: nous glisserons de nos lèvres/fruits cueillis de l’intérieur//d’où vient ton doux visage/il brûle telle une étoile//je m’attache au silence de tes yeux/à mordre ton cœur. Ou encore: ta bouche inonde ma bouche/tu es nue dans le manteau de l’air/tes seins frais de vie/et le soleil plus blanc que toi. Et cela, cette mince flamme qui dure de pouvoir aimer, le cœur au corps de l’autre, à travers eux le monde, promesse de pouvoir toucher le soleil de (ses) doigts et de cueillir le vent qui sourit, « ce n’est jamais, ainsi que l’écrit encore J.-P. Gavard-Perret, s’abandonner dans la pulpe des ultimes clartés ». Le lyrisme parfois libéré de Patrice blanc (et plus souvent qu’on ne l’attend) a aussi des fleurs dans la gorge, même si le poète ne perd jamais de vue qu’au creux de l’oubli/au bout de l’angoisse/le hasard ne brille pas.
La poésie de Patrice Blanc nous laisse le prégnant sentiment qu’elle est l’espace de travail du corps sur le langage et du langage sur le corps, investigation ardente et aveugle, tâtonnante mais sûre d’un ordre démantelé qui respire. Approche d’un inconnu sans limites dont le corps est le dernier refuge et le massif allègement. Langage qui s’expose et se dénude, attise en lui le feu d’une expression qui, d’un poème à l’autre, retrouve à s’inventer et s’étonner, comme l’amour et l’aube (qui) s’allume, par l’exaspération du noir qui le menace et, le menaçant, le recharge, tirant de ses détresses une telle vigueur d’avoir été retrempé dans ce gouffre-là, et ramené aux bords où l’ombre hésite: Confiance au fleuve de pluie; aux épaules traversées. Neige des murs au printemps; feuilles qui criaient; lancer le sifflet du jour; langer la pierre écrite… Hésitation alourdie de l’ombre.
Michel Diaz, 06/12/2018
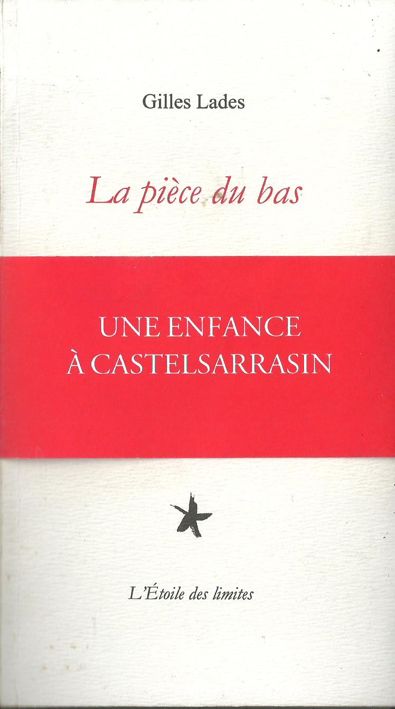 LA PIECE DU BAS
LA PIECE DU BAS


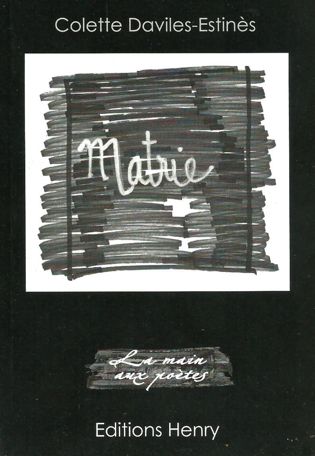 MATRIE – Colette Daviles-Estinès
MATRIE – Colette Daviles-Estinès