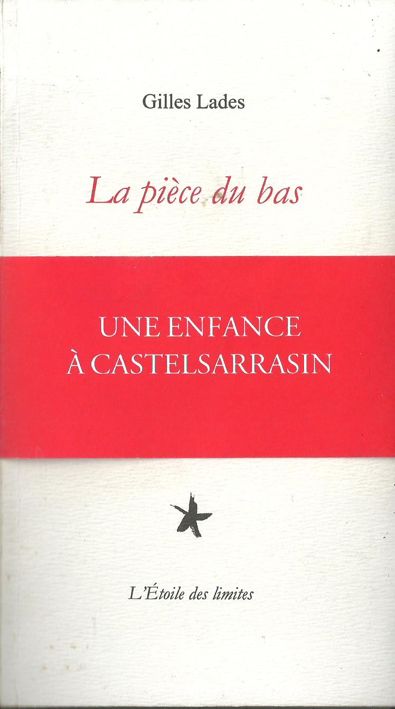 LA PIECE DU BAS
LA PIECE DU BAS
Gilles Lades
Ed. L’Etoile des limites (2018)
Chronique publiée dans le N° 76 de Diérèse
Derrière le front, l’horizon
Dans La pièce du bas, Gilles Lades dessine le portrait d’un petit garçon, sensible et rêveur, pour qui le réel n’était pas assez grand. Dans le cas de celui-ci, vouloir en déplacer les bornes, poussé par « un instinct d’évasion (qui) impulsait puissamment ses horizons derrière (son) front« , sans en connaître les enjeux ni en mesurer les limites, cela ressemble à un parcours initiatique (au sens étymologique du terme) qui pourrait aussi bien tourner à l’aventure poétique, ou à « un engagement dans la vie (qui) vaut acceptation de l’existence quand elle vient vers vous, comme une vague, une tempête, un moment de solitude qui vous ravage et vous transforme« , autrement dit à ce qui a haute valeur d’expérience humaine.
Voilà donc un petit livre indissociable, lui aussi, de l’œuvre poétique de l’auteur. De la ville, Castelsarrasin, à ses proches lointains, le Quercy, Gilles Lades nous invite à un voyage personnel tout autant intérieur que spatial. Voyage en cercles concentriques, marqué d’allers-retours, imaginaires et réels, cheminement d’une conscience au monde qui va s’élargissant depuis son centre « originel », cette pièce du bas, jusqu’à un horizon perçu comme un « appel » irrépressible. Un appel très tôt entendu, pour ce que cet « ailleurs » supposait de promesses, comme un territoire de liberté qui lui permettrait de « vivre dans un espace et un temps choisis, occupés d’humains juste assez nombreux pour que le monde soit dépourvu de contraintes. » Appel à un voyage d’un ici étroit vers un vaste là-bas entrevu autant que rêvé, d’un proche et terne quotidien scolaire vers un lointain envisagé comme « le pays de l’ailleurs et de l’inaccessible. » Cet « ici » et « là-bas », ce « proche » et ce « lointain » s’entrelaçant au cours des pages et autorisant, dans la même coulée du texte, « ces surgissements conjoints », ainsi que l’écrit Chantal Danjou à propos de Quercy de roche et d’eau.
« Une enfance à Castelsarrasin », ce sont les quelques mots que le bandeau du livre offre à l’attention du lecteur. Et une fois le livre ouvert, on lit ces quelques autres: « Il y eut trois maisons…« . Cela commence, presque, comme un conte. Comme en d’autres histoires, il y a trois fils ou trois filles, et quelque espace de forêt où l’on n’ose s’aventurer. Trois maisons successives. La première, aux « pièces étroites », à l’escalier « à rampes droites » donnant sur « une place ouverte » occupée par une entreprise de matériaux, gardée par une rue encombrée de camions, un « vide lancinant » sans échappées possibles, la deuxième, « pavillon en rez-de-chaussée ouvert sur un jardin à la française » que le soleil « agrandissait de liberté », et la troisième, « grande et claire » pourvue, à l’arrière, d’une terrasse qui « s’ouvrait sur un maillage de jardins ». A chacune de ces maisons, des rues rectilignes, d’abord, un « canal enjambé d’un pont », un horizon fermé, puis le simple bonheur d’un jardin, d’un appentis qui recelait de « périlleux trésors », la découverte d’un vélo rouillé, vieil engin hors d’usage, annonciateur de la passion future de l’auteur « pour les modèles plus accomplis de cette souple et puissante machine », puis, plus tard encore, une Nationale de tous les dangers à franchir héroïquement pour aller au-delà, plus loin, vers une autre école. Trois espaces de vie d’une enfance, qui s’ouvrent lentement, l’un après l’autre, et qui vont en s’élargissant comme une étreinte se desserre, même si, « bien des fois, nous confie le narrateur, le chemin de l’école (lui) parut d’une austérité sans recours, comme si ce lieu d’échanges et de savoir heurtait » sa sourde faim de liberté. C’est pourtant dans cette troisième maison que lui est offert un espace, comme « au centre du monde », où vont s’alimenter la source de ses rêveries et fleurir son imaginaire: « Ma pièce était là, au bout du couloir, et le bureau qui l’occupait et m’a suivi depuis porte de chaque côté des tiroirs à l’étrange arôme de bois et de vieux papiers. » C’est dans cette pièce, ajoute-t-il, qu’il pressentait « que le silence et les livres faisaient œuvre en (lui)« , que se cristallisait, à son insu, tout ce qui, par la suite, le déterminerait dans sa vie d’homme. Ces premières pages de La pièce du bas balisent ainsi, métaphoriquement, les premières étapes de ce lent cheminement de découvertes et d’aspiration à ce « désir absolu de liberté« , c’est-à-dire de ce qui fonde l’œuvre poétique et romanesque de son auteur.
Pour parler de son enfance passée à Castelsarrasin, Gilles Lades n’emprunte que bien peu aux procédés usuels de l’autobiographie. Si l’on ne doute pas que répondant à l’impératif initial du « pacte autobiographique » (tel que l’a défini Philippe Lejeune), le « je » du narrateur épouse celui de l’auteur, comme on ne doute pas non plus de sa « sincérité », condition essentielle de pareille entreprise, les autres termes de ce pacte font l’objet d’une bien plus libre utilisation et s’en affranchissent pour mieux répondre à une autre démarche, celle, poétique, d’un écrivain qui construit son « objet » et invente sa forme. En effet, la chronologie est certes soulignée par des repères temporels (passage des jours, des mois, des années, retour des saisons, des temps de vacances, de rentrées scolaires), mais la seule date qui soit indiquée est celle de l’hiver 56 dont il garde « en mémoire le bloc de glace scellé dans le bac à lessive ». La ville n’est jamais non plus explicitement désignée, pas plus que ne sont désignés par leur nom les rues, les places, les écoles ou le premier collège, et si la région du Quercy est souvent évoquée, c’est avant tout comme un lointain espace d’évasion, « une vallée aux falaises blanc éclatant et feu longée d’une claire rivière, le Célé », une terre en grande partie fantasmée par l’esprit de l’enfant, un pays aux contours incertains et détenteur d’un charme magicien, comme l’est le pays de Sologne dans le roman d’Alain Fournier. Les protagonistes de ce récit (mise à part « Madame Jacquin, la voisine de palier« ), jamais nommés non plus, ne sont présents que par leur qualité et leur fonction d’actants, le père, la mère, les grands-parents, telle « institutrice, coutumière de furieux éclats de voix », ou « tel instituteur irascible, élégant et tendre ». Aucun indice non plus (sinon par hasardeuse déduction), du statut social de cette famille dans laquelle grandit l’enfant, ni « portrait » d’aucun de ses membres, et excepté pour la personne du grand-père (figure très présente dans le livre, parce que personnage de « passeur », en relation directe avec le Quercy tant rêvé), ou ci ou là, pour d’autres, d’une plume furtive, Gilles Lades ne s’attarde pas à nous en donner quelques détails physiques ou de caractère.
Enfin, nous ne trouvons au long des pages aucun fil narratif continu, à proprement parler, enchaînement d’événements et de situations, et bien peu d’anecdotes qui constitueraient la trame du récit de ces temps de l’enfance. Autant dire que cet ouvrage, agencé en brèves séquences, séparées par des blancs elliptiques, posées comme les pièces d’un puzzle dont on doit inventer les manques, baigne tout entier dans une curieuse lumière, non celle, capricieuse, d’une mémoire intermittente, mais dans celle, exigeante et plus sélective d’un projet littéraire qui a fait le choix d’éclairer, dans ses flaches, des moments bien précis de l’enfance, n’en conservant que les images fondatrices, celles qui donnent sens à un cheminement d’homme, un cheminement d’écriture et son processus créatif.
Ce qui fait donc la matière même de ce livre, c’est ce que trace le sillon d’une écriture qui creuse dans ses origines. Matière de langage dans le travail des mots, révélateurs d’images que l’auteur remue, comme des fragments de mémoire, ou comme l’on choisit et rassemble des pierres pour édifier ces frêles cairns qui jalonnent le bord des sentiers des pays de cailloux et de vent. Ce sont les preuves d’un passage, les signes dans lesquels on peut lire, d’un passant à un autre, le souci du partage de ce qui, entre nous, fait chemin commun.
J’utilisais, plus haut, la métaphore de « voyage en cercles concentriques ». Le dernier qu’évoque ce livre n’apparaît qu’à la fin de ses pages. Le narrateur, adolescent, s’est rendu en vélo jusqu’aux rives de La Garonne. Et c’est là, que depuis le début de l’ouvrage ses mots nous conduisaient. Géographiquement, vers ces limites du Quercy, un autre paysage de lumière, « saturé de soleil », un horizon qui soudain s’ouvre comme se déchire un rideau sur un espace où d’autres forces se font jour, élémentaires, elles aussi: « les puissances de l’eau et de la terre, descendues des plus hautes montagnes, affirmaient leur alliance et révélaient toute la réalité d’un fleuve emporté vers la mer« . Moment de découverte stupéfaite, de grâce rare et de révélation, de ceux-là qu’il nous faut savoir accueillir, quand nous sommes prêts à les recevoir. « Révélation », dans le sens spirituel de ce terme, comme celle où chavirent les sens et l’esprit, quand le corps sue et brûle et les yeux se consument au feu d’une autre vérité. Les mots que Gilles Lades emploie pour décrire ce moment-là ne sont pas, ici, vraiment différents de ceux des expériences mystiques: « Je ressentis bientôt des picotements, comme autant de rayons distincts, puis la chaleur, d’un bloc, s’empara de mon corps. Je résistai, jusqu’au bout du raisonnable, à cette emprise. Lorsque j’ouvris les yeux, l’espace était presque noir, noir d’aveuglement. » Et il ajoute, un peu plus loin: « Le monde bruissait comme une fournaise de sève et de marée. Pour la première fois peut-être, je venais de sceller le pacte de ce que je pouvais ressentir à l’extrême ce que je pouvais pressentir à travers des poèmes, des romans, des visages, des voix, des musiques, à travers aussi les plus beaux gestes du sport, tout ce qui témoigne d’un engagement dans la vie et vaut acceptation de l’existence quand elle vient vers vous comme une vague…« .
Je commençais ces lignes en parlant de ce livre comme puisé aux sources d’une quête initiatique, un parcours tâtonnant d’abord, comme on marche l’aveugle, mais qui va peu à peu s’éclairant, comme il peut aussi éclairer ou à tout le moins, fraternellement, faire écho à certaines de nos expériences de vie. C’est, j’en reste persuadé, ce qui en fait la force retenue, confortée par la beauté sobre d’une écriture dont nous demeurons quelque peu étourdis.
Michel Diaz, 26/11/2018
Réponse de Gilles Lades à cet article (03/06/19) :
Cher Michel Diaz,
permettez-moi de vous dire « cher », même si nous ne nous connaissons pas, mais je tiens à vous assurer à quel point j’ai été touché, ému et même comblé par votre étude. Cette étude donne tout son sens à mes contraintes implicites : l’extrême discrétion des miens quant à leur vie personnelle – discrétion que je voulais respectueuse – et l’idée qu’il n’est pas de petite vie, ou de « vie minuscule » » : tout le monde est égal parce qu’en proie à l’absolu et à l’infini. Ces derniers sont parfois déformés ou pervertis, mais ils existent en chacune ou chacun.
Merci pour vos éclairages qui me justifient de m’être « jeté » à l’eau, afin de rechercher ce qui vaut le plus en nous, et refuse l’avilissement ou la banalisation. Merci au nom des miens, et de tous les enfants et adolescents qui cherchent parfois sans le savoir un sens à leur vie.
Au plaisir de se rencontrer, peut-être un jour au Marché de la poésie,
avec mes plus chaleureuses pensées,
Gilles Lades
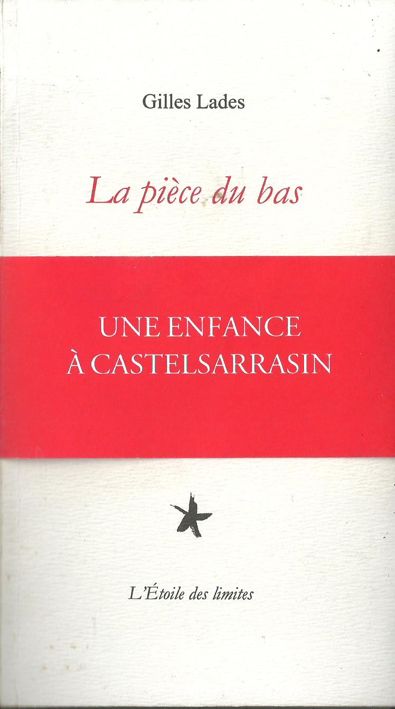 LA PIECE DU BAS
LA PIECE DU BAS