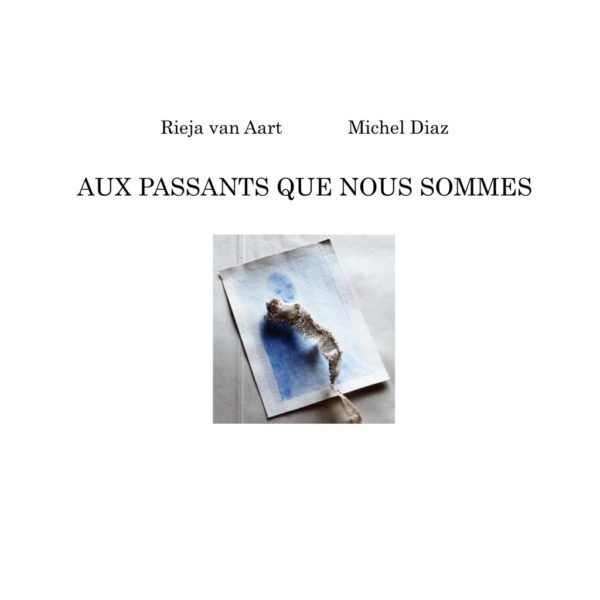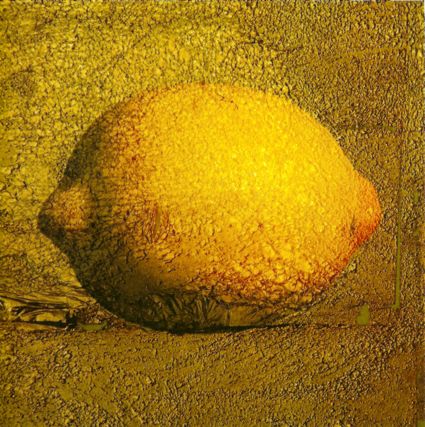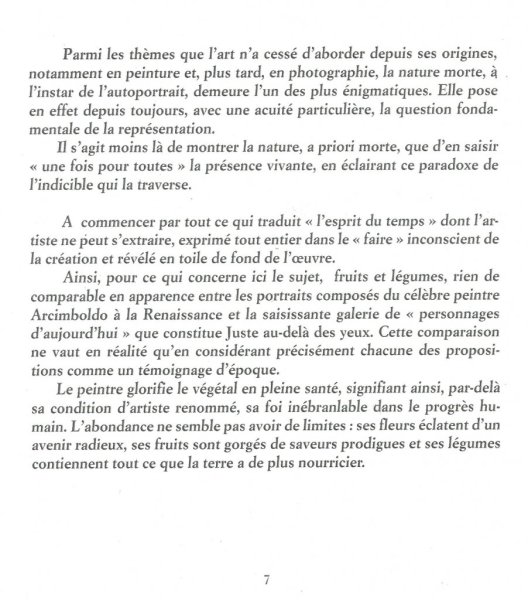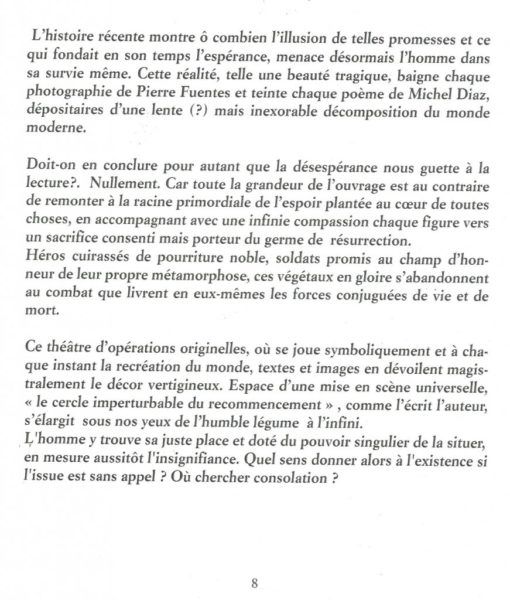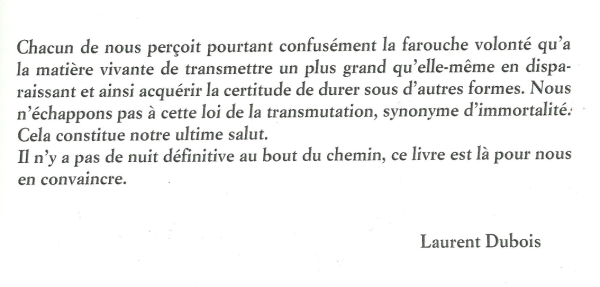A propos des photos de la série « Bois levés » de Thierry Cardon.
Texte publié dans le recueil Cristaux de nuit, éd. de L’Ours Blanc, mai 2013.
Pendant près de vingt ans, Thierry Cardon a exploré méticuleusement les plages de la Loire (entre Blois et Tours, essentiellement), vouant sa quête solitaire au repérage de ces bois flottés que l’on rencontre si souvent, échoués sur le sable des berges, pour les photographier dans la lumière, le décor, et la « forme dramaturgique » qu’il rêvait de leur accorder.
Entreprise têtue qui s’apparente à la composition et à la représentation d’un énigmatique opéra. L’opéra de la Loire, tel que le photographe l’a conçu, organisé, dont il a composé la partition, distribué les rôles, réglé les mouvements. Opéra somptueux, inquiétant et cruel où se joue sa vision personnelle du monde, son intime mythologie.
Loire, ciel, lumière, arbres.
Ou les quatre éléments : l’eau, l’air, le feu, la terre.
Paysages « élémentaires » qui rendent compte d’un état du monde, ici et maintenant. Paysages offerts à nous, immuables, fragiles. Eternellement éphémères. Paysages à pénétrer. A déchiffrer…
Le fleuve en la magie de ses lumières. De ces douceurs-couleurs bouleversantes. En la magie des arbres de ses berges, leur frondaison au fil de l’eau. Mais arbres échoués aussi, charriés par le courant, écorcés, dépecés, torturés, rongés par l’eau et par les sables, squelettes nus et lisses déposés à ciel ouvert dans le grand cimetière du fleuve, au hasard de ses plages. Vestige taciturnes d’on ne sait quel déluge… A demi engloutis dans les vases ou les flaques stagnantes des eaux mortes du fleuve.
Ossements surprenants. Inquiétants d’austère souffrance. Majesté dérisoire des formes tourmentées qui révèlent leur long supplice, chemin de cette extase silencieuse qui, pour eux, est le vin de la croix.
… Mais s’infiltrant en cette part obscure et sommeillante de nous-mêmes, voici les mêmes devenus serpents glissant parmi les herbes, les ronces et les sables. Reptiles assoupis, cuirassés d’écorce en lambeaux et d’écailles déchiquetées. Sauriens estropiés, loqueteux, décharnés. Monstres momifiés pitoyables, mais robustes aussi, menaçants et terribles. Lézards géants, iguanes colossaux, créatures antédiluviennes qui dressées sur des pattes informes, des moignons de membres atrophiés, lancent leurs griffes vers le ciel, tendent leur cou vers le soleil pour mordre les nuages et dévorer l’azur.
Vestiges rescapés d’on ne sait quel déluge… ? De quelle catastrophe des temps originels… ? Cataclysme marqué du signe de la germination et de la régénération. Car un déluge ne détruit que parce que les formes de la vie en sont venues à leur dernier degré d’épuisement. Et dans les eaux s’enfouit la trace de ce qui a été, s’est effondré, s’est résorbé, a disparu. Mais resurgit plus tard en ses formes fantomatiques. Golems encore inertes où sommeille la vie consumée de ce qui demande à renaître.
Les bois flottés, en vérité, poussent devant nos yeux les portes de l’imaginaire.
Et dans l’imaginaire, chacun de ces quatre éléments est destiné à nous conduire vers une autre réalité que lui-même. C’est ce que Gaston Bachelard appelait l’imagination matérielle, « cet étonnant besoin de pénétration qui, par-delà les séductions de l’imagination des formes, va penser la matière ou bien – ce qui revient au même – matérialiser l’imaginaire ». Et les quatre éléments, écrit-il encore, sont « comme les hormones de l’imagination. Ils mettent en action des groupes d’images. Ils aident à l’assimilation du réel dispersé dans ses formes. » Si nous cherchons à mieux comprendre comment, dans ses photographies, Thierry Cardon a travaillé à « matérialiser l’imaginaire » pour solliciter notre imagination, on ne peut l’accorder qu’à la foi que nous nourrissons dans la permanence du monde. Cette éternité incertaine où se perpétue la présence des choses simples qui contiennent et sont la mémoire du monde. L’en-deçà de nos origines. Car le but de la création c’est aussi d’inscrire le temps dans l’éternité, qui n’est, après tout, qu’un désir de la permanence du monde. Une éternité seulement possible s’il y a recommencement. Et l’acte créateur a aussi pour fonction de saisir la présence des choses dans leur réalité profonde. De remonter le plus avant possible. Pour mieux saisir et comprendre l’instant présent.
Il est encore assez frappant de constater combien, dans ces images, voisine presque constamment la présence d’arbres vivants, enracinés, feuillus, avec celle des arbres morts, ombres funèbres de leurs frères habités de lumière et de chants. Avatars dérisoires de bêtes disparues que l’on imagine emportées par les eaux furieuses des crues, mais aussi bien frappées de foudre, mordues des flammes, les membres battant l’air dans les convulsions moribondes de leurs organes.
Or nous savons que l’arbre met en communication les trois étages du cosmos. Le souterrain, puisque par ses racines il fouille dans les profondeurs où elles plongent; la surface du sol où s’élancent son tronc et ses premières branches; la lumière du ciel où se déploient ses branches supérieures. Comme il réunit aussi les quatre éléments, puisque buvant l’eau de la terre, lumière et air nourrissent son feuillage, et le feu jaillit de son frottement. Mais les troncs gisant sur le sable offrent, dans ces photos, comme une manière de court-circuit saisissant entre monde chtonien et monde ouranien. Comme si, dans un raccourci d’éclair, ciel et terre mis en contact, les flux d’énergie qui circulent entre ces deux mondes avaient carbonisé les fusibles du Temps, fait imploser les éléments, brûlant en un instant la sève vive dans les arbres pour n’en laisser que ces dépouilles d’animaux fossilisés. Arbres des origines et de la fin du monde, bas et haut abolis, vie et mort confondues en une image spasmodique, ils nous signifient avec évidence que nous vivons dans les parenthèses du Temps, et baignés dans le sang du monde, parmi les pulsations convulsives de l’univers. Dont nous sommes ici les témoins. Stupéfaits de cette réalité qui nous brûlait les yeux. Dans l’absolue présence de l’instant, en bordure d’abîme. Mais qu’il relie pourtant, d’un bord à l’autre.
Interrogeant les bois flottés de Loire, nous voici invités à explorer le monde qu’un regard nous livre. A traverser le monde du sensible pour entrer, au-delà de ses apparences, dans celui de l’intelligible, de la vérité de l’être et des choses, que Platon appelait le monde des Idées. En cela, ces images contiennent, en latence, une puissance démiurgique puisqu’elles nous convient à cette connaissance, qui est re-connaissance. La reconnaissance d’un monde perdu, oublié, celui enfoui dans la mémoire millénaire des ères, dans la mémoire indéfinie des temps non advenus. Des temps où nous ne sommes pas encore, de ceux où nous ne serons plus, n’aurons jamais été. Dans le monde tel que jamais nous ne l’avons vu, et tel que nous ne le verrons jamais. Ou bien encore dans l’étrangeté de ce qui est, dans son mystère que nous ne savons plus voir. Car le mystère du vivant n’est peut-être ni au-delà, ni dans le cœur des apparences. Il est sans doute même la nature des choses. Secret qui fait la force du visible, et de la réalité de la chair qui le constitue. Fulgurante évidence dont soudain s’éclaire le monde.
Brèche dans laquelle l’imaginaire peut se glisser pour contempler le monde en son état le plus élémentaire, c’est-à-dire le plus essentiel.
On est alors chez soi, dans le plein, l’intense et le pur. Dans l’éblouissement profus de l’Etre, et le sentiment d’exister avec tout qui est réveille au plus profond de notre conscience de vivre le dard aigu de sa douceur.
J. M. G. Le Clézio écrit dans son essai, L’Extase matérielle : « L’artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde. Il nous invite à suivre son regard, à participer à son aventure. Et c’est uniquement lorsque nos yeux se portent vers l’objet que nous sommes soulagés d’une partie de notre nuit (…) : qu’importe si l’artiste se trompe en nous montrant ce qu’il croit voir. L’important c’est son cheminement, son illusion. L’art est sans doute la seule forme de progrès qui utilise aussi bien les voies de la vérité que celles du mensonge. »
C’est pourquoi regarder et s’interroger sur les images de cet opéra où sont mis en scène ces bois flottés qui jonchent les berges du fleuve nous autorise, pour un temps, à échapper à la douleur et à la tragédie de vivre. A entrer harmonieusement, pour un temps, dans la réalité à laquelle l’imaginaire nous permet d’accéder. A nous rassasier, pour un temps, de ce qui est là, devant nous. A jouir, pour un temps, de la réalité rejointe comme un rêve intact, au centre même de l’énigme où vie et mort s’unissent dans le même effort. A admettre leurs forces égales et impitoyables.
A nous réconcilier avec le temps des mondes.
Juste avec ce qui est. Sous nos yeux.
Indestructiblement.
 AUX PASSANTS QUE NOUS SOMMES
AUX PASSANTS QUE NOUS SOMMES