
Texte publié dans L’Iresuthe N° 25, octobre 2012.
[Nouvelle extraite du recueil Le Gardien du silence, éd. L’Amourier, 2014, et sous sa 1ère version dans le recueil Cristaux de nuit, éd. de L’Ours Blanc, 2013.]
L’INVITATION
« Mourir, c’est passer à travers le chas de
l’aiguille après de multiples feuillaisons.
Il faut aller à travers la mort pour émerger
devant la vie, dans l’état de modestie souveraine.«
René Char, Le Nu perdu
Il est tard dans la nuit, quand j’écris ces lignes.
A dire vrai, je les écris moins pour les mots dont je trace les lettres l’une après l’autre – mots dont je sais si peu de choses encore de ce qu’ils seront sous ma main, que pour le blanc qui va les séparer, lignes et signes, y dessinant entre eux ces interstices, comme autant de fissures tramées dans un bloc de silence, entre lesquelles il faudrait que je laisse s’insinuer quelque chose dont je n’ai retenu que le vague frémissement. Comme une musique inaudible d’abord, mais qui ne devrait prendre voix et résonance que quand ces pages me signifieront qu’elles sont achevées, que je suis arrivé au bout de la dernière ligne, que mon texte s’arrête là, et que j’en aurai oublié tous les mots. Que ces pages ne seront plus qu’un entrelacs de blancs d’où montera jusqu’à mes yeux une inconsolable clarté.
Il faisait très beau, aujourd’hui encore – qui est déjà hier. Comme pendant les jours de la semaine précédente, et comme il fera beau encore, si l’on en croit ce que prédisent les bulletins météorologiques, pendant nombre de ceux qui vont leur succéder. C’est ce qu’on appelle « l’été indien ».
Je suis allé « là-bas », régler quelques affaires. Pour m’occuper aussi de sa maison, tondre la pelouse, tailler les arbustes et la haie de thuyas, m’occuper des parterres, raccourcir les rosiers, arroser une terre que la chaleur d’été avait rendue compacte comme de la terre battue, et suis rentré vanné. J’ai fait le va et vient dans la journée, deux-cent soixante quatre kilomètres d’autoroute, soit la distance parcourue à chacune de mes visites, une fois par semaine, quelquefois deux, le plus souvent possible. A midi, j’ai rangé la tondeuse, enroulé le câble électrique et fait un tour au cimetière afin de vérifier l’état de la jardinière fleurie que j’ai placée au-dessus de leur nom, sur le mur du columbarium.
Puis je suis retourné déjeuner dans ce restaurant, le Saint-Christophe, où j’emmenais ma mère plusieurs fois par mois. Elle s’y laissait inviter volontiers, moins par intérêt pour une cuisine plus raffinée que celle qui faisait son ordinaire, que pour s’épargner de confectionner, à mon intention, un repas qui lui demandait des efforts et du temps. Tâche pour laquelle, de plus en plus souvent, elle se sentait dépourvue d’envie ou de courage. Elle avait cependant été une assez bonne cuisinière, en tout cas une cuisinière plus qu’honorable dont les recettes héritées de la tradition familiale ont été très longtemps pour moi la seule et authentique référence. Elle cuisinait sans passion, mais il fallait nourrir son monde, mari, enfants, et elle le faisait, comme tout le reste d’ailleurs, devoirs conjugaux, familiaux, ou tâches domestiques et professionnelles, avec la même obstination farouche, la même inébranlable et scrupuleuse volonté de ne laisser dire à personne qu’on pourrait la prendre en défaut. Elle régnait jalousement sur son domaine comme une flamme sédentaire. Assidue à la jouissance de l’ordre impeccable des choses, ennemie du désordre, de la poussière et de la maladie, elle en réglait aussi le cours insensible des jours, s’appliquant à veiller sur tout, sentinelle inflexible, se privant parfois de sommeil, tel un ange gardien veillant sur la maison pour en barrer l’accès ou s’efforcer d’en refouler contrariétés, soucis, chagrins, ou tous virus indésirables. Si elle avait su cultiver sa fierté pour donner d’elle, au monde, l’image d’une femme droite, juste et bonne, dans le cercle privé, l’amour était, pour elle, un nœud coulant passé au cou des siens, le moyen à ses yeux, en tirant sur la corde, de les tenir toujours au plus près de son cœur.
Il me faut avouer que les fois où elle insistait, dans ses derniers mois, prétextant, sans tricher, des chevilles trop lourdes, des jambes douloureuses ou un coup de fatigue, pour que nous restions tous les deux « manger à la maison », je ne cédais jamais sans quelque appréhension. Il n’était pourtant pas question que j’apporte un repas préparé, m’occupe des fourneaux, touche à la moindre casserole. La cuisine restait sa bastille imprenable. Malgré sa lassitude, elle demeurait la maîtresse impérieuse des lieux, matrone et mère éternellement nourricière, mettait un point d’honneur à remplir mon assiette et à me rassasier jusqu’au malaise.
Elle remontait du sous-sol, en geignant, les bras chargés de trois ou quatre boîtes prélevées sur ses imposantes réserves, conserves et plats préparés, haricots, petits pois, ratatouille, bœuf bourguignon, cassoulet toulousain ou poulet à la provençale, lentilles cuisinées à l’auvergnate ou rouelles de porc au curry, choisissait la meilleure combinaison, versait leur contenu dans une cocotte de fonte ou un récipient destiné au four (lapin chasseur et sauté de veau-salsifis, par exemple, ou filets de merlu beurre blanc et dos de saumon-flageolets), mélangeait tout cela de deux coups de cuillère, commençait à le réchauffer tandis que je prenais encore mon petit déjeuner, et tout le reste de la matinée le laissait mijoter jusqu’à ce que, à onze heures et demie tapantes, je l’entendais qui me hélait pour m’avertir que je devais incessamment laisser tomber ce que j’étais en train de faire, qu’il était grand temps de passer à table. Si d’aventure je tardais quelques minutes à me rendre à ses injonctions, elle surgissait comme une ombre, poings vissés sur les hanches, le visage crispé d’impatience, et gémissait que si je ne m’exécutais pas à la seconde même, elle allait s’écrouler comme un arbre rongé au cœur par les termites, à l’endroit même où elle se trouvait, raide morte de faim.
Toujours préoccupée de ne confier qu’à elle-même la préparation du repas, mais plus très apte désormais à en apprécier les incohérences ou la qualité, les entrées qu’elle s’appliquait à improviser n’étaient pas plus appétissantes : salmigondis de taboulé, de carottes râpées, céleri rémoulade, accompagné de tranches de tomates insipides, de fromage de tête ayant passé déjà ses limites de péremption, de pâté de foie un peu gris, de saucisson à l’ail ou de mortadelle à l’aspect quelquefois douteux. L’un des secrets de ces extravagants mélanges, c’est qu’elle détestait ce que l’on déposait chaque matin devant sa porte, ces repas concoctés par un service d’aide à domicile (il nous avait fallu pourtant, ma sœur et moi, batailler de longs mois avant qu’elle consente à l’accepter), barquettes, il est vrai, assez peu ragoûtantes, dans lesquelles elles picorait, qu’elle rangeait souvent, sans les ouvrir, dans les étages de son réfrigérateur, et abandonnait là parfois une semaine ou deux. Répugnant à le laisser perdre (cela lui coûtait assez cher !), malgré mes mises en garde répétées, elle nous resservait tout ça, s’efforçant de l’accommoder d’une giclée d’huile d’olive, d’un jet de mayonnaise, d’une douche de vinaigrette, de deux ou trois pincées de gruyère râpé, le décorait même parfois de quelques cacahuètes. Je goûtais avec précaution, en contrôlant les traits de mon visage afin qu’aucun ne me trahisse, répondais « oui, ça va ! » à la question posée, avec une feinte allégresse, me nourrissais du bout des lèvres, prétextais quelquefois que, décidément, je n’avais plus faim, mais n’ai jamais osé lui dire que ce qu’elle posait au milieu de la table n’était plus souvent attrayant, me semblait quelquefois mauvais, parfois même immangeable… Cependant, inspecter les entrailles de son réfrigérateur, l’avertir d’un danger possible, d’un empoisonnement quelconque par un germe vicieux, c’était, chaque fois, s’exposer à ses foudres et au rire qui la prenait comme on rit au « mot » d’un enfant qui croyait pourtant dire quelque chose de grave.
Le restaurant devint alors ma planche de salut, sa table mon refuge. Moments où, attendant que l’on nous serve, nous nous tenions assis, l’un en face de l’autre, les doigts parfois noués. Notre présence, arrêtée là, éloignait pour un temps les maux de la vieillesse, les désastres qui la guettaient et les misères de la solitude. S’échappaient quelquefois, à travers le silence, un regard attendri, un mot affectueux, la tendre gaucherie d’un geste qui ne tardait pas à se perdre dans le dédale de notre pudeur réciproque. Sur la médiane de ces instants-là, le présent dissolvait quelque peu l’inquiétude, engourdissait la crainte du futur et faisait le jour moins râpeux.
Il nous avait pourtant fallu, plutôt mal que bien, nous résoudre à prendre à sa place cette décision périlleuse qui consistait à l’arracher aux ultimes remparts de sa vie d’être responsable, du haut desquels son existence ne consistait plus qu’à tâcher de rejoindre, à petits pas précautionneux et toujours affairés, cette heure de la fin du jour où, les volets fermés, elle irait se glisser dans son lit.
Elle avait quatre-vingt dix ans, et est morte en maison de retraite au printemps dernier, il y a cinq mois maintenant. Parvenue aux confins de ce qu’aujourd’hui on appelle « maintien à domicile », elle ne vivait plus que cramponnée à ses rituels quotidiens, leur confiant les dernières bribes d’une raison qui l’avait en partie désertée.
Qui appelle ?…
Une fois installé, l’automne souvent s’éternise, parfois joue de ses tergiversations, dans la lumière qui bascule, entre chaleur d’été qui rechigne à se retirer, brusque fraîcheur du soir et brumes matinales. Les rues froides, bientôt, verraient passer des êtres au destin isolé, qui marcheraient sur les trottoirs, front contre la pénombre et n’appartiendraient plus qu’à une espérance inconnue. Je revenais du cimetière, et pour qui remâche sa peine, le cœur est une proie facile. Je me rendis compte, soudainement, que je ne savais plus poser aucun sourire sur le visage de la morte, aucun mot sur ses lèvres, et que le timbre de sa voix n’était plus qu’un lointain écho. L’amour n’accourait plus dans les mains de l’enfant qui appelle. Le souvenir faisait un bruit de râle, la trajectoire d’une vie ne se résumait plus qu’à deux mains pâles et crispées sur un drap d’agonie. Me revinrent aussi en mémoire, obsessionnellement, quelques fragments d’un ancien texte, composé dans un Amsterdam aux canaux à moitié gelés, par une nuit de neige, au long d’une épuisante déambulation parmi les rues et les ruelles, sorte de fausse couche d’une chanson du « mal aimé », enterrée pourtant depuis ce temps-là sous six pieds de vergogne et d’oubli :
… anneaux concentriques de nuit
l’heure se dilate et déborde
sur le temps qui ne passe plus
tombe une neige inexorable
l’ombre des rues brûlée d’images
harcelée de mots électriques
rabâche ses litanies tristes
et s’invente un réel illusoire
d’instants déchiquetés
…
façades recousues de néons pathétiques
du rouge au bleu au jaune
au vert la mémoire vacille
embrumée de fatigue et de bière
vertige enclos dans cette errance
où se rit d’elle par instants
la lyre du chagrin
…
Je suis donc allé déjeuner, au restaurant le Saint-Christophe. Moins pour apaiser une faim que je ne ressentais plus guère, que par besoin d’y retrouver quelque trace de ces moments.
Dans cet endroit, où nous étions venus souvent, les plantes décorant le vestibule, la poignée dorée de la porte à petits carreaux dépolis qui donne sur la réception, la physionomie du jeune homme chargé d’accueillir les clients, les couleurs de la salle à manger et la disposition des tables, la forme des assiettes, des couverts, les plis de la serviette enfoncée dans les verres, même les bruits ambiants, tout m’était familier, tout était là, semblable aux autres fois, fragile et maigre nourriture de l’imaginaire.
C’était un jour de grand soleil. Il n’y avait plus de place en terrasse, mais cela n’avait pas d’importance, nous nous n’y étions installés qu’à deux ou trois reprises. Malgré l’ombre des grands parasols, déployés sur le carrelage de terre cuite qui recouvre la cour, elle n’aimait pas déjeuner dehors, redoutait la trop vive lumière, évitait la chaleur, et supportait encore moins de s’attarder aux frivolités de la table. Manger n’était pour elle qu’une activité pratique, biologiquement indispensable, comme le boire et le dormir, et dans laquelle le plaisir ne trouvait qu’une place congrue. D’ailleurs, dès la serviette reposée sur le bord de la table et l’addition réglée, ses paupières tombantes, ses soupirs de fatigue et ses bâillements un peu théâtraux signifiaient à la ronde qu’il était l’heure de la sieste et qu’il nous fallait rentrer dare-dare.
Installé le long du mur lambrissé de la salle, face à la porte ouverte à deux battants sur la terrasse, assis derrière une petite table tendue de blanc, appuyant ma tête un peu lasse sur mes deux poings fermés, je l’ai, du bout de la pensée, invitée à venir me rejoindre, et je l’ai en effet retrouvée. Sans aucune difficulté.
Fontaine sourde, frémissement d’étoffe, et sur la nuque un souffle familier, vestige à peine perceptible d’une haleine, glissé tiède d’un doigt de clarté, comme celle s’insinuant sous le ras d’une porte, entre deux lèvres de pénombre.
Quand j’ai levé les yeux,
elle était là, irréelle d’abord, et lointaine,
présence transparente à travers laquelle passait la lumière du jour, l’image des clients qui déjeunaient sur la terrasse et le va et vient des filles de salle.
Alors, de la manière mystérieuse dont s’opère un alliage subtil entre la matérialité des lieux et l’inconsistance de l’âme, elle a tendu son bras vers moi, a posé sa main sur la mienne, comme l’ombre portée d’une feuille de marronnier se pose sur un mur.
Nous allions déjeuner face à face, sans nous parler, ou presque, comme d’habitude, non pas avares de nos mots mais n’en usant toujours qu’avec un soin précautionneux. Depuis longtemps déjà elle était sourde, et ses appareils auditifs, pourtant derniers modèles, véritables ordinateurs contenus dans un espace ridicule, la laissaient dans les marges de la parole, ne l’autorisant à entendre, du monde extérieur, qu’un brouhaha informe, un grondement de train où les sons de la langue se diluaient. Je ne la rencontrerais sans doute jamais plus que dans ce no man’s land, à l’orée des silences, au-delà du désir, juste au milieu de cette mince passerelle qui nous reliait, tendue entre le songe et la réalité, au-dessus d’un abîme où le temps avait cessé de s’écouler.
Parler à un fantôme, toucher du doigt une ombre, c’est une chose étrange. Quelque chose arrive soudain, amenant d’autres choses auxquelles on ne comprend pas grand chose. Un rayon de soleil qui traverse le verre d’eau et renverse un peu de lumière sur la nappe blanche, une salle de restaurant, bruyante et animée, qui tout à coup devient une voûte vibrant de silence, un battement qui la traverse comme l’aile d’un oiseau nocturne… La conscience des choses est quelquefois obscure. Sans doute est-ce dans le plus grand éloignement qui soit, dans l’absence la plus absolue, qu’il est possible aux âmes de se rapprocher le plus et de tisser entre elles ces correspondances secrètes où se pose la voix de l’inattendu.
Je vis que son visage, éclairé d’un sourire, m’invitait à franchir la distance dans laquelle nos voix ne pouvaient se toucher encore. Je lui ai rendu son sourire, tâchant d’y effacer cette ombre que nous fait la proximité d’un mensonge. Dans l’espace où nous nous tenions, assis l’un en face de l’autre, s’étendait entre nous, comme l’eau de la mer, l’infini de la solitude.
Mais c’est dans cet écart que fleurissent d’étranges mots, secourables et bons, lentement venus, avec la lenteur de ces iris jaunes de rivière, qui s’ouvrent au matin dans le silence de l’eau fraîche. C’est dans cet écart que se jouent aussi confiance et tendresse, dans ce temps de l’espace insondable qui sépare chacun de nous d’avec toute sa mort, mais aussi bien, à l’autre extrémité, dans les caches de l’ombre, d’avec le monde des vivants.
Je l’avais invitée à venir me rejoindre, ni pour régler mes derniers comptes, ni pour retourner l’épée du chagrin dans les chairs ouvertes de la mémoire. Mais juste pour la retrouver, quelques instants encore, telle qu’en elle-même, affable et souriante, mais dissimulant les verges inflexibles de son autorité sous le masque avenant d’une très digne vieille dame.
Je l’avais invitée à venir me rejoindre, ni pour me soulager de ce vague à l’âme sans fond, ni pour maintenir ou sauver cette heure en la clouant au temps, mais juste retrouver quelques éclats de sa présence et sentir de nouveau, entre nous, cette vibration dans laquelle se tient la présence d’autrui, cette musique indéfinie, qui va de l’un à l’autre, douce et chaude, sans heurts, par frôlements, par glissements, sans froisser les feuillages de l’air, sans heurter le moindre silence.
J’ai senti, au bord de mes lèvres, que venaient et s’ouvraient ces étranges mots… Elle, peut-être, voulait-elle me dire que la vie, qu’elle tourne ou non d’une manière qu’on appelle « heureuse », est plutôt en soi une bonne chose. Peut-être voulait-elle encore me dire, mais après coup j’en suis certain, qu’elle savait enfin avec quelle attention profonde, elle qui avait dû renoncer à tant de plaisirs simples parce que l’existence l’avait tant bousculée, n’avait pas toujours pris le temps, ou n’avait jamais su en mesurer le prix, elle saurait sans doute maintenant les reconnaître, savourer ces joies accessibles. Qu’elle avait maintenant compris que l’on pouvait jouir de tout, et qu’il est presque fou de distinguer entre les événements heureux et les événements malheureux. Qu’il fallait faire bon accueil à toutes ses sensations et états d’âme, les cultiver, les gais, comme les tristes, et ses vœux non réalisés aussi, que le secret de vivre était dans le désir.
Elle était là.
Pensée posée là, devant moi, surgie de cette région du dedans dont on ne connaît rien, si peu de choses.
Pensée qui prononçait des mots. Un peu plus lents que d’habitude, en vrac, et sans lien raisonnable entre eux, des phrases décousues, sa façon de parler, dans les derniers temps de sa vie. Un léger bruissement de lèvres que je parvenais à déchiffrer : jardin, soleil, promenade, parfum de fleur, chant d’un oiseau, toucher, rire, embrasser… et un mot solitaire, je ne sais pas : mort, ou mourir… ou amour, peut-être…
Michel Diaz
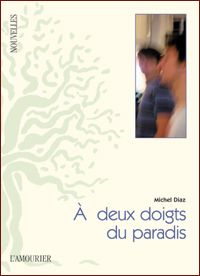
 SEPARATIONS, nouvelles, Editions L’Harmattan (septembre 2009),
SEPARATIONS, nouvelles, Editions L’Harmattan (septembre 2009),