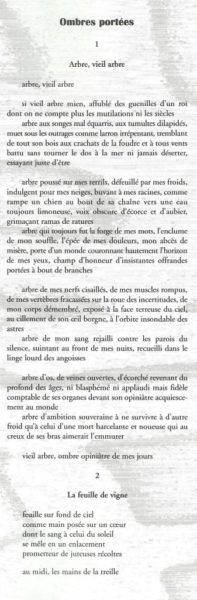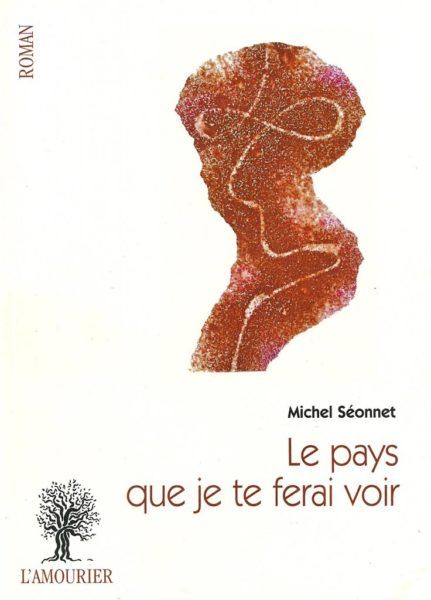Entretien publié sur le site des éditions N & B (Noir et Blanc), février 2015.
Jean-Yves Casteldrouin : Dites-nous quelques mots, pour commencer et mieux vous situer, sur les débuts de votre parcours d’homme.
Michel DIAZ : Né en Algérie, je viens d’un modeste milieu d’ouvriers agricoles et de petits employés d’origine espagnole. Tous ne maîtrisaient pas très bien la langue française (ils n’avaient d’ailleurs aucun diplôme), mais avaient un profond respect pour l’école et la culture. C’est dans ce terreau familial, monde de braves et honnêtes petites gens, que j’ai puisé un certain nombre de valeurs. Des valeurs essentielles à mes yeux, mais qui sont, il faut bien le dire, même ironiquement, de bien mauvaises armes pour se défendre dans la vie. Malgré des années de bouleversements familiaux assez éprouvants liés à la guerre d’Algérie (mais je n’entrerai pas dans ces détails), mes parents m’ont permis de suivre des études. En 1964, j’entrais en seconde, comme pensionnaire, au lycée Corneille, à Rouen, le lycée de « l’élite », fréquenté par les fils des notables locaux. Des ados arrogants et nantis, qui ne manquaient de rien, qui ne connaissaient rien des violences de la guerre qui venait de s’achever, des déchirements et des drames qu’elle avait pu occasionner, et parmi lesquels je me sentais assez peu à mon aise. De petits révolutionnaires en herbe (en conflit adolescent surtout avec leur éducation familiale « bourgeoise »), qui refaisaient le monde à coups de citations de Marx, Lénine ou Trotski, citations balancées comme des versets d’un nouveau catéchisme et qui leur épargnait de vraiment réfléchir. Comme je parlais peu et ne me livrais pas (les plaies étaient très vives encore), ils ignoraient tout de l’histoire communiste de ma famille et du prix lourd de ces engagements. Mais en tant que « pied noir », suspect par conséquent d’appartenir au camp des « colonisateurs », c’est-à-dire des « oppresseurs » et des ennemis politiques qu’ils s’étaient fabriqués, j’étais ostracisé, en butte à leur mépris, à leurs violences verbales, à la provocation délibérée parfois au coup de poing. J’ai dû parfois me battre, moi qui, pourtant, n’aime pas beaucoup la bagarre.
J.-Y. C. : Michel Diaz, essayiste, homme de théâtre, écrivain protéiforme, professeur, vous avez eu une existence très riche. Pouvez-vous nous dire comment se sont passées ces années de « formation » dans un pays que vous découvriez ?
M. D. : Après le bac, en 1967, je me suis « embarqué » dans des études de lettres, à Rouen d’abord, puis à Orléans. Par intérêt pour la littérature, évidemment, mais en toute innocence, sans me rendre compte d’abord que c’était l’antichambre de l’enseignement, une filière pauvre en avenir, une sorte d’impasse, piège sournois dont les diplômes ne laissent pas vraiment d’autres choix que celui de virer au « prof ». Mais j’ai beaucoup aimé l’enseignement à l’université, les portes qu’il ouvrait à mon esprit et les outils qu’il fournissait pour mieux appréhender la chose littéraire, comprendre les auteurs et entrer dans la chair des œuvres. J’ai eu la chance d’avoir quelques bons professeurs à l’université parmi pas mal d’autres bien ternes, des « assis » comme aurait dit Rimbaud, qui ânonnaient leurs cours de vieux français ou de littérature médiévale, sans feu ni enthousiasme, à vous dégoûter de Chrétien de Troyes ou de François Villon. Parmi les plus intéressants, il y avait Marie-Claire Bancquart (que j’ai retrouvée comme auteure aux éditions L’Amourier). Et aussi René Marill Albéres, essayiste et critique, qui arrivait toujours à demi-soûl, chemise mal rentrée dans la ceinture et pantalon parfois déboutonné, mais qui fréquentait Butor, Sarraute, Robbe-Grillet, Duras, Jabès, B. Noël, et faisait des cours formidables de vie et d’intelligence. Il a failli mourir, pendant un cours, sous les yeux rigolards des autres étudiants, en s’accrochant avec sa cravate à la poignée de la fenêtre pour nous montrer comment Nerval s’était donné la mort, rue de la Vieille lanterne. Les étudiant le méprisaient et le chahutaient sans vergogne sans se rendre compte qu’ils avaient affaire à un enseignant de haut vol. J’ai adoré ce type qui m’a souvent reçu chez lui et à qui j’ai confié mes premières pièces – qu’il lisait très soigneusement et prenait au sérieux.
J.-Y. C. : Comment et pourquoi avez-vous choisi d’entrer dans la carrière d’enseignant ?
M. D. : Dès la seconde année de faculté, j’avais juste vingt ans, je me suis « engagé » dans l’enseignement, comme maître auxiliaire. Moins par intérêt pour la profession (je voulais entrer dans le journalisme) que parce que j’avais déserté le foyer parental, que j’étais « soutien de famille », jeune marié qui allait très bientôt devenir papa. Il fallait payer le loyer et assurer le quotidien. Nommé au lycée de Pithiviers, et sans avoir reçu aucune formation, on m’a collé devant des classes terminales et d’autres qui formaient des sténodactylos au métier du secrétariat ! Je devais jongler, pendant près de trente heures par semaine, entre un cours sur Gide, Proust ou le surréalisme et des cours sur le droit du travail auquel je ne connaissais rien. Inutile de dire qu’à partir de ce moment-là je n’ai plus fréquenté la fac que par intermittences, quelques heures par ci, par là, quand j’en avais le temps. Le piège s’était refermé pour de bon… Il n’empêche que ces premières années d’enseignement ont été des années de folie parce que, je crois, je ne puis faire les choses qu’avec cœur. Privé de toute formation, sans consignes pédagogiques précises, me riant des programmes, je prenais la liberté de rejouer, à moi tout seul, « la bataille d’Hernani », debout sur mon bureau et hurlant des vers de Victor Hugo. Je lisais aussi, en vociférant, des poèmes d’Henri Michaux ou des textes d’Artaud, ou je m’amusais à interpréter tous les personnages de La Cantatrice chauve ou de La leçon de Ionesco sous le regard parfois dubitatif mais bienveillant et amusé de mes élèves. J’étais dans une sorte de chaos pédagogique. En tout cas, je faisais passer quelque chose, de la curiosité, du savoir et de l’émotion. Aujourd’hui, le dixième de ces excentricités nous vaudraient une immédiate mise à pied et le passage en commission de discipline.
Cela dit, j’ai aimé enseigner, en dépit des difficultés liées à l’exercice d’un métier devenu, au fil des années, de plus en plus ingrat. Mais je me suis toujours senti très peu à l’aise au sein de l’Education nationale. L’esprit de l’Ecole, qui devrait d’abord consister à éveiller l’intelligence, à élever l’individu en suscitant en lui l’attrait de la curiosité et le goût du savoir, a été peu à peu ruiné au cours des presque cinquante dernières années. A coups de réformes successives, ambitieuses dans les discours, mais toujours aussi creuses que vaines. Cette machinerie considérable, mais qui tourne toujours à vide et en grinçant de plus en plus, est devenue une « fabrique de crétins », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Brighelli. Mais à qui la faute ?… Il est clair, à mes yeux, que nos ministres de l’Education, de quelque bord qu’ils soient, n’aiment ni les élèves, ni les professeurs, ni les chercheurs, ni les artistes. La plupart de ceux qui se tirent de ce « foutoir », sans y laisser leur peau, sont des enfants issus de familles « favorisées », qui naissent et grandissent entourés de livres et de « grande » musique, et boivent dès le biberon le lait de la culture. Le système éducatif dans lequel j’ai travaillé, et dont j’ai été aussi le complice, m’a mené à la dépression. J’aurais pu en mourir – sans me payer de mots – ou finir bourré d’anxiolytiques et de psychotropes. C’est Arthur Adamov, un type un peu plus tordu que moi, qui a contribué à me sauver.
Cela dit, encore, le travail de professeur (épuisant si on le fait correctement) et celui d’écriture sont des activités hautement chronophages et énergivores. J’ai tenu le cap de l’écriture, pendant toutes ces années, en prenant sur mes temps de sommeil, de repos, de loisirs… mais je suis quelquefois resté de longs mois sans écrire, et j’ai peu publié pendant tout ce temps parce que mes travaux d’écriture souffraient cruellement de mon manque de disponibilité.
J.-Y. C. : Vous venez d’évoquer le dramaturge Arthur Adamov auquel vous avez consacré une thèse de doctorat. Comment est né en vous le goût pour le théâtre et vers quoi vous a -t-il conduit ? Et pouvez-vous nous résumer votre parcours de professionnel et d’écrivain ?
M. D. : J’avais lu, avec grand intérêt, pendant mon adolescence, les pièces de Shakespeare et celles du répertoire de l’Antiquité (celles surtout d’Eschyle et de Sophocle). Mais c’est en assistant, lycéen de terminale, à une représentation du Diable et le bon Dieu, de Sartre, au T.N.P. (avec Georges Wilson et François Périer), que j’ai été violemment saisi par le virus du théâtre. Je n’y étais presque jamais allé, mais j’étais littéralement envoûté par l’espèce de force magique qu’exerçait, à mes yeux, la présence du comédien, de son corps sur la scène. En fait, ce que racontait la pièce de Sartre (qui m’est en grande partie passé au-dessus de la tête) m’intéressait moins que l’affrontement physique des comédiens, le jeu de leurs intonations, le débit de leurs voix, la musique des phrases. Ils étaient tout petits, là-bas, au loin, sur la scène immense de l’ancien T.N.P., mais ils semblaient doués d’un pouvoir magnifique, presque surhumain : celui de porter la parole à travers l’espace et de représenter la force des passions humaines. Cette expérience a vraiment été, pour moi, de l’ordre de la « révélation ».
La fréquentation, à peine plus tard, des œuvres d’Henri Pichette, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal, Jean Genêt, Bertold Brecht, mais aussi celles de Claudel (Tête d’or en premier), Schéhadé, Audiberti, Pinter, Arden, Bond, Vinaver, Gatti, tout comme la lecture des textes théoriques d’Artaud, d’Adamov et les propositions avant-gardiste du Living Theatre (les mises en scène aussi de Peter Broock, de Jerzy Grotowski ou de Bob Wilson), me conforteront dans ma démarche d’écriture dramatique à laquelle j’ai consacré presque vingt-cinq ans de ma vie. Ecriture poétique, que je voulais exploratrice de nouvelles formes dramaturgiques et nourrie aussi pour les rythmes et les structures par les pistes ouvertes par les compositeurs de musique contemporaine (E. Varèse, P. Henry, P. Boulez, L. Nono, Cage, Ohana, Xénakis, Parmegiani ou les Percussions de Strasbourg). Certains de ces textes seront lus dans des festivals de théâtre, une fois par Michel Vitold au festival d’automne de Paris, ou lus dans les théâtres respectifs de J.-L. Barrault et L. Terzieff, ou portés à la scène, ou diffusés à la radio, sur France-Culture. Mais mon théâtre, trop ingrat peut-être, insuffisamment maîtrisé sans doute, ou pas assez en phase avec l’époque, allez savoir, n’a finalement pas convaincu grand monde et pas mal de mes pièces sont restées dans mes tiroirs, à l’état de manuscrits. Essayer de les publier ne m’intéressait d’ailleurs pas vraiment. J’écrivais pour être joué, dans les meilleures conditions possibles, et dans de vrais théâtres. J’ai toujours préféré ne pas être joué que l’être dans des conditions approximatives et peu satisfaisantes, avec des moyens de fortune. Appelez ça « péché d’orgueil » si vous voulez… En tout cas, l’un des points forts de cette aventure théâtrale a été la rencontre avec Georges Vitaly, en 1989, le « découvreur » d’Audiberti, entre autres, mais qui avait aussi monté Henri Pichette, avec Gérard Philipe. Pour monter Le Dépôt des locomotives, il avait proposé le rôle féminin à Maria Casarès, rôle épuisant parce que très physique et qu’elle a magnifiquement servi.
J’ai mené, parallèlement, sans projet éditorial aucun, là encore, une exploration de l’écriture poétique inspirée par les œuvres d’Henri Michaux, Jacques Roubaud, Lionel Ray, Louis Calaferte, Jean Cayrol, Jacques Réda, Bernard Noêl, celle surtout d’Edmond Jabès que j’ai fréquenté pendant quelques mois… Ces travaux d’écriture, toujours conduits par le désir de trouver cette « part d’inconnu » qui s’ouvre devant soi, d’explorer l’être humain au plus intime de lui-même, de ses fantasmes ou délires, ou de ses aspects les plus ténébreux, tout en gardant les yeux ouverts, largement, sur le monde, ne s’embarrasseront pas de s’enfoncer, parfois, dans des impasses, le but étant toujours, interrogeant aussi l’acte même d’écrire, de poursuivre ce qui, du réel, constamment nous échappe et qu’il faut tenter d’exprimer…
En abordant le genre de la nouvelle, à partir de 2007, j’ai fermé les anciennes, plus douloureuses, et ouvert de nouvelles pistes à mon cheminement en écriture dans lequel la poésie, sans que je m’y attende, est revenue en force.
J.-Y. C. : Quel regard jetez-vous aujourd’hui sur votre travail d’écrivain ?
« Solitude » et « partage »… Ce sont, me semble-t-il, les deux mots qui conduisent (ou devraient conduire) toute démarche d’écriture. La solitude est celle, indispensable, de l’auteur. Le partage est ce qui justifie cette dernière, lui donne tout son sens, en établit le prix… Il n’y a d’écriture que dans la solitude. Il n’y a d’écriture, non plus, que dans le partage avec l’autre, sans lequel elle n’est qu’une source qui meurt avant d’avoir trouvé le chemin de son lit.
Les mots sortent toujours d’une longue nuit, dans un tempo intime qui cherche à prendre voix. Avancer dans la solitude de l’écriture, c’est avancer dans notre vie par degrés successifs et souvent par degrés de questions non résolues, de mystères qui sont des marches dans l’obscur. Et ces questions sont des brèches dans notre avancée vers plus de lumière, vers plus de sens aussi dans notre propre généalogie comme dans notre rapport au monde en même temps qu’à l’autre.
Par ailleurs, je reste obstinément attaché à des choses qui sont en train de disparaître (ou sont très sérieusement ébranlées aujourd’hui) : l’authentique littérature et le livre-papier qu’on travaille aujourd’hui à « dématérialiser ». Dans la solitude de mon travail d’écrivain, je me sens généralement comme un pommier dans un verger abandonné, qui continue obscurément, absurdement, à produire ses pommes, pour personne, ou pour pas grand monde, sauf pour les quelques pillards qui viennent s’y aventurer. Sentiment heureusement tempéré et adouci par le travail de pas mal de petites maisons d’édition (dont L’Amourier ou Noir & Blanc) qui restent attachées aussi à ces mêmes valeurs. La seule raison de poursuivre cette tâche, c’est l’amour de l’art et de la belle chose écrite, c’est-à-dire de l’esthétique, et les quelques pépites qu’on arrache à soi-même, et ce qui nous permet d’éclairer un peu notre chemin d’homme. Par ailleurs, même si je lui accorde le meilleur de moi-même, je ne crois pas à l’ importance de mon œuvre, encore moins à sa postérité. J’en mesure et relativise la valeur et la portée, tout comme celle de la notoriété après laquelle courent beaucoup d’auteurs. Je crois juste être sur un chemin d’existence où je vais de l’avant, toujours vers l’inconnu, et dans l’accord le plus exact avec moi-même. J’écris juste pour être et me sentir vivant… J’aime ces mots d’Edmond Jabès : « Je suis. Je deviens. J’écris. Je n’écris que pour devenir. » Le reste, les publications, les quelques lecteurs qui me lisent et apprécient ce que je fais, c’est un supplément de bonheur que je goûte à sa juste valeur, car on écrit aussi pour partager, sinon cela n’a pas vraiment de sens. Mais ce qui importe avant tout, c’est le cheminement. De soi même à soi même. En passant par les autres.
J.-Y. C. : Votre intérêt pour le genre de la nouvelle ne se dément pas puisque Partage des Eaux est votre 4ème recueil et que vous dirigez la « collection nouvelles » aux éditions de L’Ours blanc. Pourquoi un tel intérêt à une époque où le roman tend à envahir tout l’espace ?
M.D. : Je lis peu de romans d’auteurs contemporains dont la production me paraît, dans l’ensemble, assez peu attrayante. Mais c’est vrai, le roman tend à envahir tout l’espace, en France en tout cas, où il impose ses diktats et exerce une véritable domination sur tout le champ littéraire. Je dirais même qu’il exerce sa dictature sur toute autre forme de création. Il est devenu un genre impérialiste, dans le pire sens de ce terme, qui tend à étouffer tout ce qui pousse autour de lui. Et même dans les rares émissions littéraires qui nous restent, à la radio, à la télévision, souvent bien ennuyeuses, il est toujours le seul et l’unique invité. Entendons-nous pourtant : je n’ai rien contre le roman, en tant que genre littéraire, il y a encore aujourd’hui d’excellents romanciers, mais ce que je déplore c’est qu’il soit devenu un produit commercial, au même titre que n’importe quel autre objet de consommation. Il est, dans la plupart des cas, sans saveur, sans odeur, formaté selon des critères qui en font un produit périssable, qu’on achète, qu’on lit et qu’on jette, un « produit de confort » qui fait passer le temps. En prenant quelques raccourcis, je dirais que nous ne sommes plus dans la vraie création littéraire, repoussée aujourd’hui dans des marges où elle est devenue quasiment invisible au yeux du grand public, presque clandestine, dans la mi-pénombre des petites maisons d’édition. Mais nous sommes là dans un processus qui relève presque de la production industrielle et procède de l’uniformisation générale de la pensée. C’est un triste constat, mais c’est aussi une situation dont tout le monde s’est rendu complice : les éditeurs, en premier lieu, à l’affût des prix littéraires qui feront vendre du papier et travaillent à racoler le plus grand nombre de lecteurs, les auteurs, « écriveurs » plus souvent qu’écrivains, qui se prêtent complaisamment à ce jeu, les diffuseurs et les distributeurs qui ne sont attentifs aussi qu’à leurs chiffres d’affaires.
Faire publier des nouvelles, aujourd’hui, en France, relève du parcours du combattant, et quand on parvient à les publier, les « marchands » de livres qui règlent le marché de la distribution, et même les (rares) libraires qui restent fidèles à leur métier, hésitent à les commander auprès de l’éditeur, car ils savent qu’ils auront du mal à les vendre. D’ailleurs, aux yeux de nombre d’éditeurs, même des plus importants sur la place, un auteur ne peut véritablement gagner ses galons d’écrivain que s’il est capable d’écrire un roman, la nouvelle n’est qu’un genre mineur destiné à « se faire les griffes » avant de s’attaquer à des choses plus sérieuses.
Ce phénomène (pour des raisons qui concernent aussi notre histoire littéraire) est singulièrement important en France. En Belgique, et dans les pays anglo-saxons, la nouvelle est un genre honorable et prisé, reconnu à sa juste valeur. Si le nom d’Alice Munro, Canadienne, est un peu connu, en France, depuis deux ans, c’est grâce au prix Nobel qui a récompensé un genre qui, avant elle, ne l’avait jamais été. Si celui d’Annie Proulx l’est un peu aussi, c’est grâce à l’adaptation de l’une de ses nouvelles au cinéma, Brodeback Moutain, qui a eu pas mal de succès.
Pourtant, tous les grands auteurs ont écrit des nouvelles, Balzac, Mérimée, Flaubert, Maupassant, M. Aymé, A. Camus, D. Boulanger, A. Chédid, J.-M. G. Le Clézio, si je prends au hasard quelques auteurs français… mais encore Cervantès, Gogol, Tchékhov, Poe, Melville, Kafka, Sweig, Mann, Faulkner, Dos Passos, Fante, Buzzati, Cheever, Carver, Cortazar, Findley, J. C. Aoste, et tant d’autres, on pourrait allonger la liste de dizaine de noms, mais ce serait très fastidieux… Mon intérêt pour la nouvelle tient au fait que, selon moi, son écriture s’apparente à celle de la poésie. Ecriture « ramassée » qui fait tout l’intérêt du genre: action centrée sur un seul événement, personnages peu nombreux, raccourcis littéraires, concentration des faits et des idées, intensité dans l’émotion, plongée brève, soudaine, profonde, dans la complexité des êtres et de la vie. Une nouvelle réussie est un concentré de tension dramatique, un cocktail d’émotions qui vous explosent à la figure… S’attaquer à cela, réussir à y parvenir, réclame une maîtrise de l’art littéraire qui, quand on la voit à l’œuvre chez ceux que j’ai cités plus haut, n’est pas le fait d’auteurs novices mais celui de maîtres en littérature. Essayer de marcher sur leurs traces relève du défi qu’on se lance à soi-même…
J.-Y. C. : L’art occupe une place importante dans votre bibliographie. Partage des Eaux traduit une perception très forte de la nature. Comment vit-on cette tension entre l’art et la nature ?
M. D.: Je ne vis pas le rapport à la nature et à l’art comme une dualité, une opposition, une tension, mais comme une riche complémentarité. L’art s’est toujours nourri de la nature (il suffit de parcourir l’Histoire de l’art depuis ses origines et celle de la littérature depuis l’Antiquité), et le travail de la nature (même dans ses manifestations les plus inquiétantes et ses phénomènes les plus violents), relève d’une nécessité intrinsèque qui parfois nous échappe et revêt souvent à nos yeux des aspects d’œuvres d’art. Cela dit, je suis un citadin, mais ne suis pas un écrivain de cabinet (que je réserve à la mise en forme des textes, au travail d’horloger de la réécriture, ce qui peut prendre beaucoup de temps). Aujourd’hui que j’en ai le temps, le plus vif de mon travail se fait en marchant plusieurs heures par jour sur les chemins, au bord du fleuve, à travers bois, par tous les temps, dans le vent, sous la pluie ou la neige… Je rêvasse, je réfléchis, je prends des notes, j’écris des bouts de phrases, je cherche le mot juste, le bon rythme du texte, la musique du sens… A ceux qui me croisent, je donne l’impression de ne rien faire, mais en vérité je travaille… Je ne cesse vraiment jamais d’écrire, même quand je reviens sans avoir écrit un seul mot. Revenir avec des idées, des projets d’émotions à transmettre, des images à exploiter, c’est ne pas revenir bredouille.
Mon attention à l’art tient au fait qu’il est le medium le plus efficace et le plus pertinent pour exprimer et explorer l’âme humaine dans ses aspects les plus complexes et ses replis les plus obscurs. L’art, il est vrai, est assez impuissant à réduire le Mal sur la Terre et à lutter contre les perversions, profondes et indéracinables, de la nature humaine. Mais il reste le moyen de grandir et de cultiver les ferments de la spiritualité, c’est-à-dire de s’élever au-dessus de soi-même et des contingences qui nous astreignent à n’être que sujets de nos propres désirs et, aujourd’hui, d’un individualisme galopant qui étouffe le monde. Travailler avec des artistes, photographes ou peintres, m’aide à apprendre beaucoup sur moi-même, car en interrogeant l’œuvre des autres, c’est moi-même que j’interroge et en moi que j’approfondis ce vers quoi, peut-être, je ne serais pas allé de moi-même. Cela dit, encore, marcher à travers champs, à travers bois ou en suivant le cours du fleuve, c’est aller sous le ciel, dans l’espace du monde offert, n’être pas prisonnier de ses seules pensées, mais être aussi en empathie avec les choses, dans la complicité de l’eau, des arbres, de la présence d’animaux furtifs… Patauger dans la boue des chemins, entrer dans l’amitié d’un arbre, dans les confidences du fleuve, voir pousser les premiers perce-neige et observer des pies qui bâtissent leur nid, c’est s’inscrire dans le temps même, le cycle des saisons, et se sentir d’ici et maintenant, dans le cours ininterrompu de vie et de mort qui règle toute chose.
J.-Y. C.: Comment nous présenteriez-vous votre recueil « Partage des eaux » ?
M.D.: C’est un recueil de six textes, bâti comme les précédents autour d’une thématique qui assure sa cohérence. La « ligne de partage des eaux », c’est aussi, en randonnée dans la montagne ardéchoise, le chemin de crête qui sépare deux bassins versants, l’un qui descend vers l’Atlantique, l’autre vers la Méditerranée. Métaphoriquement, c’est le chemin des jours semé des aléas, ou des accidents de la vie qui peuvent nous faire basculer sur des versants imprévisibles de nos existences. Je m’applique, dans ces nouvelles, à décrire des situations de passage qui, en quelques heures ou en quelques minutes, quelquefois en un court instant, peuvent changer le cours de nos existences, en bouleverser la trajectoire pour le meilleur ou pour le pire. C’est toujours la même chose qui me requiert, d’une nouvelle à l’autre, d’un recueil à un autre, mais j’essaie chaque fois d’en varier l’angle d’approche. Encore une fois, il me semble que c’est la nouvelle, dans la brièveté de sa forme, sa fulgurance narrative, qui est à même de mieux rendre ces à-coups du destin.
J.-Y. C. : Certaines de ces six nouvelles évoquent des expériences ou des drames très intimes. Peut-on ainsi scruter l’intime sans y mettre beaucoup de soi ? Le lecteur est très tenté de faire beaucoup de projections sur l’auteur lui-même…
M.D. : On ne peut scruter l’intime des êtres qu’en y mettant nécessairement beaucoup de soi. Et de ceux qu’on connaît ou qu’on croise. C’est inévitable et indispensable, me semble-t-il, car la première matière de l’écriture, c’est d’abord soi-même, et les humains, autour de soi, qui font partie de notre paysage et sans lesquels, il faut le dire, nous ne saurions vivre. Mais écrire, pour ce qui me concerne (et au demeurant pour la plupart des auteurs), ce n’est pas faire un « copier-coller » de la réalité. Entre l’œil du photographe, celui du peintre, et la réalité du monde qu’ils cherchent à traduire, il y a la distance de la technique et tout l’artifice de l’art. Les tournesols de Van Gogh et les pommes de Cézanne, ou le bœuf écorché de Rembrandt et les natures mortes de Chardin, ne sont que les effets de l’art, le produit d’une création, ou d’une re-création. Le résultat, toujours, d’une « transposition ». Certains lecteurs, souvent parmi les proches, croient voir entre les lignes l’image exacte de l’auteur, une projection de son être le plus intime, ce qui ne va pas, quelquefois, sans créer de malaise, car ils ont l’impression de pénétrer, comme des voyeurs, dans quelque chose qui, dénué de pudeur, leur révèle ce qui, normalement, devait rester caché. Mais la page est l’écran sur lequel on projette des ombres, les images fixes et déformées d’une réalité mouvante que l’on a saisi un instant (ou cru saisir) , à un moment donné, avant qu’elle s’échappe encore dans le paysage incertain du psychisme et de la mémoire. Mais pour être plus explicite encore, je dirais que dans le processus d’écriture des personnages réels apparaissent en premier, puis le travail de l’écriture les triture, les déforme, les transforme, les modifie, pour en faire des personnages de littérature. J’oublie qui les a inspirés (même quand il s’agit de moi-même), ils deviennent des êtres autonomes qui ont leur propre existence, des personnages à part entière qui vivent leur vie en dehors de la mienne. Ils ne sont qu’objets de pure écriture.
J.-Y. C. : Vous semblez déborder d’activités, vers quels univers, vers quelles pentes allez-vous maintenant cheminer, pour reprendre la métaphore de Partage des Eaux ?
M.D. : Le cheminement, pour l’instant, consiste à travailler à la publication de cinq ou six ouvrages (poésie, nouvelles, livres d’art et peut-être théâtre) achevés au cours de ces derniers mois. Qui mettront sans doute deux ou trois ans à apparaître – s’ils apparaissent.
Vers quelle pente mes pas me conduisent ?… Je ne saurais le dire exactement, mais cela dépendra aussi de la surprise des rencontres et de la santé de mon inspiration. Mais surtout, sûrement, du désir de poursuivre la route et de croire en ce que je fais. Ce fil ténu que guettent, à chaque instant, le silence et l’indifférence, le doute et la désespérance. Mais ce sont là les pierres du chemin. Celles sur lesquelles je passe, sur lesquelles parfois je butte. Pour le reste, je ne puis avancer que vers l’incertain, l’inconnu et l’inattendu, dans ce qui n’est que perpétuelle remise en question et trouée dans le noir.
Février 2015
* * *