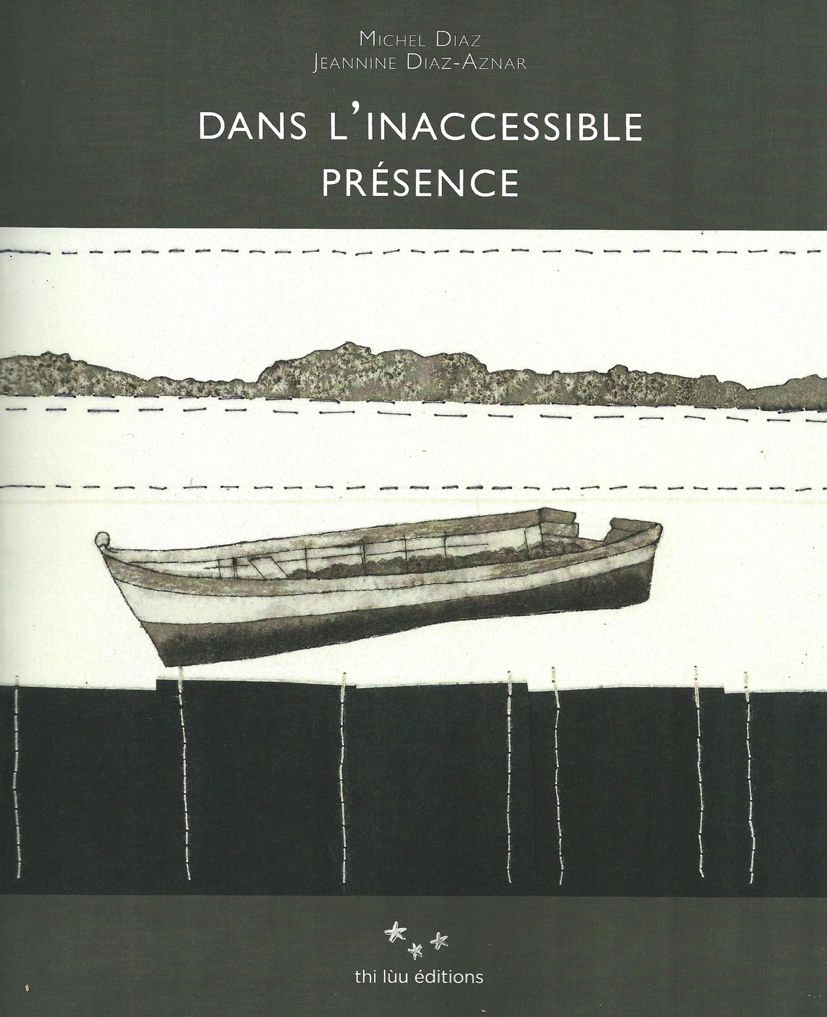BASSIN-VERSANT, éditions Musimot, avril 2018
Le monologue d’Orphée.
La poésie contemporaine est souvent, me semble-t-il, l’espace de l’incertitude. Qui parle ? A qui ? De quoi ? Pourtant, dans le dernier opus de Michel Diaz, les deux citations proposées en exergue, de Lorca et de Nietzsche, nous mettent d’emblée sur la voie de sa réflexion poétique: si « la terre est notre probable paradis perdu », la poésie est sans doute le seul moyen de nous sauver de la désespérance et de ne pas « mourir de la vérité » du monde. Ce livre commence comme un écho au Discours de la Méthode : « Être là. Et suspendre son pas (…). S’arrêter. » Mais le texte s’installe très vite au-delà du cogito cartésien puisque la pensée est elle aussi mise en suspens : « N’être que cet instant »,comme si la conscience individuelle était appelée à se diluer dans l’indéfinissable infini cosmique.
Le précédent ouvrage de Michel Diaz * nous emmenait à travers le temps d’un hiver jusqu’à l’inéluctable mort de celui qui avait choisi d’en finir avec lui-même ; cette fois, la situation s’est sensiblement modifiée; la voix de l’auteur émane d’une conscience de l’être-au-monde qui traduit le refus d’une vie qui nous voûte, sur laquelle nous ne savons pas toujours comment poser nos yeux, mais qui est aussi conscience de la mort, obsédant sentiment de vivants dont nous ne pouvons nous défaire, qui nous garde toujours en veille. Est-ce là poésie de « veilleur » ?… On le croit, carnous sommes bien ici dans l’arrêt, dans l’entre-deux, entre un passé déchiré en lambeaux et un futur menacé de néant, sur cette limite de l’être où nous pouvons basculer dans un bassin-versant ou dans un autre.
Tel un nouvel Hamlet, l’auteur explore lui aussi le thème inépuisable de l’être et du non-être et se décrit, fragment après fragment, comme encerclé de vent, de pluie, d’ombre et de nuit.
Nous sommes là, sans aucun doute, sur le théâtre de la tragédie du vivre et du mourir puisque le poète apparaît, à plusieurs reprises derrière des personæ : un arbre veillant comme une sentinelle dans une nuit de tourmente, un ange très baudelairien, et même la grande Anna Akhmatova qui introduit soudain une lumière rédemptrice en associant le bleu du ciel au champ lexical du jaune : colzas, jonquilles, pissenlits, bouton d’or.
Habituellement, un bassin-versant entraîne des rivières vers un fleuve et ce fleuve vers la mer. Si la présence de celle-ci demeure discrète, la figure de son homonyme, la mère, ce « tournesol tragique » comme la définit admirablement l’auteur, se dresse avec d’autant plus de force qu’on déplore sa définitive absence. Toutefois, l’absence est féconde d’une hantise qui donne accès à la connaissance sensible qui est le propre de la poésie : « J’apprends ce que j’ignorais d’elle, ce que je ne savais pas de moi ». Le souvenir des disparus a donc le pouvoir d’élucider nos mystères les plus intimes, et la parole poétique serait l’outil le plus adéquat pour en laisser un témoignage.
D’où la question fondamentale qui donne son titre à l’une des sections de l’ouvrage (adressée aux errants sur la terre, exilés et « migrants »): « Quel Orphée pour quelle Eurydice ?». En effet, si Orphée est le terme générique capable de désigner tout poète, le nom d’Eurydice se prête à de multiples interprétations. C’est sans doute pourquoi cette Eurydice indéfinissable ne peut être espérée autrement que sous l’apparence d’un « visage, addition de tous ceux rencontrés », qui ne sont que visage de « l’autre », notre frère en humanité, mais aussi le « visage, reflet de soi ».
Et ce « reflet de soi » est d’abord ce qui tâche de porter voix, de soi vers l’autre, du plus intime vers ce qui, au-delà de soi-même, s’ouvre à l’universel. Car, si dès l’aube, tout est dit, il nous reste pourtant, aiguisant la faim qui nous tient debout, à interroger sans cesse et indéfiniment le fait d’être sur la terre, à s’émerveiller autant qu’on le puisse des « jours qui nous reviennent en ressac », de la lumière renaissante du soleil, de l’arbre debout dans le ciel ou de la« persévérance de l’herbe », et de ces menues choses qu’on peut voir et entendre de l’insaisissable réalité du monde, pour peu qu’on y soit attentif – ce peu de choses qui nous tient vivants dans cet étrange et si fragile sentiment de l’existence, cette sorte d’ivresse éphémère (peut-être dérisoire mais combien précieuse !) qui naît du désespoir lui-même et des jours noirs du monde où « l’air que l’on respire est quelquefois terrible ».
On l’aura compris, la prose poétique de Michel Diaz, innervée d’un imaginaire foisonnant, nous entraîne dans une méditation dont les arrière-plans philosophiques sont clairement assumés.
Une réussite de ce texte – parmi d’autres – est de nous entraîner dans un perpétuel mouvement alors même que le poète se présente statique, dans l’attitude de qui s’arrête et prend le temps de regarder le monde pour l’interroger ou se laisser glisser dans les plis de sa rêverie méditative. Alors, puisque la vie est le vaste théâtre du monde, laissons-nous emporter par un verbe inspiré qui se propose de nous ramener au plus près de nous-mêmes.
Jean-Marie Alfroy
* Fêlure, aux éditions Musimot, 2016.




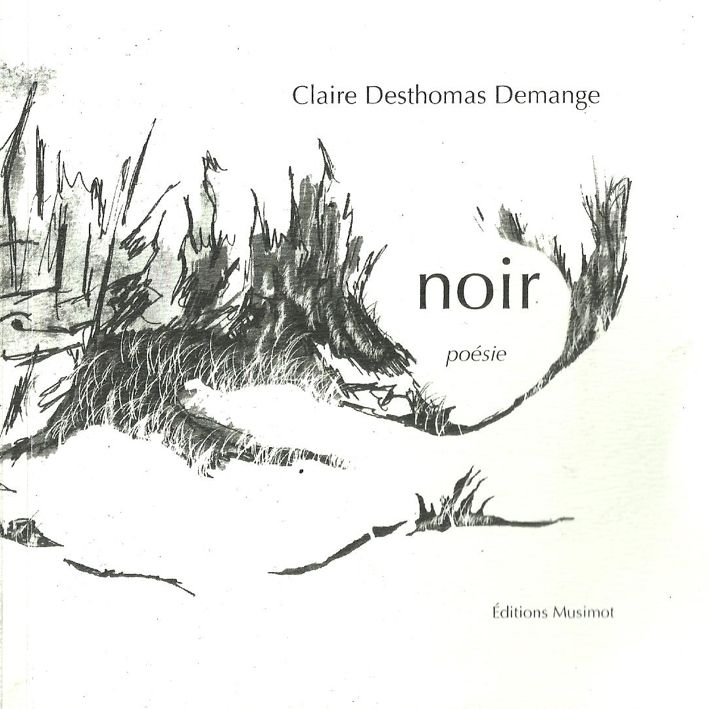 NOIR, Claire Desthomas-Demange, éd. Musimot (2017)
NOIR, Claire Desthomas-Demange, éd. Musimot (2017)