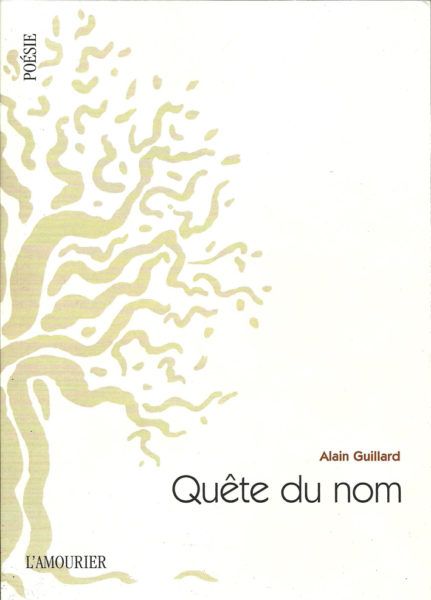 QUETE DU NOM – Alain Guillard
QUETE DU NOM – Alain Guillard
Editions L’Amourier (2016)
Chronique publiée sur le site des Editions L’Amourier et dans le N° 38 de la revue L’Iresuthe, sept. 2016.
Cet ouvrage d’Alain Guillard est un objet bien singulier (mais les autres le sont-ils moins ?). La poésie y est, comme toujours, sève d’une écriture qui varie ses modes et, dans une syntaxe souvent libre de toutes contraintes, s’autorise quasi tous les genres.
Aussi ce livre est-il à la fois un assemblage de poèmes, de proses poétiques, de fragments narratifs, descriptifs, de croquis saisis sur le vif, de réflexions souvent, d’aphorismes parfois (« On exige de la vie au lieu de remercier. Ne pas écrire contre. » Ou « Pardonner n’est pas oublier, mais admettre le temps. »). Son auteur ne se prive pas non plus de convoquer, tout au long du continuum obstiné de ce que l’on peut appeler une « autobiographie poétique », fragments de souvenirs en haillons de mémoire, éclats d’images du passé, tessons de scènes revécues, éléments de fiction, de journal intime, pages de confession que l’on prend, plus exactement, pour des instants de confidence (ces passages où l’auteur, sans s’y attarder, évoque ses expériences de travestissement et ces rencontres sexuelles équivoques). Son réalisme poétique autorise à tout dire, et la vérité crue, sans tricherie.
En dépit de ce que l’on pourrait, au premier abord, considérer comme un ensemble disparate, incohérent peut-être, (mais dont on ne doute pas une seconde que ce soit là une stratégie hautement maîtrisée), en dépit des ressassements, des retours en arrière ou ses sauts en avant qui court-circuitent la chronologie, des images répétitives, des scènes-leitmotive, oui, en dépit de tout cela, ce texte se révèle construit comme un tout et peut se lire aussi comme un récit qui déroule son fil d’Ariane et le garde toujours tendu.
Quête du nom… En vérité, c’est moins « le nom », c’est-à-dire une identité, que recherche l’auteur de ce texte que, sous le patronyme, le nostalgique souvenir d’une unité perdue. D’autant plus nostalgique, la quête, d’autant plus vaine et d’autant plus désespérée aussi que cette « unité » n’a jamais existé, ou si peu, et si mal. On ne se construit pas un paradis d’enfance sur ce qui, dès les origines, tient à peine debout, comme un mur mal bâti qui s’écroule à mesure, une famille composée, décomposée, recomposée ailleurs et aussi mal, spectacle d’existences qui se décomposent comme on parle d’un fruit qui se gâte et que l’on regarde moisir, lentement, impuissant.
L’histoire, et il y en a une ici, c’est celle de la trajectoire que la flèche brisée (ou mal empennée) ne peut suivre qu’en hésitant pour atteindre une cible qu’elle a perdue de vue, ou qui s’est dérobée ou qui, elle non plus, n’a jamais existé. « Lui, il boit, elle déprime, les enfants pleurent la nuit / Et c’est déjà fini, ils se quittent en ennemis. Ils avaient deux enfants et plus rien ne les unit. »
Nous sommes là dans un huis clos, entre les deux parents du narrateur, son frère (suicidé), et sa vieille grand-mère, dans des appartements étroits (un « taudis » dit la mère du sien), les fenêtres ouvrant sur un horizon de ciel gris et d’immeubles, dans le ressassement de la perte de tous ceux-là, un parfum insistant d’échec et de mort, d’amertume et de deuil, tout cela qui pourrait nous paraître étouffant si l’écriture ne lui donnait pas cette force qui nous étreint dès les premières pages, une force d’humanité, dans tout ce qu’elle a de plus dense et de plus questionnante douleur. « Papa, syllabe trébuchant dans le noir. Papa maman tus. Dos pointus laine noire. Lampe avinée errante […] Oiseaux / de si peu de poids / si présents / envahissant / La solitude des pièces // Epoussetant le silence / sur la tombe des morts… »
Ce qu’Alain Guillard nous raconte, c’est la vie d’un enfant, d’un adolescent et d’un jeune adulte, né dans une famille que n’a pas gâtée le destin. Dans la langue des sociologues, on appelle cela un « milieu défavorisé », ce qui permet de s’épargner beaucoup de choses, et en premier lieu toute tentation des bons sentiments au profit de la plus confortable analyse sociale. Mais appelons les choses par leur véritable nom, car ce sont d’abord les envers du monde ouvrier, du monde laborieux des ouvriers, des petits employés et des petites gens qu’Alain Guillard expose ici. Et le tableau qu’il brosse de ce monde-là, des gens qui le composent et dont il est issu, ceux des gens de la peine et de la frustration, de la vie amoindrie par toute absence d’avenir et usés à la tâche, il nous le livre, comme l’écrit Jacques Morin, « avec une vraie conscience de classe, très peu fréquente chez les poètes actuels. » Ainsi, ces images du père en ces raccourcis éloquents : « Silhouette tassée en casquette de toile grège / ta main / ongles ocre / sillons de crasse qui ne partiront plus / tâtonne dans la poche besoin d’une cigarette / à oublier ensuite éparpillée au bord des lèvres […] Mais que faire d’autre / quand on est ouvrier écrasé par / dans la pensée des autres ? »
Les portraits récurrents de ce livre, c’est donc celui du père « dans une veste de toile bleue, casquette sur le crâne raturé de quelques mèches restant, les mains poudrées de blanc », un père qui travaille chez Citroën, qui se détruit au zinc, bière après bière, et lentement s’égare, s’éloignant de tout, de tous et de lui-même. C’est celui de la mère qui regarde, par les carreaux, les passants dans la rue ou le manège d’un pigeon, « tricote bol de café clopes sur la table », une mère au foyer, « bonniche » chez les autres pour arrondir les fins de mois, et qui attend que son mari revienne, titubant, de ses soûleries de bistrot. On comprend, dès lors, ce que « le corps à corps entre père et mère puisait aux humiliations, frustrations de leurs vies respectives. » Des parents qui se hurlent dessus, se déchirent, se violentent et divorcent, la mère qui se remarie et retombera dans les mêmes pièges d’une vie médiocre et sans perspective, le père, délabré d’alcool, qui retournera vivre chez sa propre mère, une « mamy » qui, au milieu de ces désordres affectifs et de ces solitudes conjugales, restera toujours pour l’enfant, partagé entre ici et là, les uns, les autres, le repère le plus constant et sans doute le mieux aimant. C’est d’ailleurs avec son image que se conclut le livre, en évoquant « sa gourmandise de vivre si âgée que paupières noires figue à même l’herbe abeilles joie rire mon vieux cœur. »
Alain Guillard aurait mille raisons de détester ses origines et de cracher sur son enfance, de mettre père et mère dans le même sac du ressentiment ou de la colère. Il n’en fait pourtant rien et de ce peu qu’il a reçu (du moins le croyait-il), il tire des accents d’une juste et profonde tendresse. « Un corbeau me rappelle ma mère et déchire… Reconnaître l’amour; le plus ténu qui soit. Ou crever comme un chien errant. » Mais c’est aussi son père avec lequel, écrit Alain Guillard, « il n’a partagé aucune de ses expériences de vie », avec lequel, regrette-t-il, « nous aurons vieilli comme deux étrangers. » Pourtant, ajoute-t-il, « nous n’étions – tu vois – pas si éloignés que nous le pensions. » Ce père avec lequel les mots de l’affection n’auront pas su trouver leur voie. Et ce qui manque qui revient soudain, comme un « blues terrible après coup » et qui lui fait écrire « Je pourrais me tuer. » Pourtant, dit-il encore, « Mon père ma mère / Morts / Paix à leur âme /… Je marche dans leur ombre / dans l’ombre du soleil. » Et l’exergue à ce livre nous parle d’un « hommage » rendu à ces morts qui le hantent.
Je m’avancerai à dire qu’on ne comprendrait pas vraiment ce qui fait aussi l’unité de ce livre, si l’on ne saisit pas qu’il est écrit comme une partition de jazz, ou qu’il est bâti comme un long morceau où l’improvisation et les écarts autour d’une initiale ligne mélodique jouent de ces éléments qui font partie de ce qu’il a de plus intensément puisé à l’intérieur de l’être, à l’égal de ce qu’est le chant profond du blues, du flamenco ou du fado.
Ce texte construit, déconstruit, et qui se reconstruit sans cesse sous nos yeux de lecteurs autour de son thème initial, est celui de quelqu’un qui, en le composant, ne pouvait qu’avoir dans l’oreille et dans le rythme de la phrase, dans le mouvement de la main, ce que la musique de jazz est à même de nous donner. On trouve, ici et là, incidemment, les noms de Bill Evans, de Stan Getz ou de Chick Corea (on pourrait ajouter celui de Chet Baker), et il ne faut pas seulement les considérer comme de simples éléments de la culture musicale de l’auteur, qui participeraient, en fond sonore, à l’écriture en cours. Peut-être est-ce parce que je partage ces mêmes goûts musicaux que je dirais que ce sont là les noms de ceux qui, je crois, permettent à cette écriture de jouer aussi librement de ses modulations, participent à sa substance. Aussi, on pourrait dire que de celui-ci, ou bien de celui-là, Alain Guillard emprunte la couleur harmonique ou les subtilités rythmiques (accentuations et polyrythmie), les sonorités souples et feutrées, la douceur et le punch, des éclats de brisure et des soupirs profonds.
Quoi qu’il en soit, cette « quête du nom », c’est celle de quelqu’un qui, par ses mots, cherche à remplir le vide de l’absence, retourne parfois contre lui la douleur et ce qu’elle peut contenir de violence retenue. Quelqu’un qui s’offre sur la scène de la poésie pour extirper de lui un déchirant solo de saxophone.
Michel Diaz, 25/04/16