Lignes de crête, de Michel Diaz.
Editions Alcyone (collection Surya)
ISBN : 978-2-37405-056-0
Michel Diaz, né en Algérie, vit à Tours où il a enseigné la littérature et l’art dramatique jusqu’en 2008. Spécialiste de l’œuvre d’Arthur Adamov, il lui a consacré une thèse de doctorat où il étudie ce qui en constitue la radicale singularité. Attiré très tôt par la poésie, il a surtout, d’abord, écrit pour le théâtre une douzaine de pièces dont quelques-unes ont été publiées (P.-J Oswald, J.-M. Place), représentées ou diffusées à la radio sur France-Culture.
Il est aussi l’auteur, chez différents éditeurs (P.-J. Oswald, J. Hesse, Chr. Pirot, L’Ours Blanc, Cénomane, Musimot, N & B, L’Amourier), de cinq recueils de nouvelles, d’une dizaine de livres d’art (poèmes et proses poétiques) en collaboration avec des artistes, peintres ou photographes, et de plusieurs ouvrages de poésie. Il a également contribué à de nombreux livres d’artistes à édition limitée et à la réalisation de « livres pauvres », à destination de médiathèques, musées, ou collections privées.
Lignes de crête, fragments d’errance, livre nourri des rêveries, méditations et réflexions suscitées par la marche, s’articule en quatre parties successivement adressées à Walter Benjamin, Friedrich Hölderlin, Claude Cahun et Alejandra Pizarnik. Deux femmes, deux hommes. Quatre figures de penseur, artiste et poètes, dont le parcours de la pensée, la vie sans concessions et le destin tragique, dessinent des figures d’une intense humanité. C’est porteur de cet héritage irradiant ses forces obscures et lourd d’ombres incandescentes que l’auteur de ce livre chemine, en bordure de failles, en suivant, sur la sente des jours noueux, le tracé incertain et mouvant de ses propres lignes de crête, mais les yeux posés sur un horizon qui ouvre, là-bas, vers demain, sa lumière toujours espérée, ses clartés parfois reconquises dans un élan inassouvi d’acquiescement au monde.
Vous pouvez écouter des poèmes de Michel Diaz, lus par Silvaine Arabo, sur le site des éditions Alcyone, en cliquant sur la flèche du fichier MP3, en bas de page.
TEXTES
Préambule (extrait)
Pays enveloppé de silence, de nuages et de bleu, recouvert d’une brume légère ou d’un voile, celui de la patiente réticence à s’offrir à qui ne le mérite pas.
Un oiseau déchiré par le vent tombe dans l’herbe haute, pousse un cri échappé à la nuit, qui a gardé un peu de givre et de chaux vive.
Monte un chant de dessous les pierres, apporté par le même vent, une voix inaudible mais qui, parfois, peut faire peur sous la machinerie colossale du ciel.
Et devant, ces chemins qui s’enfoncent dans la montagne, se perdent à travers les sapins et les hêtres, parmi les buissons de gentiane et de genévriers, sinuent sur les lignes de crête, s’égarent sur l’infinitude des hauts plateaux où l’on perçoit l’écho lointain, déformé par le temps, du sauvage et du primitif.
Aussi, quand les semelles foulent les cailloux, dérangent leur silence, on entend le son sourd, mat et puissant, cette respiration comme animale, de la solitude saturée de présence, que l’on cherche à traduire, non par les mots de la parole, mais par une manière de musique, par un rythme intérieur, un obscur battement, comme une cadence du sang, qui est ce qui respire tout autour et nous réaccorde au vivant.
Comme si, passant à travers un rideau, sans même s’en apercevoir, on entrait dans un autre monde. Celui de ce réel dont nous avons perdu l’usage.
Mais c’est aussi une avancée, sans césure, dans l’écoute du monde invisible où s’enracinent nos pensées les plus archaïques et dont nous recherchons toujours la clé: […]
**
feu de joie
il n’y a que l’errance
qui soit son début et sa fin
sur ce peu de terre habitable
où la mort est toujours plus vaste
les sables du désert plus proches
plus nombreux ces vents de folie
de poussière et de sel
qui défient le soleil
cette bouche d’enfer
il n’y a d’horizon
pour les yeux faméliques
dans le jour aveuglant et torride
que ces mirages secourables
au sang usé des illusions
et la vieille et vaine souffrance
de l’humaine calamité
alors aller
marcher en claudiquant
dans la conjonction suffocante
des astres et le noir de fumée
– sur le bûcher des certitudes
nous n’avons plus au cœur
qu’un sombre feu de joie
et une boussole brisée
**
passage du col
sur le plus âpre du
versant les nuages s’écorchent
suintent un sang pâle qui s’en va
vers des migrations hasardeuses
le ciel
est un miroir au bleu fêlé
où traîne encore un peu de l’ombre
que les vents de la nuit ont posée sur la terre
là qui est
sans y être
quelque chose est là
où la respiration se pose
en bordure de l’air
où le cœur attend que la brume
achève de se déchirer
quelque chose qui tourne
à l’angle du silence
avec pour tout bagage
la seule couleur de l’instant
– rapace
qui dérives
milan les yeux aveuglés d’aube
ignorant le regard de celui qui l’observe
cherchant à quoi se noue
suspendue ainsi dans le vide
la force de ta solitude
son féroce et indépassable héritage
ton plané silencieux
dessine le tracé d’une âme
perpendiculaire à la mienne
guide l’air qui descend et
remonte dans ma poitrine
il n’y a pas de quoi
se sentir misérable
de marcher dans la même blessure
tout au long de sa mort
ici
le jour levé
dans ses exhalaisons terrestres
et son immensité perdue
sur les chemins des pierres
est un baiser léger posé
sur mon épaule
cela suffit
à la très humble mais fervente joie
de se sentir vivant !
ici
au milieu de ce qui est là
après les sueurs de la nuit
apparaît parfois dans les clairs de jour
et n’a jamais de cesse
dans son œuvre de force sourde
et de buisson ardent
Section Walter Benjamin
**
trobador
comme dans le blanc de ses linges
se révèle une absence accueillante
le passage d’une ombre que rien
ne laissait annoncer
parole est celle qui se cherche
dans l’émergence de son souffle
et son jaillissement de la source
au silence
un silence qui vibre
comme écho du destin
qui prend appui sur ce que l’ombre
cèle de possible clarté
un silence qui vient chercher
dans le remuement de la langue
ce qui livre et délivre
et que la parole ne savait pas
mais qui se disant la dépasse
devenant cet outil qui rêve
découvrant d’elle-même
ce qu’elle dit du monde
se consumant et s’éclairant
tout à la fois dans l’affirmation
de sa seule présence
présence au monde désaxée
dans son refus fragile
de n’être que dans l’évidence
où se tient l’apparence des choses
**
ardeur
la rose de mélancolie
et le vent des soupirs
ont échangé leur neige
pour attiser ce peu d’éclat
devenu larme ou songe
dans les labyrinthes d’un cœur
qui veillait sur sa lampe d’ombre
moment de l’aube
si belle écorchée vive
où se déchire le nuage illuminé
par la blessure d’une étoile
comme une rose de rosée
devenue flamme
– à la fin
une fleur inouïe et pure
s’échappe à la pointe de l’être
et tremble
à la fin
quand s’ouvre
la brûlure de l’esprit
jusqu’aux racines
Section Hölderlin
**
le châtaignier déraciné
versant ouest
ce qui vers le maquis bascule
gît cet arbre sabré
par la foudre
tête en avant jeté
dans le torrent des pierres
soulevant dans sa ruine
des éclats d’incendie
ses racines
dressées vers le ciel
sculptées dans le silence
lui sont un immobile poing levé
qui renverse l’ordre d’un monde
réglé sur la balance du soleil
dessus dessous se sont perdus
dans le chaos de la rocaille
invitant le regard égaré
qu’une lumière noire aveugle
à une désobéissance radicale
née de sa première stupeur
instant de nuit profonde
coulée de lave dans les yeux
où le temps suspendu
par une seule image
doit revenir dans le regard
qui doit apprendre à recouvrer
le temps de sa propagation
**
arbre avec oiseau
l’arbre tourne
son ombre vers nous
tilleul ou acacia
quand s’affutent nos soifs
sa main levée
sépare les nuages
pour ouvrir un berceau à la pluie
lui sait
couvrir nos corps de feuilles
leur tremblante clarté de vitrail
et déposer une prière
dans les plis de notre sommeil
avec l’oiseau
merle ou mésange
perpétuant les gestes de l’amour
ils peuvent rire de la mort
qui se prend au sérieux
ce pouls inerte
qu’une lame d’agonie balaye
entre la tombée de la nuit
et l’incertain lever du jour
mais c’est sans importance
rien ne persiste dans nos voix
qu’un vent jauni cherche à trancher
que les rêveries du matin
enlacées à quelque parfum
où se retrempe la lumière
qui danse entre nos doigts
Section Claude Cahun
**
à l’orée du silence
source qui cherche son chemin
regard lucide cœur égaré
creusant dans son errance
le lit d’un songe aventureux
source qui cherche son secret
au bord du soleil et des lèvres
à travers l’âpreté des déserts
et l’outre-moi du noir
immense
à l’orée du silence
et du vide à travers
son pays d’arbres morts
dans un murmure de poussière
où la lumière prendrait corps
pareille à un éclat de rire
aveuglant le regard
et dissipant la soif
clarté
comme un éclair de nuit
qui éclaire soudain par mégarde
ce qui nous échappait
**
qu’importe
qu’importe que les heures
viennent et s’en aillent
puisqu’il reste les fleurs et les arbres
qu’il y a de la pluie pour la terre
une rivière pour la source
et des moments pour le silence
une vague toujours pousse une autre
une trille de merle s’éteint
le cri d’une mouette
le temps passe dessus
sans qu’il s’arrête
sans qu’il creuse une ride
ou le sillon d’une blessure
une cicatrice de souvenir
comment mourir quand
on n’est pas sûr d’avoir existé ?
que l’on sait si peu de son nom ?
qu’on est que présumé ?
qu’on est de nulle part ?
d’une colline d’une plaine
du lointain de l’horizon flou
de la menthe du temps ?
il y a tous les siècles
à regarder venir
avec leur part de ciel
avec des nuits glaciales
des nuits chargées de solitude
avec des temps défigurés
des jours taillés en pointe de silex
et des rêves de déchirure
dans les rideaux qui battent aux fenêtres
il y a le chemin
sous le déroulé des nuages
avec ses bandes de clarté
qui traversent une terre blessée
un rire qui défie tous les silences
un visage étonné de tout
qui cherche dans ses yeux écarquillés
ses éclats dansants de soleil
et les lèvres charnues de l’aube
ce dont ton miroir se souvient
Section Alejandra Pizarnik
Extraits de Lignes de crête de Michel Diaz
© Editions Alcyone, 2019.
Pour vous procurer cet ouvrage :
/ envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : editionsalcyone@yahoo.fr
sans oublier de noter votre adresse postale : nous vous enverrons alors un
Bon de commande.
/ Cet ouvrage sera prochainement en vente sur www.amazon.fr
/ Vous pourrez commander prochainement ce livre en librairie.
Lignes de crête
de Michel Diaz
19,00€ + forfait port et emballage : 4,00€

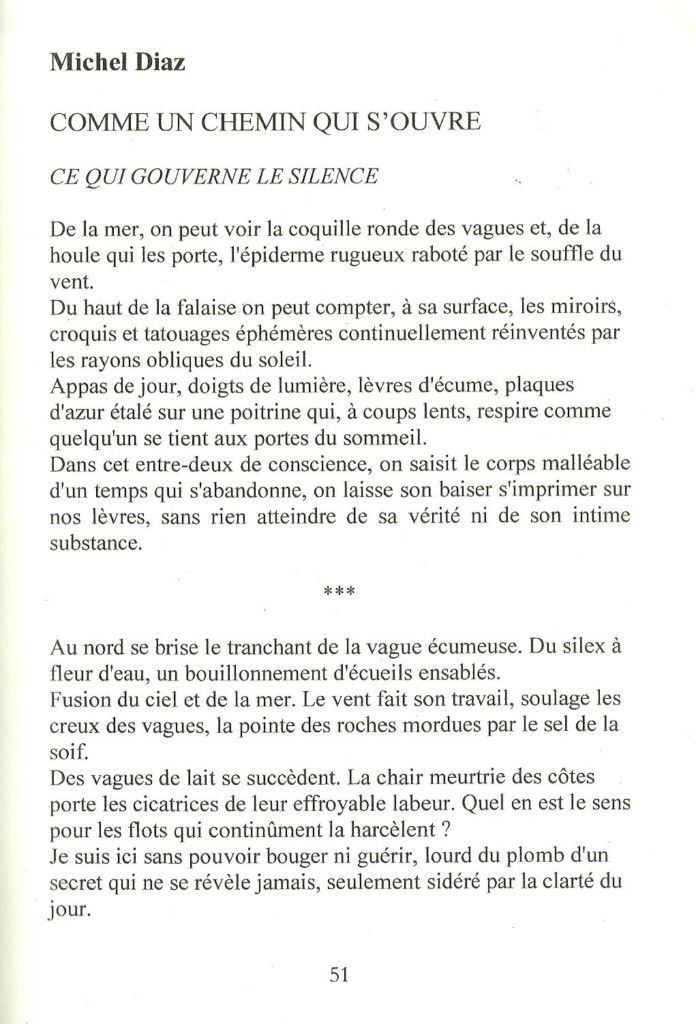
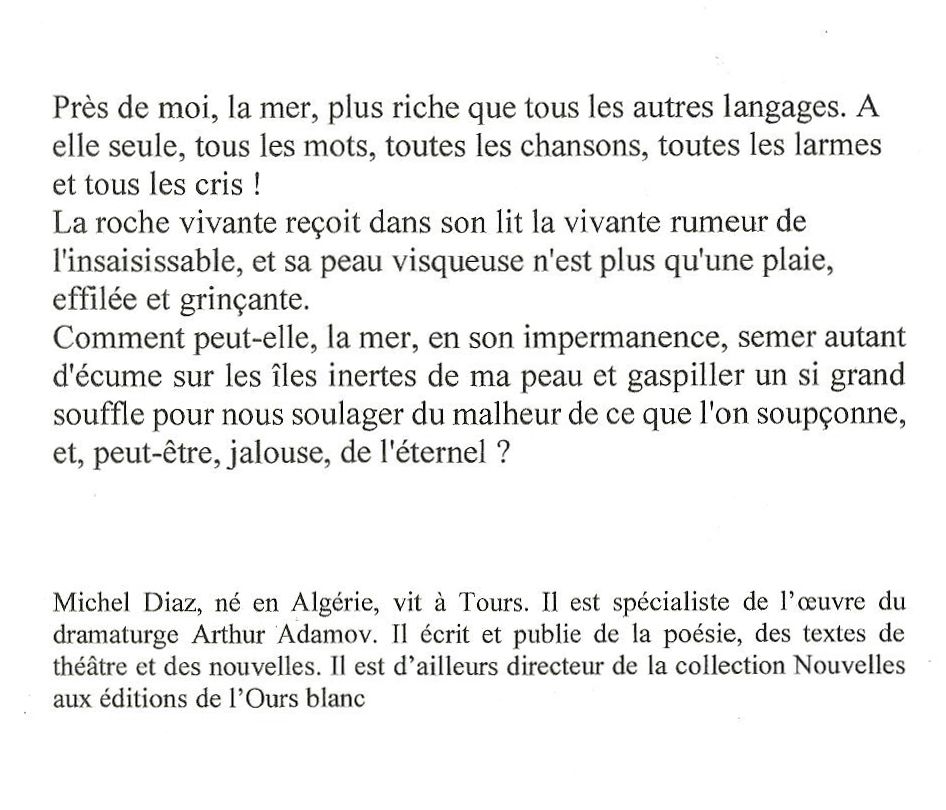
 DE SANG, DE NERFS ET D’OS – Patrice Blanc
DE SANG, DE NERFS ET D’OS – Patrice Blanc