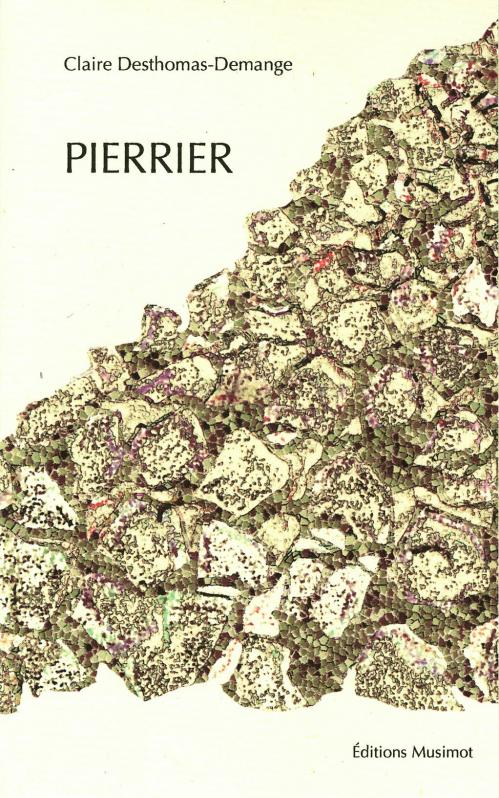La gloire des poussières
Raymond Farina
Editions Alcyone, 2020
Note de lecture publiée in Dièrèse N° 80
Sur la 4ème de couverture du recueil, La gloire des poussières, Raymond Farina écrit : « Pourquoi veut-on que les poussières ne soient que d’infimes fragments de choses et de vies défaites, ce que l’oubli dépose sur des meubles abstraits, des livres sans regard et des miroirs éteints ? » Question à laquelle il ajoute aussitôt celle-là, qui est déjà réponse à la première : « Destin de toute matière ne sont-elles pas la preuve évidente d’une dynamique élémentaire, vivantes parcelles d’élan, de turbulence, de fougue ? » Quelques lignes plus loin, dans ce même texte de présentation, il apporte à ces deux questions son éclairage poétique : « Plus tard, une fois de plus sur le versant de ce qui s’anime et anime, elles m’ont aidé à concevoir la fabuleuse activité de la grande Fabrique de l’Être qui d’invisibles particules tombant dans le vide fait la pierre et le miel, fait la terre et le feu, et même le corps et l’âme des humains qui peuplent le monde. »
Voilà donc qui confère à la poussière, matière de si peu dans notre imaginaire collectif, une haute valeur métaphorique dont Raymond Farina va nourrir sa démarche de réflexion sur le temps et le lieu du monde, la vie, la mort, l’humanité, réflexion traversée de ce que ses lectures y ont déposé, et de ses expériences d’homme. Il nous faut d’ailleurs remarquer que l’auteur utilise ce terme au pluriel, les poussières, le démarquant ainsi de l’utilisation littéraire ou, poétique que l’on en fait habituellement, à des fins généralement illustratives et négativement connotées de la fragilité, de l’insignifiance des choses ou, puisque « tout vient de la poussière et y retourne », de la profonde vanité de tout.
Il est aussi tentant de citer ici cet extrait de La part manquante de Christian Bobin, qui nous semble illustrer ce que Raymond Farina, qui fut professeur de philosophie, désirerait peut-être que nous éprouvions, vivions et partagions à la lecture de son livre et aussi de tous ceux qu’il a déjà écrits : « Ce qu’on apprend dans les livres, c’est la grammaire du silence, la leçon de lumière. Il faut du temps pour apprendre. Il faut tellement de temps pour s’atteindre. On va à l’aventure. On prend un livre dans ses bras, puis on le quitte, on va vers le suivant. Les livres sont faits de poussière. Les livres sont faits de vent. Les livres sont faits du plus précieux de nos songes : poussière et vent. On y chemine, on les traverse. On les oublie. »
Alors poussière et vent seraient donc aussi la matière de ce recueil de Raymond Farina ? Oui, si on y chemine et qu’on le traverse en se tenant au plus près de ce qu’il veut nous dire, en écoutant sa voix et ses mots de poète, c’est-à-dire de ce qu’il fait de ce « plus précieux de nos songes » : une parole sans personne mais qui, comme la poussière et le vent, s’élèverait en lents remous, « tourbillon aimanté à la fois par le ciel et par le lointain » qui nous passerait par le cœur et l’esprit « avant de disparaître, fascinante vision trop vite devenue mémoire » . Car, dit-on, la mémoire est ce qui demeure quand on a oublié tout le reste. Et ce qui nous reste en mémoire, solidement prégnant, quand on a achevé la lecture de ces poèmes, n’est pas moins que le sentiment d’une lumineuse lucidité, conquise à la force des ans, sur l’état et le cours du monde et des choses, la vaine agitation humaine et le mirage de nos illusions. Ainsi des puissants de ce monde : »Impassibles ces rois naviguent / dans leur solitude tranquille, / gardant dans leur parure / les ors de la grandeur ancienne //(…) Echappés de ces temps gothiques / où roi signifiait quelque chose, / ils côtoient, sur leur char à bœufs, / des bouffons & des clowns.. » Ainsi tout simplement de l’homme : « Pouvez-vous me dire pourquoi / ce qui, dans le monde animal, / est tourbillon d’ailes légères, / flèches de becs inoffensifs, / devient destruction méthodique/ quand l’accomplit la seule espèce / qui aspire à la perfection ?«
Comme le remarque J.-P. Gavard-Perret dans un texte critique, « Farina anime de manière placide (quoi que…) ce qui fait douter les dieux et affoler les statistiques (…). Tout cela, pour autant, n’amène pas au paradis : juste des clairières dont le viatique est moindre. Elles ressemblent « à des Cythère sibériennes / et des Pologne sans retour ». Et ces « Pologne sans retour », précise Raymond Farina dans son poème, évoquant l’insensé du monde où s’égare parfois la folie humaine, sont celles «où l’on faisait cendres des hommes ».
Mais les poussières, ce sont aussi ces riens d’assemblables improbables venus d’on ne sait où, que Raymond Farina, évoquant Lucrèce, décrit comme de « secrètes combinaisons d’atomes, devenus dans son rêve et le mien, minuscules grains de soleil dansant dans la lumière ». Dans ce recueil où se combinent de même ses poèmes, l’évocation des pouvoirs de l’artiste, peintre, violoniste, pianiste, l’invocation aux « soleils virtuoses, somptueux, grégoriens », le pouvoir aussi de l’imaginaire qui « propose un voyage absolu, sans cartes, sans escales », l’évocation encore de ce qu’écoute l’enfant qui « sait presque tout de la terre, sa rumeur sibylline, ses semences secrètes », cette « histoire de ciel / que nous raconte le bleuet », ou cette évocation plaisante « d’une fourmi sisyphéenne / poussant sa miette fatale / parmi les restes sur la table », tout cela, et bien d’autres choses encore, constituent l’ample matériau de cette écriture. Car Raymond Farina est aussi le poète de ces presque riens, rencontrés çà et là dans l’affût de sa présence au monde, ces poussières de vie dont le regard s’empare, de ces riens comme suspendus au-dessus, une chose coulant dans une autre, poussant celle qui suit, et comme au hasard de l’inspiration, et toutes se fondant dans un long travelling de pensée ou de rêverie : « Les cheminées font du tricot. / Toi, tu glisses dans leur douce, douce / spirale cachemire / au-dessus des toits étonnés ».
Mais Raymond Farina est aussi le poète de la fusion des états de conscience dans le même creuset poétique, puisqu’il « suffira d’un seul sourire / pour être l’ami du soleil / & la nuit nous chuchotera / à l’oreille tous ses secrets ». Un creuset où s’invite aussi la douleur, celle de la peine des pierres, témoins de tous les crimes que l’on a commis contre le vivant, hommes, bêtes et plantes, celle aussi du vieil homme « qui, montant les ans / descend, descend les escaliers / vers une cave sous la cave, / vers un long sommeil tellurique ». Creuset aussi d’une mélancolie où chemine une quête toujours poursuivie de menus miracles de bonheur furtif et de jubilation dans notre éphémère présence au monde, ce qu’il nous donne à voir, à entrevoir, et à goûter, qui est là et s’échappe aussitôt, qu’il nous faut sans relâche traquer et sans cesse attiser les éclats. Ecriture qui s’efforce de dessiner une mystérieuse ligne de crête, entre permanence et perpétuelle transmutation.
Ce livre est ainsi traversé d’une double instance : celle de la descente ou de la chute, dispersion ou disparition, et celle de l’élévation, ascension vers un ciel de quiétude. En effet, selon les principes de l’imagination dynamique, telle que l’a exposée Gaston Bachelard, il n’est pas de mouvement de chute qui ne se conçoive sans la contrepartie d’un désir d’ascendance, comme il n’est d’élan ascendant qui ne se double, dans le même temps, de la sensation de l’espace béant et de la nuit qui s’ouvrent sous et devant soi. On trouve ainsi dans ce recueil nombre de métaphores de la chute : « tâtonnant dans son amnésie, / harcelé même par son ombre, // il est venu enfin dormir / dans son île devenue piège, // dans sa maison devenue tombe ». Métaphores que viennent heureusement compenser celle d’un désir d’élévation, du mouvement qui accompagne tous les rêves de la volonté de croissance, celle qui tire l’arbre vers le ciel et l’esprit vers le haut dans son inexpiable nostalgie de la hauteur. Celle-ci par exemple : (le poète) « s’endort dans le bruissement / d’idées belles et volatiles / volant au Hasard leurs couleurs » » ; ou celle-là encore : « Pour celui qui lève les yeux / terrien cloîtré depuis longtemps / dans d’étroites chronologies, / c’est de sublime qu’il s’agit, / d’un tragique entre-deux / où l’homme se débat. »
Poussière et vent alors que cette gloire des poussières ? Mais poussière où secrètement s’élabore le miel de l’Être, et vent qui, on le croit, se chargera de laisser, sous les yeux fermés de nos songeries, ce qu’il y aura déposé de parole.
Michel Diaz, 05/11/2020