
UN SCARABÉE BRUISSANT DU RÊVE
Pascal Revault – Editions Musimot (2015)
Chronique publiée sur le site des éditions Musimot
« j’ai rencontré des formes glacées
trop immobiles et noires
pour des apparitions de ce temps
qui hantent les souterrains humains
leurs porches
et leurs dédales
comme des veilleurs
attendent
de sortir de leur chrysalide
nous rejoignent
et traversent nos flancs
d’une marche redoutable
et j’ai vu les mouches
s’acharner sur les yeux
du souffle pénible
d’un hérisson » (Ici au débord d’un mur)
Ce sont là des mots de fraternité adressés aussi bien à ces êtres de l’ombre (sont-ils hommes encore ?) qu’au hérisson agonisant. « L’autre » est pourtant celui, humain, qui traîne en clandestin le poids de ses misères, comme aussi, animal, celui qui meurt dans le silence de sa solitude, en seule compagnie des mouches.
Nous le voyons ici : prenant résolument appui sur ce que donne à voir notre fréquentation des êtres et des choses, l’écriture de Pascal Revault a pourtant quelque chose qui relève de l’onirique. En tout cas quelque chose qui, nous privant d’abord de nos repères, nous introduit dans un théâtre d’ombres et de lumières où ce que nous reconnaissons du monde revêt une autre dimension que les mots chargent d’une force singulière.
Cela est dû sans doute au fait qu’accordant moins de place à l’intériorité méditative et à l’introspection qu’à la dimension visuelle, cette poésie tournée vers le monde, ses maux et ses bonheurs, en un mot vers « les autres », privilégie une esthétique descriptive où ce qui y est dit se trouve aussi « dramatisé » (dans le sens plus « théâtral » de ce terme), c’est-à-dire donné à voir avant d’être donné à comprendre. Démarche aussi qui, s’emparant des éléments de la réalité (êtres, événements ou choses), en retient les lignes de force, les soulignant, les durcissant parfois, mais les dépouille bien souvent jusqu’au signe calligraphique, dans un geste d’épure qui leur fait perdre leurs contours initiaux pour nous ouvrir à d’autres perceptions, c’est-à-dire à d’autres aspects de la même réalité.
Ainsi, cet texte par lequel s’ouvre le recueil,
« un scarabée
retourne sa chitine noire
entre les rainures métalliques de la fenêtre
avant
tout bruissant des mains ensablées
qui cherchent à le caresser
de porter ce rêve
visible de l’Océan »,
mots où s’unissent, sous un même regard attentif, dans l’élan hésitant d’un geste, le respect bienveillant pour la vie, aussi humble soit-elle, et ce que l’envol d’un insecte par la fenêtre nous dit de nos aspirations à ces rêves de liberté que nourrit le grand Océan.
Ainsi, encore, très vraisemblablement, dans La lagune, le franchissement d’un pont métallique à la nuit tombante devient-il sous les doigts de l’auteur la descente d’un fleuve sillonné par « les corps des pirogues », substitution de ce que voit l’œil de chair par une autre vision, tout aussi recevable, où les yeux de l’imaginaire sollicitent les autres sens :
« j’aimerais bien écouter leurs pagaies
tinter contre les piliers
de cette langue de métal
sur laquelle nous roulons ».
De même, l’évocation d’un port en pleine activité (L’hôtel du port), on devrait dire en pleine effervescence, devient-elle la scène d’un monde livré à la folie d’une mécanique infernale où
« cela chuinte, grince, gratte, cogne
et craque, tape et craque
comme un fil de fer tordu
dans tous les sens au beau milieu
des sirènes et des avertisseurs »,
un monde déshumanisé (oui, bien sûr, « cela suppute, raconte, ronfle/ ripe et râpe, clique et claque », et « cela » nous paraît réduit à l’état de machines humaines), mais un monde où, soumis aux lois et au bon vouloir d’une « petite mélodie de cloches », de ces grues qui dévident leurs fils d’araignée, et de ces containers « rouillés et usés par le sel » dont nous ne savons ni ce qu’ils contiennent, ni d’où ils viennent, ni où ils vont, nous avons peut-être perdu l’usage de nos vies et la maîtrise de nos destinées.
Destinée à coup sûr, celle-là, lacérée par les guerres des hommes dont les ravages d’incendies se lisent encore sur le visage de cette exilée (Des yeux de fer glacés racontent), portrait en noir et blanc barré de cicatrices, où l’on voit qu’
« une larme bien dure
illumine ce visage et ses lèvres
qui ne tremblent plus
et soufflent ».
Celle-là fait partie de la « horde » de ces errants qui, fuyant « le bruit des bottes », s’échappent de l’embrasement de leur maison, « sans retour possible » et cherchent désespérément en se jetant
« dans le vaste déversoir
des mers à retrouver
de la chaleur humaine » (Les langages de l’exil).
Vaste troupeau hagard de
« ceux et celles qui partiront
les yeux éreintés de leurs souvenirs
d’animaux et de végétaux disparus
au milieu des vagues visqueuses qui dévorent la terre » (A la table d’un café sur terre)
Mais Pascal Revault ne compatit pas seulement aux drames et misères des hommes. Il prend aussi parti contre ces autres violences que l’homme inflige à la nature, sur toute l’étendue de la planète, la dépeçant jour après jour et la martyrisant, lui arrachant partout les cris de la souffrance, comme ceux de cet arbre de la forêt guyanaise, ces
« hurlements d’un corps énorme
qui chute
et précipite d’autres vies avec lui »,
et il nous laisse
« imaginer la trouée laissée dans ce ciel
baignée du soleil demain matin
pour d’autres vies » (Le chablis)
On voit que le recueil de Pascal Revault ne nous épargne pas la rudesse du monde, ce monde où « les chants hurlent l’espoir de vivre en rage » et où « les abeilles se font voler leur nectar par les humains » (Bien après l’île de Kos, Valérie). Mais il contient aussi des pages où l’évocation de l’autre, des autres, de la nature, des animaux, de la mer, des éléments, sont une ode à la vie et à la liberté, au pur et simple bonheur d’être et de se sentir pleinement vivant, de se dresser dans la lumière comme
« les peaux des arbres s’enroulent
vers le ciel en écartant leurs cimes
si forts, qu’on les entend déjà dire
l’incommensurable » (id.)
En témoigne encore ce texte, En mer, magnifiquement lumineux, qui évoque une longue séance de nage dans le large des eaux de la Méditerranée :
« la tête, les pieds et les mains heurtant les flots
avant de prendre un cap
c’est en mer la nage nue
l’écume des talons qui émergent
répond aux gouttes projetées par l’appui des paumes
et des épaules qui roulent
les bulles chuintées contre le torse
c’est mieux dévisager le fond
et les miroirs bleutés des ondes sous-marines ».
Et c’est alors, allant plus loin vers l’horizon et perdant de vue le rivage, que s’insinue la tentation de ne pas revenir, de se confondre avec le fond du ciel et l’étoffe des vagues,
« cœur heureux de sa propre chaleur qui exulte
vivre la nage de l’infini
non comme un désespoir
mais une chance à saisir
immense, de tout ce qui pourra s’accomplir ».
Tentation « d’aller de l’avant encore », non pour tenter l’orgasme torturé de la noyade, mais pour mieux se confondre avec les éléments dans la profonde exultation (mais on pourrait dire « l’extase ») de se sentir vivant, libre à ces instants-là de tout, et provisoirement oublié par le temps.
J’aimerais terminer ces pages en citant le texte, La ville des oiseaux, qui conclut ce recueil :
« à l’aube
le soleil
sommeille
quand les mélopées humaines
rejoignent
le chant des oiseaux
étonnés
puis surpris
par les pas
et les paroles
qui surgissent
des voûtes étoilées
de la ville qui se réveille
et les font se taire ».
Un scarabée bruissant du rêve est un beau livre qui ne cède jamais à la facilité, mais qui nous aide à espérer, comme dans le texte précédemment cité, que la Terre pourrait être ce lieu habitable où chacun trouverait sa place et qui permettrait, à l’aube des jours neufs et toujours à réinventer, que les voix qui la peuplent, par moments, se rejoignent.
Michel Diaz, 09.10.16

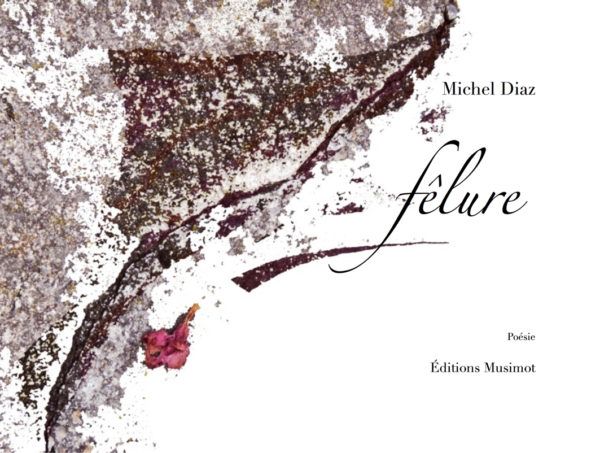
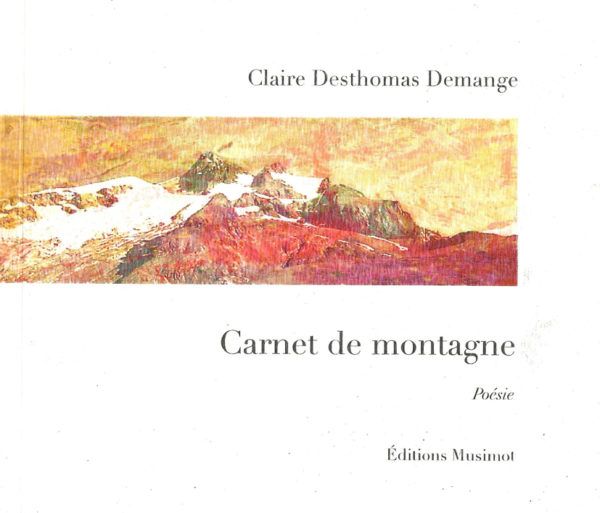

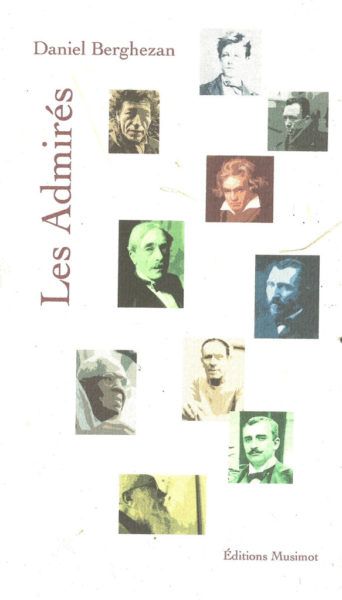 LES ADMIRES – Daniel Berghezan
LES ADMIRES – Daniel Berghezan