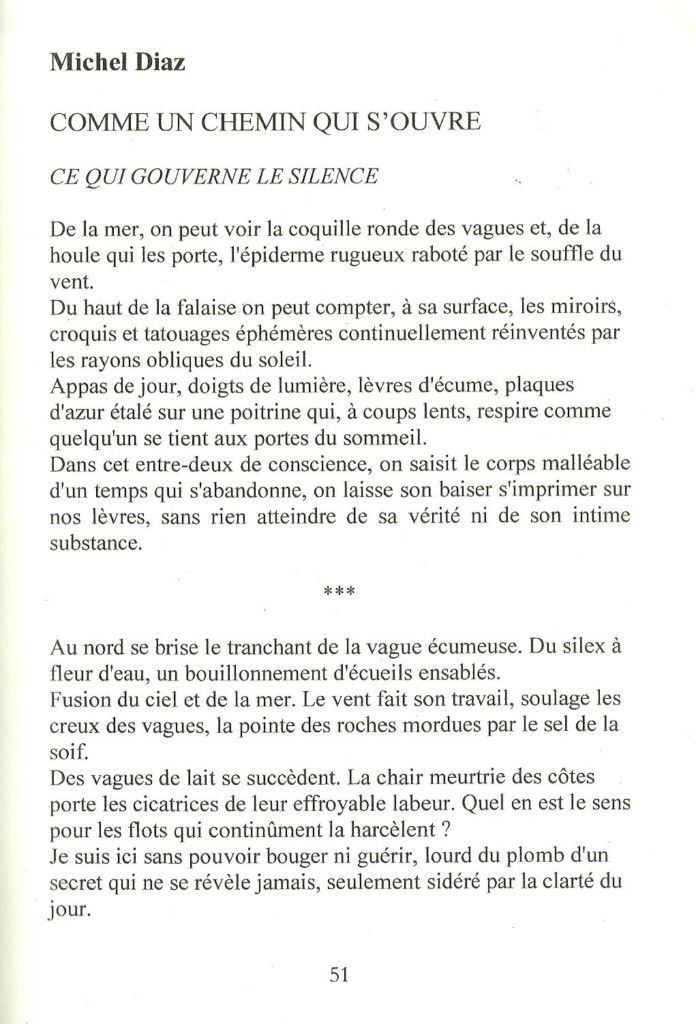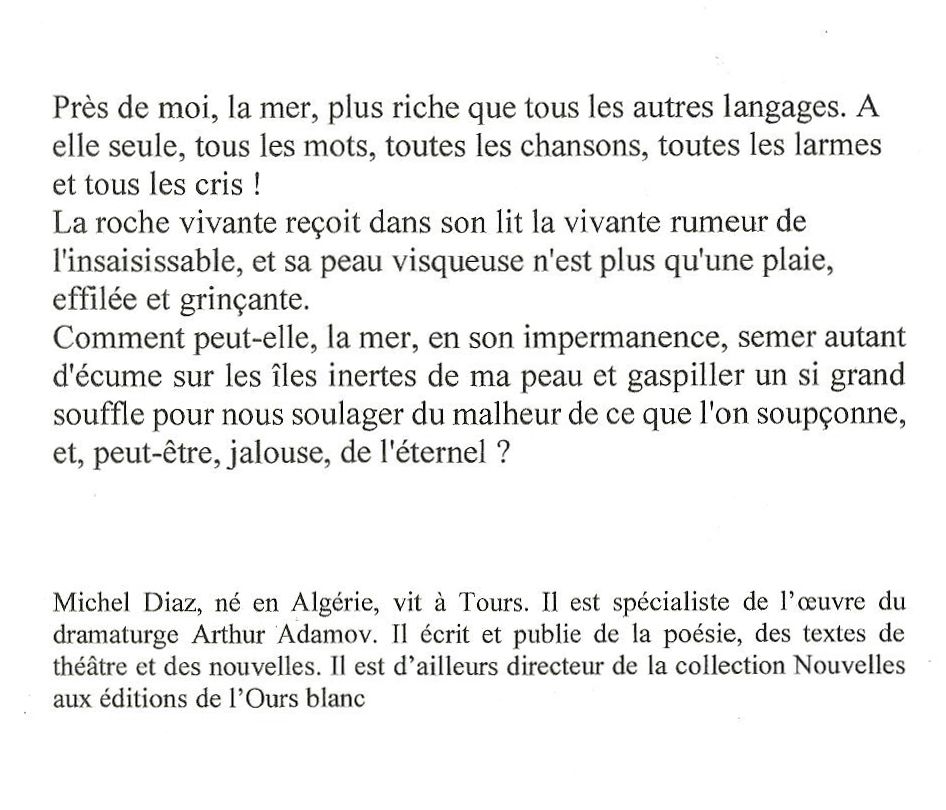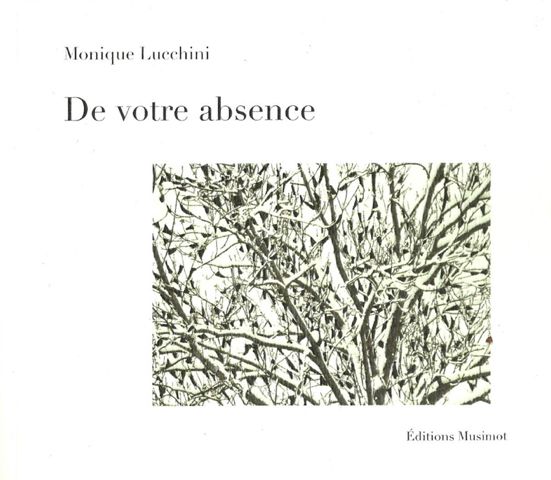 DE VOTRE ABSENCE
DE VOTRE ABSENCE
Monique Lucchini – Editions Musimot (2019)
La raison d’être de ce petit livre nous est révélée dès la deuxième page, dans cette confidence dont il nous importe peu de savoir quelle en est le degré de valeur autobiographique, car seul nous concerne déjà ce qu’elle nous transmet de confuse émotion : Ce que j’ai retenu de vous au jour de notre première rencontre c’est une apparence, un regard, une admiration fugace de cette image assumée que vous m’offriez sans le savoir. Je ne savais alors rien de ce qui habitait au plus profond de votre corps, des événements troublants et douloureux de votre enfance, du parcours improbable de votre vie d’adulte. […] mais je pressentais déjà la valeur d’une amitié sans faille; cette amitié que vous alliez m’offrir sans condition aucune. La plus belle et la plus pure que j’aie à ce jour connue.
Ces mots-là sont de ceux qui nous viennent aux lèvres comme dans les adieux, des mots de pure et douce nostalgie, de ceux qui nous protègent, ou dont on use pour se protéger de la peur de l’oubli, de celle de la perte irréparable et de sa douleur à venir.
Une femme se meurt sur son lit d’hôpital. Et une autre la veille. Elles se sont aimées d’amitié. De cet amour que seule l’amitié sait préserver et laver de toute ombre : J’ai tout de suite aimé cette place occupée par vous dans cette histoire qui allait être la nôtre. Une histoire en marge de nos vies. Une réalité épisodique. Deux chemins qui se croisent à égale distance.
La chambre d’hôpital est à peine évoquée. Pas de plans larges dans cette narration qui ne réclame que la confidentialité, que des plans rapprochés ou serrés sur le corps de celle qui meurt et sur les rares gestes de celle qui l’accompagne. Cet espace de veille est un îlot d’intimité, habité par les souvenirs, ce qui reste des mots, des fragments retrouvés d’une voix qui s’échappe vers cet « ailleurs », s’en est déjà allée, mais aussi habité par ce qui se passe là, au présent, dans le présent physique de ce temps où un corps se défait, un visage s’absente, une main frôle une autre qui n’est déjà plus là. Autour, dehors, la ville et l’indifférence du monde, tout ce qui de sa vie et de l’existence des autres s’est dissous dans ses parenthèses, de la nuit ou du jour, et c’est sans importance, car le temps des horloges et ses heures, minutes, secondes, est celui d’une autre planète, pas de celui que la mort a déjà investi. Ici, dedans, celle-là, la mort lente au travail, des images venues du passé, expressions d’un visage, inflexions d’une voix, et des réminiscences de musique, de notes de piano, des échos de Rachmaninov, des effluves de bal populaire, des accents de bandonéon, ce qui revient à la mémoire des pas de danse de jadis, tout cela, par lambeaux, ces images de souvenirs, moments dont s’est nourri le cœur et qui ont construit sa mémoire, et ces mots que l’on dit, sans qu’aucune syllabe se forme sur les lèvres, et qui se perdent dans cette avant-nuit du silence de la conscience : Je vous parle. Je vous parle dans cette langue silencieuse qui se dilue, qui se perd aux confins de l’abîme du souvenir. Les mots sont inutiles. Ils ne veulent rien dire. Ils ne sont entendus que par le corps. Compris par lui, et par lui seul. Perdus dans l’éblouissement de votre cœur.
 La mort efface et oblitère les vivants, et sa pensée nous envahit parfois de peur : Je suis là sous la lampe à écouter votre souffle, à attendre l’abandon qui mettra fin à cette nuit. Je suis là à caresser vos mains. Je vous parle doucement […]. Ce ne sont que des mots de circonstance. Des mots prononcés pour éloigner la peur. Oui j’ai peur, peur de vous perdre. Peur que votre visage disparaisse peu à peu. Peur que le son de votre voix s’éteigne inexorablement. Peur de rester orpheline de vous. Mais la mort aussi bien dévoile et met à nu, peut être l’occasion d’une « révélation », de ce qui peut nous apparaître à l’instant du passage, entre présence/absence, entre lumière et ombre, ce quelque chose qui offusque le regard pour le rendre à la vue : Maintenant je vous vois. Je vous vois dans cette chambre au fond du couloir. Je vous vois pour la première fois dans la vérité de votre nudité. Abandonnée. Si loin déjà. Je vois votre corps. Votre corps qui, même décharné, bouscule encore l’ordre des choses. Je vous vois dans l’éblouissement de la réalité de votre identité.
La mort efface et oblitère les vivants, et sa pensée nous envahit parfois de peur : Je suis là sous la lampe à écouter votre souffle, à attendre l’abandon qui mettra fin à cette nuit. Je suis là à caresser vos mains. Je vous parle doucement […]. Ce ne sont que des mots de circonstance. Des mots prononcés pour éloigner la peur. Oui j’ai peur, peur de vous perdre. Peur que votre visage disparaisse peu à peu. Peur que le son de votre voix s’éteigne inexorablement. Peur de rester orpheline de vous. Mais la mort aussi bien dévoile et met à nu, peut être l’occasion d’une « révélation », de ce qui peut nous apparaître à l’instant du passage, entre présence/absence, entre lumière et ombre, ce quelque chose qui offusque le regard pour le rendre à la vue : Maintenant je vous vois. Je vous vois dans cette chambre au fond du couloir. Je vous vois pour la première fois dans la vérité de votre nudité. Abandonnée. Si loin déjà. Je vois votre corps. Votre corps qui, même décharné, bouscule encore l’ordre des choses. Je vous vois dans l’éblouissement de la réalité de votre identité.
Celle qui meurt, ici, mais dont le corps et la présence consument leur lumière silencieuse, est de toutes les morts. Comme elle est de tous les amours. Elle est tout aussi bien figure de l’amie qui se dérobe dans les ombres que de l’amante qui s’éloigne, de la mère qui disparaît, de l’enfant qui nous quitte. Eurydice que rien ne pourrait ramener. Elle est l’image de ces corps abandonnés qu’a saisis l’incompréhensible, qu’aucunes larmes ne pourraient sauver, auxquels on ne peut plus offrir, à l’entrée dans leur mort, que la barque affligée de ses bras. Monique Lucchini, mot après mot, page après page, dessine à traits pudiques, en filigrane, comme une scène de pietà dont nous serions, qui la lisons, les très secrets témoins. Il y a, dans ce texte, dans ses dernières pages, quelque chose qui n’est pas étranger au sacré, aux rituels qui s’y rattachent pour permettre aux morts de franchir les ténèbres pour entrer dans une autre lumière : Vous voyez, nous avons eu raison de la nuit ! Le jour s’est imposé comme un répit. Maintenant je lave votre visage, vos mains. Je lave l’obscurité des heures passées.
Epreuve difficile et douloureuse de la mort, et de l’accompagnement dans la mort. Ne peut s’ensuivre que l’apaisement, ne reste qu’un vertige, comme un trou dans le temps, que la vie peu à peu, à nouveau va remplir. Ne reste que la douceur d’un vent qui balaye peu à peu le souvenir que j’ai de vous, s’accrochant aux parois incertaines du temps. La vie est là, toujours, encore, en dépit du chagrin et de la réalité de l’absence, la vie, obstinément, moment de l’aube, cet instant fragile, intangible, où la nuit laisse place à la lumière, le soleil qui se lève sur un jour nouveau, les nuages qui vont sur leurs routes de ciel, la renarde qui vient s’abreuver tout près de la maison, et le circaète qui plane au-dessus des falaises. Et c’est aussi cela que la mort nous apprend, nous rappeler à ces moments où l’on sent que les jours s’étirent, seconde après seconde. Où l’émerveillement de la vie à venir nous surprend encore.
Michel Diaz, 16/02/2019
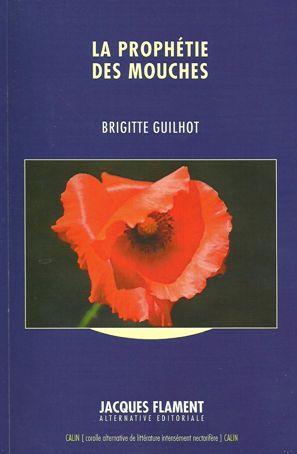 LA PROPHÉTIE DES MOUCHES
LA PROPHÉTIE DES MOUCHES Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.
Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.