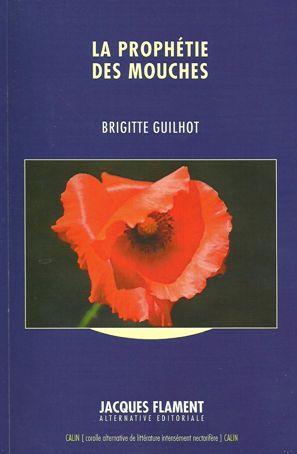 LA PROPHÉTIE DES MOUCHES
LA PROPHÉTIE DES MOUCHES
Brigitte Guilhot
Editions Jacques Flament (2019)
La quatrième de couverture de ce petit livre, La Prophétie des mouches, nous en avertit:
« Au travers de photographies que l’auteur choisit de ne pas montrer pour laisser libre cours à l’imaginaire visuel du lecteur, [l’auteure] réinvente la parole de ces êtres que la vie a projetés dans le déracinement. »
Voilà un livre qui ressemble à son auteure. En effet, Brigitte Guilhot trace et creuse son sillon, comme on laboure et travaille une terre qu’on dit difficile, ingrate et caillouteuse. C’est à la trace du sillon, à la ligne qu’il suit, au dessein qu’il révèle, aux pierres qu’il déplace, que l’on retrouve et reconnaît « le monde » d’un auteur. Celui de B. Guilhot est fidèle à lui-même, de livre en livre. C’est celui d’une âme rebelle et d’un cœur insoumis, d’une voix qui nous parle des déshérités, des damnés de la vie, de ses laissés-pour compte, ceux qui meurent de – et dans leur solitude, sans qu’on s’en aperçoive, ceux qui dorment la nuit sous les porches, ou sur les bancs des gares et des squares, c’est celui des errants sur la terre, des réfugiés chassés de chez eux par la faim et la guerre, et de ceux-là encore qui se retrouvent en prison ou dans un hôpital, pour indisposition à vivre selon les normes imposées par les règles communes et les lois de la bien-pensance. Il y est encore, et toujours question du « déracinement », celui, intérieur ou spatial, d’êtres que l’existence, la violence et les injustices du monde ont jetés dans ses marges, condamnés à l’errance, à la peine et au désarroi, ou livrés à l’anesthésie de la désespérance ou aux armes de la colère.
Le monde littéraire de B. Guilhot n’est pas celui qui pare la réalité des guirlandes des bons sentiments, la drape d’un imaginaire qui nous tromperait sur le monde réel des hommes, l’enjolive d’un fade optimisme ou d’un bête émerveillement que certains écrivains cultivent pour en masquer la dureté, jouant ainsi de l’illusion. Ce qu’écrit B. Guilhot nous prend de face et se reçoit dans la poitrine, s’insinue comme une migraine et diagnostique une maladie. Qu’elle ait choisi de consacrer ces textes brefs à ce que l’on appelle les « migrants » (ce mot que nous avons choisi, souligne-t-elle, pour mieux les tenir à distance et les penser comme des « envahisseurs »), s’inscrit dans sa démarche d’écrivaine de ne pas détourner les yeux des misères de toutes sortes dont est tissée cette réalité sociale dans laquelle nous sommes immergés, mais que nous ne voulons pas voir pour nous en protéger, essayer de nous en défendre, ou ménager notre confort de vie et de pensée.
B. Guilhot nous interpelle, nous lecteurs, et nous invite à voir : Peut-on imaginer cela, franchement, ces exodes, cette déroute et, ouvrant ses vannes de fiel à leur approche, cette indifférence collective pour eux, humains de la Terre qui sont sortis un jour d’un ventre de femme comme vous et moi et n’importe quel humain de la Terre, avec leur droit à un toit, à une protection, à de la reconnaissance, à des caresses et des baisers, à de l’amour et de la chaleur, à une mémoire collective et à une instruction, à manger à leur faim et à dormir dans des draps propres, et qui désormais agacent. Cette auteure-là ne triche pas avec les mots, elle en sait le poids et le prix de responsabilité, la charge accusatrice et, on veut bien la croire, leur modeste pouvoir d’éveiller les consciences : non, je ne triche pas avec les mots, tout comme je porte mes images avec toute l’humanité dont je suis capable pour que cessent de tels désastres, pour que des hommes, des femmes, des enfants ne soient plus jamais arrachés à leur terre, à leur maison, à leurs racines, et encore moins à leurs morts. Ces mots-là signent son engagement dans son devoir d’humanité et dans les affaires du monde, dans le flot chaotique et tragique de son histoire : Mon engagement vient de mon ventre, de mes larmes et de ma colère, celle que j’ai encore les moyens et la force d’exprimer (je devrais dire le luxe) car je mange à ma faim, je dors dans des draps propres et frais, protégée des mouches, des cafard et des odeurs de putréfaction…
 Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.
Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.
Pourtant, de livre en livre, c’est là encore la trace du sillon que B. Guilhot nous propose de suivre, ces êtres-là se cabrent, résistent comme ils peuvent et luttent. Ne serait-ce qu’avec les mots que l’on veut effacer de leurs lèvres, avec leurs souvenirs dont nul n’a le pouvoir de les priver, mais aussi et surtout avec cette lumière d’espérance que nul ne peut éteindre dans le cœur des hommes et qui, au plus épais de leur détresse, les garde encore debout, les faisant ainsi plus humains parmi les humains. Ainsi, encore, cette photo et cette scène qui se passe dans un camp de réfugiés, entre les barbelés : […] et la fumée qui plane au-dessus des tentes manifeste qu’on boira peut-être un café brûlant qui réchauffera les mains et le ventre, ou plutôt une mixture qui lui ressemblera de très loin. Alors, pour ces présences absentes de l’image que je devine épuisées et engourdies de sommeil, cela sera bon à prendre et à partager à l’aube d’une journée devant laquelle elles ne peuvent que s’abandonner à l’espoir insensé de leur survie en terre inconnue.
On dit, de certains livres, qu’ils sont « utiles », et c’est souvent affaire de subjectivité. Celui-là l’est, sans aucun doute. Il est de ceux qui nous questionnent, qui dérangera quelques-uns, mais ne ménage pas notre bonne conscience, nous mettant en garde à la fois contre le voile de la cécité et cet apitoiement facile auquel il est, pour souscrire à un humanisme de pacotille (et qui est conformisme moral) de bon ton de céder.
Michel Diaz, 14/02/2019
Merci cher Michel, pour ton regard et ton analyse subtile. Amitiés, Brigitte