Préface au recueil de nouvelles de Gabriel Eugène Kopp, RROYZZ Editions, mai 2019
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
– Nouvelles –
Gabriel Eugène Kopp
Voilà un livre qui ressemble à son auteur. En effet, Gabriel Eugène Kopp trace et creuse son sillon comme on laboure et travaille une terre qu’on dit ingrate et difficile. C’est à la trace du sillon, à la ligne qu’il suit, au dessein qu’il révèle, aux pierres qu’il déplace, que l’on retrouve et reconnaît « le monde » d’un auteur. Celui de G. E. Kopp est fidèle à lui-même, de livre en livre. C’est celui d’une âme lucide et d’un cœur insoumis, d’une voix qui nous parle du monde et de ceux qui l’habitent, d’un chemin d’écrivain qui prend son temps et les mirages de l’époque à bras le corps pour en dénoncer les errances et en démonter les mensonges. Il y a là la part têtue d’un indiscutable et profond humanisme, mais celle aussi, chez cet auteur, d’un vrai « grain de folie », celui qui pousse l’homme au milieu de ses paysages de ruines et malgré l’horizon des désespérances, à affronter sa condition, tenter peut-être d’en changer quelque peu (même modestement) le cours.
L’ouvrage de G. E. Kopp, terriblement contemporain par sa matière et par les sujets qu’il aborde, est placé sous le signe de l’Apocalypse de Jean et celui de Thomas. Nous connaissons mieux celui de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, qui contient des visions prophétiques et eschatologiques: les sept sceaux, les quatre cavaliers, la chute de Babylone, la Jérusalem céleste. Visions de l’expression de la grande Justine divine, de fin du monde sur la scène grandiose d’un spectacle de « sons et lumières » effrayant (et de possible renaissance). G. E. Kopp serait-il, à sa manière, un autre prophète de malheur ? Si c’est le cas, accordons-lui les égards qui lui reviennent.
Tout doit disparaître ? En premier lieu l’espèce humaine en son état ? Son incommensurable orgueil ? Son inexcusable incurie ? Sa coupable et catastrophique irresponsabilité alors que lui était confiée la bonne marche de notre planète (du moins l’espérait-on au regard de la part d’étincelle divine dont le Père l’avait doté) ? Et alors ? La belle affaire ! Ne lui a-ton pas sonné les cloches, à l’Homme, depuis des siècles, sinon des millénaires? Ne lui a-ton pas suffisamment ressassé que sa présence sur la Terre était soumise à des lois qu »il devait se garder d’enfreindre ? A des exigences morales qu’il se devait de respecter ? A des conditions de partage du vivant et de ses territoires auxquelles il serait sage de se soumettre ? Qu’en a-t-il fait ? Et à quoi s’est-il obstiné ? Arc bouté qu’il était sur les privilèges que lui conférait son intelligence particulière ? Obsédé qu’il était, et continue de l’être, par son propre bien-être, soucieux de son confort, veillant férocement aux biens de ses propriétés, jaloux d’autrui, méfiant de l’autre, méchant toujours, haineux souvent, gaspillant les trésors de la Terre, soûl des pouvoirs de l’or et insatiablement grisé par la puissance redoutable, rêvée comme infinie, et aveuglément attachée à la sainte notion de « Progrès » des techniques et des sciences dont on sait, aujourd’hui, que ce sont, utilisées comme un enfant s’amuse avec le feu, les instruments de régression de son humanité et peut-être ceux de sa perte.
Ce qui s’impose, dans ces nouvelles, c’est donc une atmosphère de « fin de règne », pour ne pas dire de « fin du monde » ou, plus exactement, de « fin d’un monde ». Perte de chance, perte de vie, perte à perte de vue. Tout est là, déjà, que l’on reconnaît sans l’avoir vu encore. Et tout est redoutablement possible. Aucun simulacre à poignarder, aucun fantasme à dépister ou dont on pourrait raisonnablement se moquer. Nous sommes là, parmi ces pages que nous livre un narrateur « halluciné » (mais qui n’est peut-être que « visionnaire »), environnés d’aucun mort regretté ni d’aucune espérance à poursuivre, sinon celle de se tirer d’affaire et de survivre malgré tout. Nous sommes là, sans âge et sans mensonge. Comme seuls dans la solitude, avec le couteau, le pain et l’eau. Accoudés à la table d’une vérité que nous pressentons, une vérité dépouillée jusqu’aux os, et qui n’a qu’elle-même à offrir.
A mesure des pages, nous nous incrustons lentement dans la nuit à venir, ce qui s’annonce dans le crépuscule. Aucun chagrin n’a résisté aux occultes virulences. Les épines de nos questions n’ont connu de plus belles raisons de s’anéantir. Un fruit, la nostalgie ou le remords, et de quoi ? Les personnages de ces histoires le savent-ils encore ? L’aube, parfois, un peu de ciel se lève à travers les fenêtres. Comme une capsule de lumière. Et la couronne d’inquiétude au centre, posée sur la pensée, avec la couronne d’épines de notre condition. Immense lumière froide qui jette sur la plage des fruits inassouvis, en loques, juteux avant-coureurs de la mort. Les faits inassouvis. Ce qui demande à être dans les temps accomplis.
Ici, le Temps comme arrêté. Et l’absence de rêve, ni grave ni triste. Bras dessus bras dessous, les vagues s’en sont allées des lieux des jours nouveaux et n’ont laissé au goût salin que leur frileux souvenir de soleil. Silencieux, derniers témoins de la beauté du monde, les yeux, ici et là, échangent encore des lumières avec un horizon que l’on sait désormais perdu ou, en tout cas, inaccessible. Toute la désolation immensément phosphorescente d’une main tendue à un tournant de la mer – et que la mer ne prendra pas. Qui donnera la paix, quel soleil moribond, passant le tranchant de sa lame à l’intérieur du cœur ? Un astre échevelé, la plupart du temps invisible, flotte pourtant toujours, certains diront horriblement, inexplicablement suspendu. Suspendu comme le bien dans l’homme, ou le mal dans le commerce d’homme à homme, ou la mort dans la vie. Mais les menaces de ces nuages ! Force planante de désolation. Car un ciel de Bible plane sur ces histoires, où courent des nuages blancs. Mais les orages qui noieront de pluies ces paysages d’avant-monde, ou peut-être d’après, on ne sait pas toujours ! Mais l’ombre portée de la terre, et son éclairage assourdi et crayeux ! Et l’air, comme un suspens du souffle, raréfié ! On n’attend ici que le vent. Qu’il s’appelle amour ou misère, il ne pourra guère s’échouer que sur une plage d’ossements, des terrains vagues encombrés de tôles et de ronces, et des maisons en ruines où quelques survivants poursuivent une vie placide, faisant mine de croire que rien ne s’est passé.
Mais G. E. Kopp s’amuse dans ces textes, il s’y amuse très sérieusement. Ainsi, par exemple, reprenant au pied de la lettre l’expression « les eaux montent », il invente une histoire où, en dépit de toutes les lois de la nature et de la gravité, les eaux, toutes les eaux, s’échappent vers le ciel, les fleuves remontent aux rivières, et les rivières à leur source, et où le simple fait de boire, et d’abord de remplir un verre, se présente comme un défi impossible à tenir et où l’Humanité risque de disparaître.
Car G. E. Kopp est drôle ! Drôle d’un humour ravageur qui taille en pièces le sérieux dont nous faisons usage pour maquiller de vaine réflexion ce que nous pressentons confusément d’une Apocalypse probable, et pour masquer nos désarrois, et atermoiements devant les tragédies qui se préparent et, certainement, nous attendent. Drôle aussi d’une gravité qui refuse de se prendre au sérieux, car si l’on sait que « l’humour est la politesse du désespoir », il est encore le moyen de prendre avec les faits la distance nécessaire, et indispensable, pour mieux la mesurer, en relativiser les conséquences et en l’occurrence, dans ces nouvelles, nous restituer notre juste place, celle de provisoires et hasardeux incidents biologiques dans la si longue et si complexe chaîne du vivant. Puisqu’il est vrai que nous, humains, arrivants d’assez fraîche date, ne sommes rien, si peu de choses, graines d’esprit, de vanité, de cendre et de poussière au regard de l’infinitude du Temps, de son énigme sans réponse, et de l’infini d’un espace auquel nous ne comprenons, au bout du compte, que bien peu de choses. Drôlerie mâtinée d’obsédant souci « scientifique » (certains appelleront cela de la science fiction, tant pis pour eux !), et d’un sens aiguisé de l’absurde, raisonnement, démonstration, qui pousse jusqu’en ses extrêmes une imagination qui n’a, finalement, d’autre choix que de nous révéler la face sombre d’une vérité qui devrait nous brûler les yeux, nous aveugler l’esprit, ce qui, en germe dans le verbe, s’appelle une « révélation ». Mais la « révélation » n’est pas ce que nous apprennent les scientifiques et les experts en tous domaines du savoir exact pour nous informer sur l’état du monde, de la bio-diversité, sur les ravages auxquels nous soumettons notre planète et sur leurs conséquences, la plupart irréversibles. Cela, nous l’entendons et l’oublions sitôt après, retournant à nos habitudes de vie, empressés de ne pas céder à la peur d’un présent menaçant et d’un futur plus angoissant encore, qui rayerait à plus ou moins court terme notre espèce de la carte de l’univers et de tous les siècles des siècles. Non, la « révélation », celle que notre esprit est capable de recevoir pour qu’elle y fasse son chemin, est celle que nous recevons des « illuminés » et des poètes, les seuls qui vaillent la peine que l’on prenne leur parole au sérieux.
Dans un texte que j’avais, il y a quelque temps déjà, consacré à un autre ouvrage * de G. E. Kopp, je soulignais l’aspect philosophique de sa démarche d’écrivain. Je reprendrai ici cette réflexion, sans y changer quoi que ce soit. J’y écrivais que cette démarche d’écriture, dont la liberté d’imagination littéraire s’autorise à user de ces décalages temporels (et spatiaux), nous inciterait à établir un parallèle entre ces nouvelles et quelques-uns des écrits des siècles précédents, romans à haute teneur philosophique, comme le Gulliver de Swift, par exemple. Si nous posons ainsi cela, les textes de G. E. Kopp pourraient entrer aussi dans le champ littéraire de ces « contes philosophiques » dont les auteurs du XVIIIème siècle ont si pertinemment usé, mais d’autres aussi après eux, comme Balzac, Stevenson, Calvino, Wells, Bradbury ou Borgès, par exemple, pour mieux nous tendre le miroir de nos angoisses et perplexités. Pour nous mettre face aussi à des temps dans lesquels nos routes humaines deviennent incertaines. Demeurent la littérature, l’art et la poésie pour éclairer un peu, plus loin, nos jours embarrassés de doutes. A ce que nous leur demandons de lumière, G. E. Kopp apporte sa précieuse part.
* Mécomptes de Noël (éd. de L’Ours Blanc)
Michel Diaz
 Ce texte, lu le dimanche 10 mars 2019, à l’occasion de l’exposition des deux artistes, la photographe Rieja van Aart et le peintre Haider, au château de Mosny, dans le cadre du Printemps des poètes 2019, a été inspiré par la série de photos de R. v. Aart intitulée « Le plat pays ».
Ce texte, lu le dimanche 10 mars 2019, à l’occasion de l’exposition des deux artistes, la photographe Rieja van Aart et le peintre Haider, au château de Mosny, dans le cadre du Printemps des poètes 2019, a été inspiré par la série de photos de R. v. Aart intitulée « Le plat pays ». Nous nous incrustons lentement dans la nuit à venir, ce qui s’annonce dans le crépuscule. Aucun chagrin n’a résisté aux occultes virulences. Loin des pierres, dans leur centre. Les épines de nos questions n’ont connu de plus belles raisons de s’anéantir. Un fruit, la nostalgie ou le remords, et de quoi ? Comme une capsule de lumière. Et la couronne d’inquiétude au centre avec la couronne d’épines de notre condition. Immense lumière froide qui jette sur la plage des fruits inassouvis, en loques, juteux avant-coureurs de la mort, ou débris de tout ce qui fut. C’est toute la pauvreté du paysage. Les faits inassouvis. Ce qui demande à être dans les temps accomplis.
Nous nous incrustons lentement dans la nuit à venir, ce qui s’annonce dans le crépuscule. Aucun chagrin n’a résisté aux occultes virulences. Loin des pierres, dans leur centre. Les épines de nos questions n’ont connu de plus belles raisons de s’anéantir. Un fruit, la nostalgie ou le remords, et de quoi ? Comme une capsule de lumière. Et la couronne d’inquiétude au centre avec la couronne d’épines de notre condition. Immense lumière froide qui jette sur la plage des fruits inassouvis, en loques, juteux avant-coureurs de la mort, ou débris de tout ce qui fut. C’est toute la pauvreté du paysage. Les faits inassouvis. Ce qui demande à être dans les temps accomplis. Qui donnera la paix, quel soleil à éclipser, passant le tranchant de sa lame à l’intérieur du cœur ? Une idée de désert éternel plane sur ces espaces, un immense concert de silence, au-dessus duquel un astre échevelé et invisible flotte, certains diront horriblement, inexplicablement suspendu. Suspendu comme le bien dans l’homme, ou le mal dans le commerce d’homme à homme, ou la mort dans la vie. Force planante de désolation. Car un ciel de Bible est dessus où courent des nuages blancs. Mais les menaces de ces nuages. Mais les orages qui noieront de pluies ces paysages d’avant-monde, ou d’après-monde, on ne le sait. Mais l’ombre portée de la terre, et son éclairage assourdi et crayeux. Mais l’air léger, comme un suspens du souffle, et raréfié. On n’attend ici que le vent. Qu’il s’appelle amour ou misère, il ne pourra guère s’échouer que sur une plage d’ossements.
Qui donnera la paix, quel soleil à éclipser, passant le tranchant de sa lame à l’intérieur du cœur ? Une idée de désert éternel plane sur ces espaces, un immense concert de silence, au-dessus duquel un astre échevelé et invisible flotte, certains diront horriblement, inexplicablement suspendu. Suspendu comme le bien dans l’homme, ou le mal dans le commerce d’homme à homme, ou la mort dans la vie. Force planante de désolation. Car un ciel de Bible est dessus où courent des nuages blancs. Mais les menaces de ces nuages. Mais les orages qui noieront de pluies ces paysages d’avant-monde, ou d’après-monde, on ne le sait. Mais l’ombre portée de la terre, et son éclairage assourdi et crayeux. Mais l’air léger, comme un suspens du souffle, et raréfié. On n’attend ici que le vent. Qu’il s’appelle amour ou misère, il ne pourra guère s’échouer que sur une plage d’ossements.
 Chers amis,
Chers amis, Cher Raphaël,
Cher Raphaël,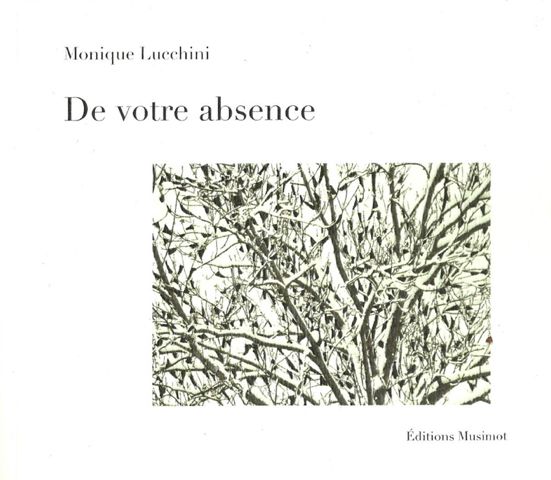 DE VOTRE ABSENCE
DE VOTRE ABSENCE La mort efface et oblitère les vivants, et sa pensée nous envahit parfois de peur : Je suis là sous la lampe à écouter votre souffle, à attendre l’abandon qui mettra fin à cette nuit. Je suis là à caresser vos mains. Je vous parle doucement […]. Ce ne sont que des mots de circonstance. Des mots prononcés pour éloigner la peur. Oui j’ai peur, peur de vous perdre. Peur que votre visage disparaisse peu à peu. Peur que le son de votre voix s’éteigne inexorablement. Peur de rester orpheline de vous. Mais la mort aussi bien dévoile et met à nu, peut être l’occasion d’une « révélation », de ce qui peut nous apparaître à l’instant du passage, entre présence/absence, entre lumière et ombre, ce quelque chose qui offusque le regard pour le rendre à la vue : Maintenant je vous vois. Je vous vois dans cette chambre au fond du couloir. Je vous vois pour la première fois dans la vérité de votre nudité. Abandonnée. Si loin déjà. Je vois votre corps. Votre corps qui, même décharné, bouscule encore l’ordre des choses. Je vous vois dans l’éblouissement de la réalité de votre identité.
La mort efface et oblitère les vivants, et sa pensée nous envahit parfois de peur : Je suis là sous la lampe à écouter votre souffle, à attendre l’abandon qui mettra fin à cette nuit. Je suis là à caresser vos mains. Je vous parle doucement […]. Ce ne sont que des mots de circonstance. Des mots prononcés pour éloigner la peur. Oui j’ai peur, peur de vous perdre. Peur que votre visage disparaisse peu à peu. Peur que le son de votre voix s’éteigne inexorablement. Peur de rester orpheline de vous. Mais la mort aussi bien dévoile et met à nu, peut être l’occasion d’une « révélation », de ce qui peut nous apparaître à l’instant du passage, entre présence/absence, entre lumière et ombre, ce quelque chose qui offusque le regard pour le rendre à la vue : Maintenant je vous vois. Je vous vois dans cette chambre au fond du couloir. Je vous vois pour la première fois dans la vérité de votre nudité. Abandonnée. Si loin déjà. Je vois votre corps. Votre corps qui, même décharné, bouscule encore l’ordre des choses. Je vous vois dans l’éblouissement de la réalité de votre identité.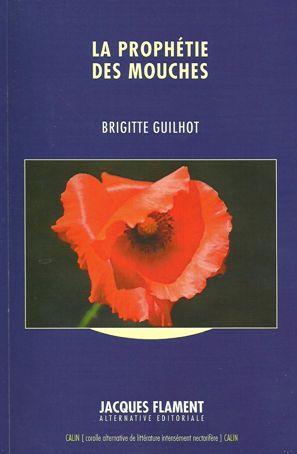 LA PROPHÉTIE DES MOUCHES
LA PROPHÉTIE DES MOUCHES Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.
Pourtant, tout ébranlés qu’ils soient par les ravages de la guerre, la cruauté de leurs bourreaux, désemparés par les misères de l’exil, tout maltraités qu’ils soient par les coups injustes du sort qui s’acharne sur eux, et adossés à leurs derniers espoirs ou acculés parfois à leurs ultimes forces, réduits à n’être plus que leur seul nom d’humains, qu’ils soient encore prisonniers de leur peur ou victimes de leur refus à la soumission d’un ordre qu’ils dénoncent, les êtres que B. Guilhot s’attache à peindre et à représenter au plus près de leur vérité, ne sont jamais de ceux qui s’abandonnent tout à fait, baissent les bras, renoncent, pactisent avec leur destin. Quelquefois, il est vrai, ne leur reste que le sentiment d’une vie qu’on ne leur a pas enlevée et ce qui persiste d’amour quand tout le reste n’est que destruction matérielle et psychique. Ainsi, dans cette scène, description d’un cliché ramené des décombres d’une ville bombardée : Elles sont seules à cet instant la mère et l’enfant, enlacées dans ce clair-obscur, car les deux aînés sont partis avec leur père, chacun accroché à une main, à la recherche de quelques nourriture […]. Elles sont seules la mère et l’enfant, dans cet instant suspendu d’extrême abandon au destin qui ne leur propose rien d’autre qu’être là, survivantes malgré tout, au milieu de ce champ de ruines, et c’est si improbable que celle et celui qui plongent leur regard hypnotisé dans cette photo décident de croire au miracle.