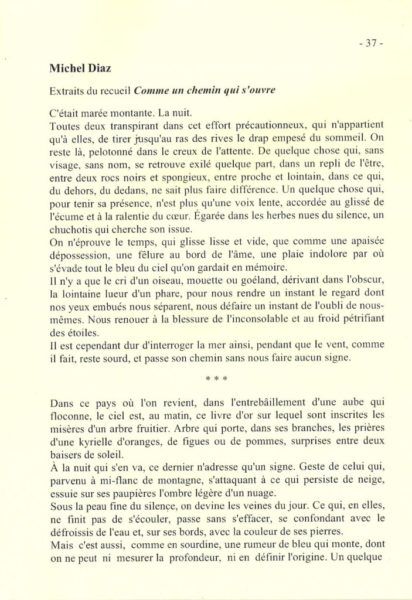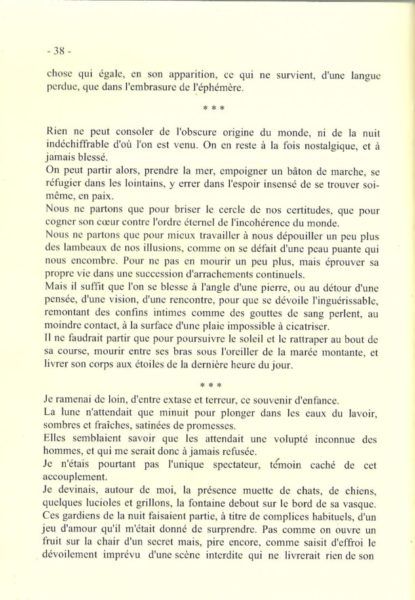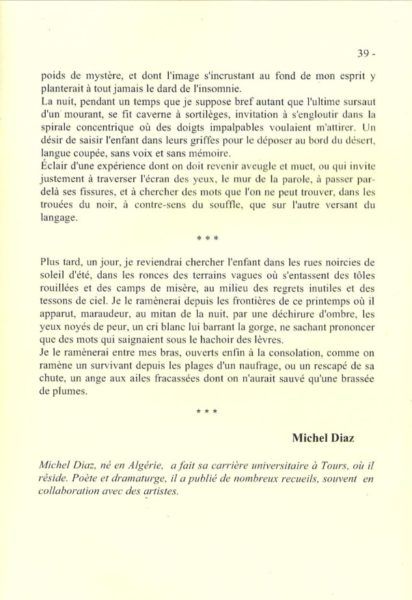Texte publié dans L’Iresuthe N° 37 (avril 2017) et Les Cahiers de la rue Ventura N° 40 (avril 2018). Ce texte a été repris et complété pour servir de préface à l’anthologie poétique de Cl. Cailleau (2019
Texte publié dans L’Iresuthe N° 37 (avril 2017) et Les Cahiers de la rue Ventura N° 40 (avril 2018). Ce texte a été repris et complété pour servir de préface à l’anthologie poétique de Cl. Cailleau (2019
Cher Claude Cailleau,
je vous laisserai faire la part des choses entre ce qui, dans cette lettre, relève du très profondément sérieux et ce qu’elle comporte de « divagation poétique » et de prise de position délibérément arbitraire.
Mais remontons d’abord quelque peu dans le temps. Il y a peut-être deux ans de cela, je vous avais écrit ces mots que vous me faites l’amitié de reprendre dans votre blog : « Je viens de lire d’une traite vos Sur les feuilles du temps et, malgré l’obsédante thématique qui y est développée, j’ai retrouvé l’auteur que j’apprécie : textes d’une seule coulée, souffle court mais obstiné, têtu, tenace. C’est un livre qu’il faut lire en marchant (je le ferai) sur des chemins raboteux, parmi les ronces et sous un ciel de crépuscule. L’ombre de la mort y plane tout du long, mais chaque vers, chaque pas, est un pas gagné sur la mort, une victoire, un élan vers le pas suivant, contre le crépuscule, contre la nuit, contre l’absence et l’oubli. Nostalgie et angoisse y sont transformées en conquête, sur le silence, sur la menace confuse qui nous cerne, et cela se transforme en lumière. Y fait la langue que vous utilisez : sobre, claire, rapide, allant à l’essentiel, dégraissée à l’extrême, d’apparence presque pauvre mais usant de ce dépouillement pour être plus efficace encore. Une langue « raclée à l’os ». Vous me rappelez votre âge dans le même courriel, mais c’est cet âge justement qui vous a doté des moyens de cette langue, c’est-à-dire d’un art que vous avez affuté comme une lame sur les cailloux des ans, et c’est là de la bien belle poésie. »
Ainsi, je vous avais promis que je relirai vos Sur les Feuilles du Temps en marchant sur les chemins (comme je l’ai fait avec d’autres de vos ouvrages), à l’heure incertaine du crépuscule. Je parlais d’abord de celui du soir. Mais j’ai soumis encore ma lecture à celui du matin (ah, les chemins, aux heures où le jour se lève, et quelle fraîcheur de l’esprit !), et je me dois de vous dire que vous avez passé ces deux épreuves avec une bien belle aisance – dont je n’avais d’ailleurs jamais douté.
Je vous rassure, ou vous déçois peut-être : ces lectures « à ciel (ou à cœur) ouvert », dont je me suis quasiment fait un idéal de vie, ne vous sont pas exclusivement réservées.
Le mérite n’est pas si grand, au fond, mais je prétends appartenir à la catégorie des bipèdes sans plumes, dite « marcheurs de longue haleine » (ou des randonneurs au long cours). Je marche tous les jours, beaucoup. Enfin, pas mal. Les chemins, quels qu’ils soient, et quel que soit le temps, sont mon cabinet de lecture autant que mon cabinet de travail.
M’étant solidement chaussé (les chaussures varient en fonction de ce je prévois de la qualité du terrain), je pars, un calepin et un stylo en poche et/ou un livre à la main. Généralement de la poésie, ou de la prose poétique. Les autres genres de littérature me semblent bien moins adaptés à cet exercice particulier, comme on ne fait pas l’ascension du Mont blanc en sandales ou s’engage dans le désert en bottes de pêcheur.
Parfois, je n’écris rien, je n’ouvre pas le livre. J’attends le bon moment, un signe favorable, qui sera aussi bien le murmure du vent dans un arbre, le déboulé d’un lièvre ou d’un chevreuil, la forme d’un nuage. Je marche seulement, je rêve, je médite, j’observe, je parais ne rien faire aux yeux de qui me croise, seulement avancer vers un but sans objet, mais en vérité « je travaille », ou je laisse plutôt « travailler » en moi ce qui s’agite dans les profondeurs, que la marche remue, cette vase qui constitue le fond de nos pensées, leur matériau de base (de vase ?), cette eau trouble et opaque d’où remontent des mots qui demandent à être à l’air libre, s’agencent souvent à leur gré, et deviennent des bribes de phrases à travers lesquelles des images remontent en bulles de lumière qui bientôt dessinent un sens dans l’incohérence du monde. Ces moments-là éclairent par avance ce que je vais lire, lui ouvrent un chemin, ou sont la basse continue de ce qui va s’écrire. Instants de grâce nourriciers qui ne dispensent pas de regarder où l’on pose ses pieds et n’empêchent en rien de prévoir les obstacles et de les éviter, ou d’adapter son pas aux exigences du terrain. Mais « faire un » avec le chemin tout en laissant vagabonder son esprit et ses sens est un exercice que l’on apprend en le pratiquant régulièrement et qui réclame une expérience dont je peux me targuer, l’âge aidant, de maîtriser de pied de maître.
La marche impulse un rythme au cœur, au sang, au souffle, à la pensée. La verticalité active de la marche donne à l’esprit son carburant et puise dans cette énergie profonde dont doit faire preuve le chef d’orchestre quand il lit ou dirige une partition.
Vous me permettrez de me citer moi-même en reprenant ici les mots que j’ai écrits dans l’introduction d’un ouvrage à paraître : « (…) la marche est déséquilibre d’un corps qui tombe vers l’avant, provisoire vertige d’un pied qui cherche son appui, instant de suspension qui précède la chute, et nouvelle poussée vers le ciel. Les rythmes de la marche, plus que toute autre chose, comme les cadences du cœur et le souffle qui les escorte pour régler les tempos de ses intimes tambourinements, sont ce qui inscrit l’être et le corps qui le porte dans l’espace et le temps d’une verticalité vivante et fertile. Ce miracle dont peut témoigner l’effort de s’arracher constamment à soi-même pour s’avancer à la rencontre de cet inconnu qu’on porte devant soi. D’un pas à l’autre reconduite, et toujours en limite d’abîme. »
Mais la poésie là-dedans ?… Qu’on va lire ou qui va s’écrire ?… Nous y sommes on ne peut mieux. « L’écriture de la poésie ? La terre de sous nos pas, a écrit Yves Bonnefoy dans La longue chaîne de l’ancre, mais trempée comme après l’orage, creusée par de grandes roues qui ont passé, se sont éloignées. Terre tout ornières dont de brèves lueurs remontent. »
Que vous dire d’autre que quand je lis, allant sur des chemins qui s’enfoncent dans les sous-bois ou sur ceux qui serpentent le long de la Loire ou du Cher,
« S’en va sur le chemin,
chancelle au vent mauvais,
(s’en va. Oui, que s’en aille !)
cahin-caha caha-cahin,
la vieille silhouette,
titubante, marchant
vers des lendemains de hasard.
Et refais le parcours
(une vie à jauger)
Tremble, avance deux pas… » (Sur les Feuilles du Temps),
que vous dire d’autre, sinon que le rythme des phrases, le tempo de leur souffle, viennent d’eux-mêmes s’accorder, et comme naturellement, au rythme têtu de la marche et à l’ostinato du cœur ?…
Sinon, aussi, que les modulations inscrites dans ces lignes, prises presque au hasard,
« Tu entres dans la forêt, celle des longues marche solitaires. Une allée droite s’ouvre, comme une cathédrale de feuillage. La paix des arbres offerte en récompense. Là-haut, le vent parle avec Dieu et tutoie le nuage… » (Pour une heure incertaine)
sont propres, elles, à imposer un pas plus retenu, celui de la méditation rêveuse, celui d’une avancée dans un paysage tout intérieur, semblable à celle d’un Hugo, plongé dans sa pensée, qui s’en va déposer « un bouquet de houx vert » sur la tombe de sa petite ?
Que celles-là, encore, prises encore au hasard,
« Je suivais une route lisse, foulais la plage abandonnée. La plage, mon premier désert. Dans le fond de mon âge, la neige couvre de flocons-silence les pages de l’enfantine solitude… » (Le Roman achevé) ne peuvent qu’imposer au pas un ralenti qui invite presque à s’arrêter, à suspendre son souffle pour se pencher sur son propre silence, à écouter ce qui nous vient, à nous aussi, depuis nos temps lointains ? Oui, le vers épouse le pas comme, à l’inverse, et réciproquement, le pas se coule dans ce que le rythme du vers lui infuse de sa musique.
Je ne résiste pas au désir de citer Michel Deguy, qui a écrit à propos de la poésie de Pierre Reverdy : « Le marcheur fait le temps avec sa marche, rythme et espace font le temps, frayant l’espace (« poussant l’horizon » comme un taillis éclairci par le corps) ». Et il écrit aussi, un peu plus loin, à propos de Chemin tournant : « Le poème de Reverdy est pareil à ce retour obstiné d’un marcheur au bord d’une falaise, ou lisière, où vient finir la terre : il revient « au bord des choses », hante la berge, hanté par cette figure de la marche et de la berge, où la réalité se dispose en « bord » d’elle-même. »
Oui, je le crois avec Michel Deguy, « la marche est un poème ». Le poète est celui « pour qui la marche est le poème de la marche, les choses « bord des choses ». Vous lire, cher Claude Cailleau, c’est aussi, comme en toute vraie poésie, se tenir sur le bord des choses et marcher en bord de falaise. Et si « la marche est un poème », votre poésie est de celles qui nous invitent à marcher en bordure de temps et d’abîme, sur ces chemins d’incertitude qu’à nous-mêmes nous sommes. Votre dernier livre de poésie, Crépuscules, ne démentira pas non plus ce que je viens d’écrire puisque, comme l’écrit Jean-Marie Alfroy dans sa postface à cet ouvrage où il fait référence à l’artiste japonais Hokusai : « Le mont Fugi de Claude Cailleau, c’est son enfance, qu’il ne cesse de revisiter par l’écriture tout en changeant constamment de point de vue ». Ecriture qui, en effet, ne se lasse pas d’explorer un passé qui vous permet d’interroger ce qui fait son présent. En vérité, ce qui constitue, cette fois encore, le contexte de ce dernier poème (une seule phrase de 30 pages), c’est l’unité du parcours dans lequel il s’inscrit, c’est-à-dire celui d’une vie tout entière placée sous le signe de la littérature et de la poésie, une vie qui n’aurait pas mis la sphère du poétique d’un côté et « le reste » de l’autre, mais les aura mêlés dans le « transvasement » de l’un dans l’autre, l’une croissant dans l’autre que celui-ci aura nourrie. La marche d’une vie. Puisque aussi bien la vie est marche.
L’écrivain Marc Delouze ne dit pas autre chose quand il déclare dans une interview : « Quant à la marche, oui, c’est sans doute un des « mouvements » fondamentaux qui animent ma démarche. Marcher, arpenter, parcourir, sillonner, explorer : c’est par les pieds que le monde nous pénètre d’abord, c’est avec nos pieds qu’on en prend la mesure (ou qu’on en fuit la démesure parfois) ». Et cela fait écho à vos propres mots : « Se déplace devant tes yeux, dans un paysage de landes – replis de terre, chemins d’errance, fleuris de mauve et de jaune roussi – la silhouette du marcheur d’un impossible devenir – grande cape et bâton, le pas rapide, comme fuyant sous la ruée des vents venus d’un automne marin. / Tu le suis dans sa quête insensée » (Pour une heure incertaine). Et Marc Delouze semble vous répondre quand il ajoute : « La fatigue des pieds (comme la solitude) est un carburant bigrement nécessaire qui nous permet d’éprouver le « besoin de l’autre ».
Oui, je persiste à associer lecture et écriture de la poésie à l’exercice de la marche, à ce qui, jailli d’on ne sait où, qui attend d’être là, sur le bout de la langue ou dans la lumière des yeux, lui donne l’occasion d’un éclat en tension, d’une radiance soudain accordée, comme sur la peau d’une eau sombre se pose la caresse d’un inattendu de clarté – mais aussi bien traverse « ce silence qui pleut en lisière de nuit sur l’énigme de la parole exténuée » (Pour une heure incertaine).
Les occurrences qui évoquent la marche (au propre comme au figuré), son mouvement, son avancée, abondent dans vos textes en images indissociables de la figure du marcheur. Ainsi, les feuilletant :
« s’en va sur le chemin
où la pierre
lasse d’inexister, appelle.
Les arbres le conduisent.
La forêt l’engloutit. » (Sur les Feuilles du Temps)
Ou :
« Dire encore le jour qui vient
dans les feuilles du vent.
Dire le pas qui s’éloigne,
d’une ombre dans le temps.
Les pas s’impriment sur le silence.
[…]
Chemins perdus
où la vie s’égare » (id.)
Je citerai encore Michel Deguy pour souligner à quoi ces occurrences nous rappellent : « Le chemin est et n’est pas (que) le chemin. Chaque jour la marche est reprise par le désemparement, la déception d’être et de l’être. » Et il écrit, un peu plus loin : « La sortie du poète, dont les pieds préparent le rythme du poème, date, dit le temps qu’il fait. Car il faut refaire le point, le temps, tous les jours un autre dans la même levée d’être. »
Et n’écrivez-vous pas encore, évoquant vos balades « à grandes enjambées », sur ces « plages en déshérence », au Port-Louis, accordé au murmure des vagues : « J’entendais leurs sanglots. Je m’égarais parfois – souvent – dans mes chuchotements » (Le Roman achevé) ? Aussi, au « gueuloir » de Flaubert, j’ajouterai, si vous me le permettez encore, la proposition, plus adaptée ici, du « murmuroir » (on pourrait aussi bien l’appeler « chuchotoir ») qui consiste à mettre à l’épreuve les textes qu’on lit ou écrit en marchant, une sorte « d’épreuve du feu ».
Certains d’entre eux (dispensons-nous de noms d’auteurs) s’essoufflent vite et ahanent, font un bruit de cailloux remués dans la bouche, ne tiennent pas longtemps le rythme, se brisent en fragments dont il faut recoller les morceaux, et révèlent un sang de navet, à moins qu’ils ne soient faits pour le silence de la lampe (pourquoi pas ?), mais il faut alors les veiller comme des oisillons. Ce sont des textes « d’intérieur », aussi sensibles au bruit qu’à la lumière. Il faut les ménager, ils négligent la part du corps et ne viennent que de l’esprit, ne s’adressant qu’à lui.
Les autres, au contraire, qui font preuve d’une plus robuste constitution, ne craignent ni l’espace découvert, ni l’infini de l’horizon ni aucun des caprices du ciel (ils ne réclament rien qu’une pochette imperméable transparente qui les mettra sans autre conséquence à l’abri de la pluie). Ceux-là font fi aussi des bourrasques du vent, des batailles de merles, des croassements des corbeaux ou du tournoiement des mouettes au-dessus des champs labourés, du bourdonnement d’un avion qui passe, du souffle de dragon d’un ballon dirigeable apparu au sommet d’une ligne d’arbres. Ou, plus exactement, ils s’en nourrissent. Ceux-là épousent, et quelquefois les dictent, la mesure du pas, les battements du cœur, les pulsations du sang, la rythmique du souffle, retiennent d’emblée la pensée, s’inscrivent dans l’élan du corps, dans le creux des viscères, dans la machinerie des organes. Et, sur le bord des lèvres, dans le froissement des mots prononcés, ils ont la force lente des rayons des phares qui éclairent la nuit où s’avancent nos vies.
Là-dedans, j’inscris en bonne et juste place votre si juste Pour une heure incertaine et votre si beau Roman achevé (livres de vous que je préfère, s’il faut faire ce choix difficile, et qui continuent de m’accompagner), qui ont pu, dans mes mains, bravement traverser les teigneux orages d’été ou les mutismes imbéciles des soleils de plomb.
Très amicalement.
Michel Diaz (04.09.16)
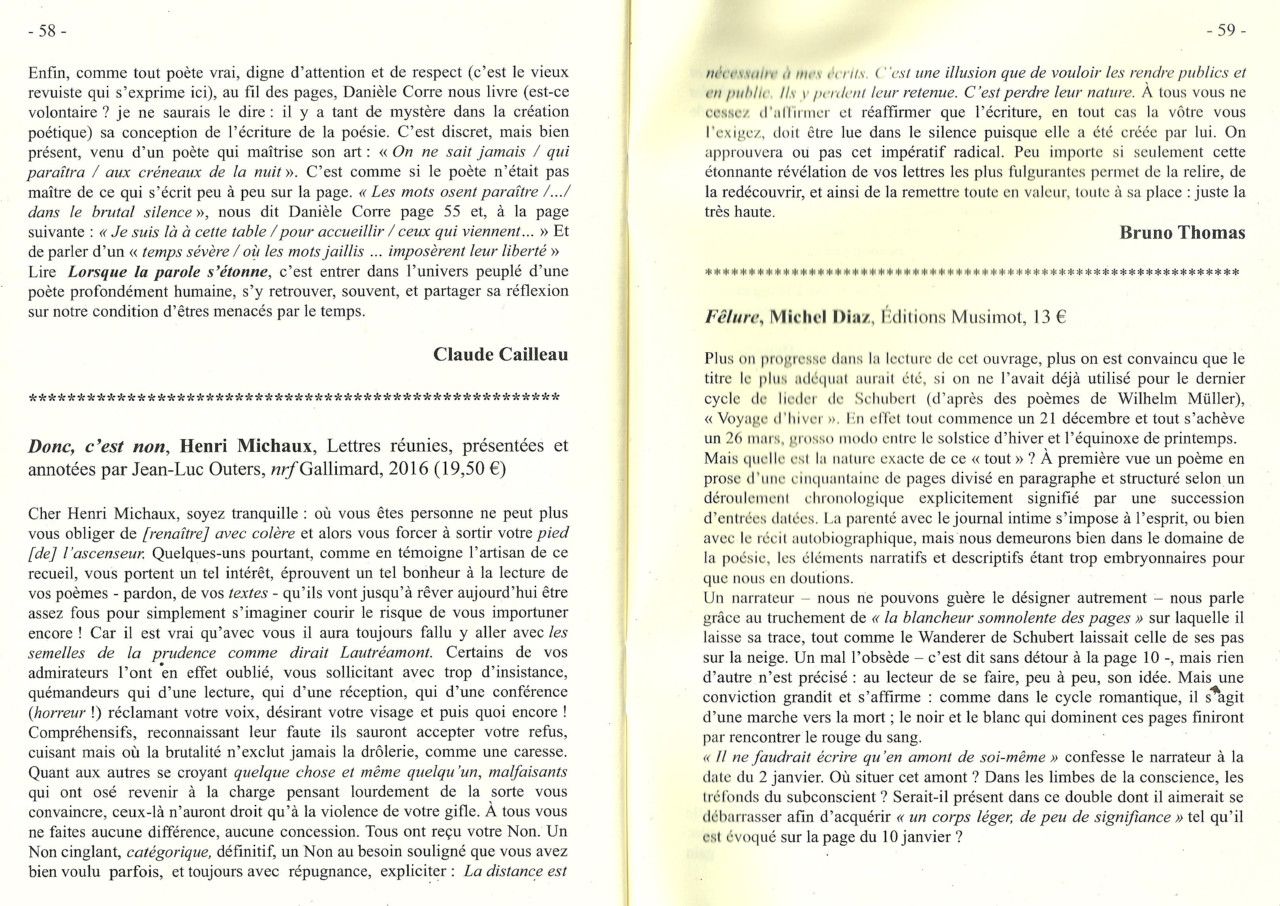
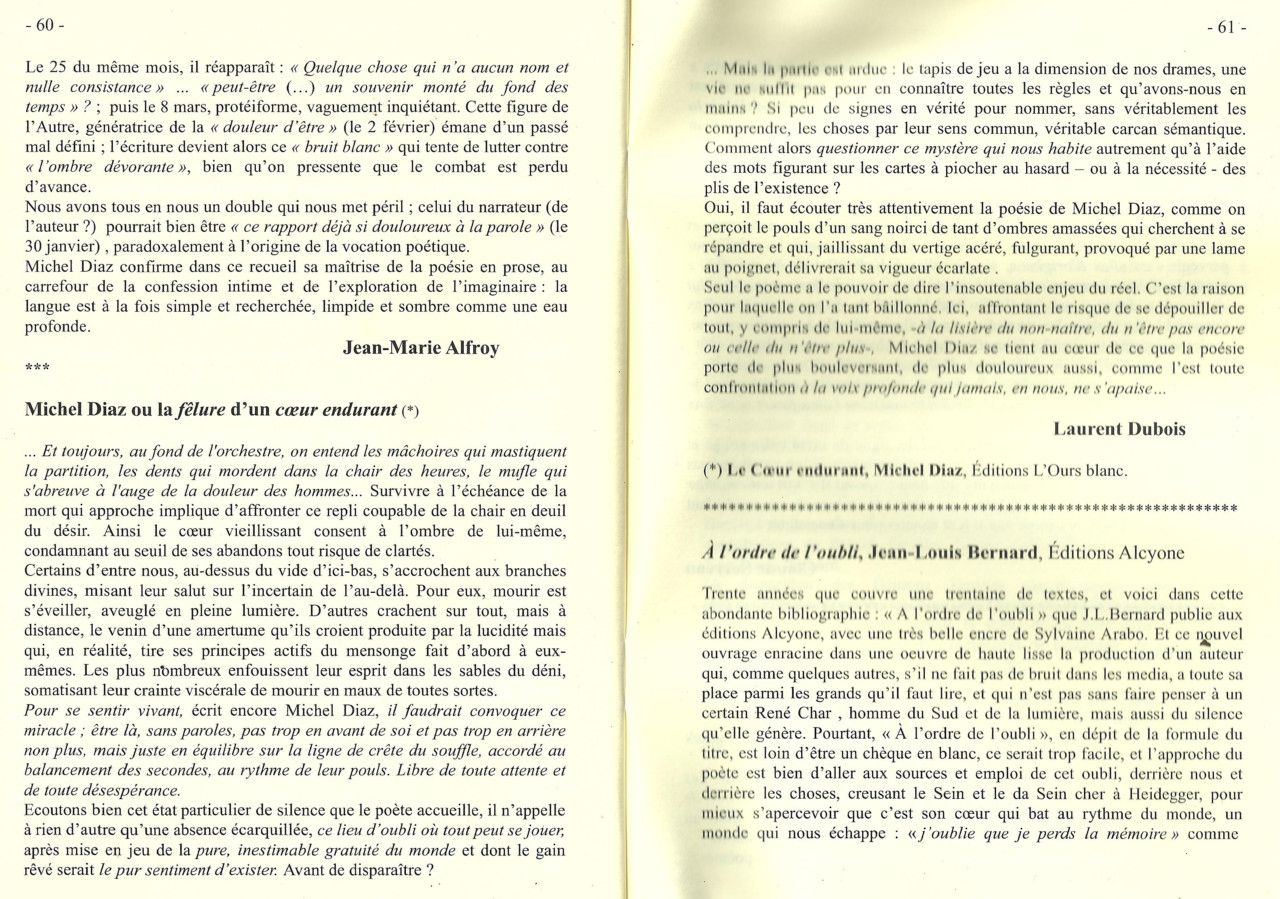
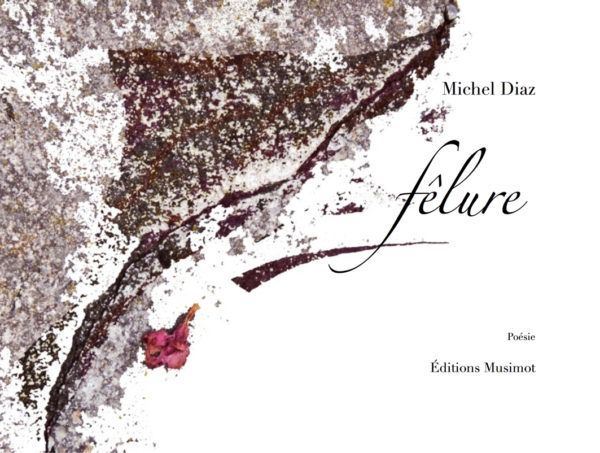 Michel Diaz
Michel Diaz Texte publié dans L’Iresuthe N° 37 (avril 2017) et Les Cahiers de la rue Ventura N° 40 (avril 2018). Ce texte a été repris et complété pour servir de préface à l’anthologie poétique de Cl. Cailleau (2019
Texte publié dans L’Iresuthe N° 37 (avril 2017) et Les Cahiers de la rue Ventura N° 40 (avril 2018). Ce texte a été repris et complété pour servir de préface à l’anthologie poétique de Cl. Cailleau (2019