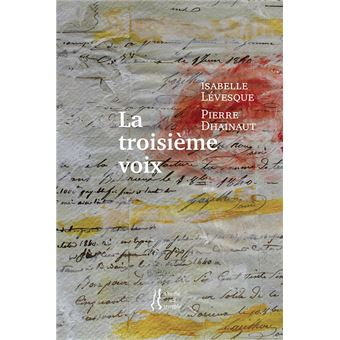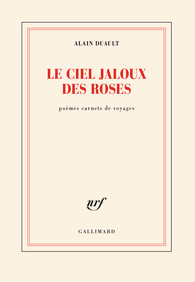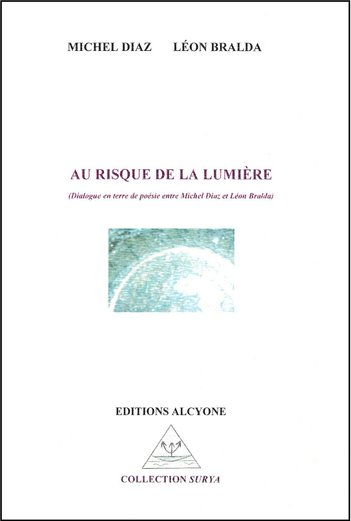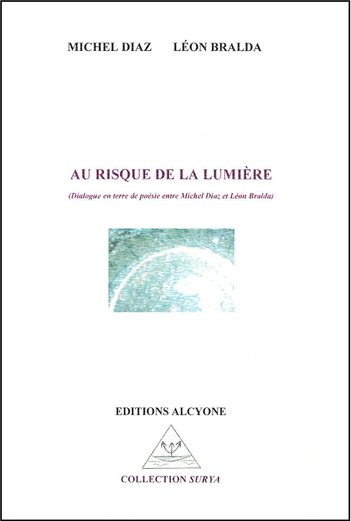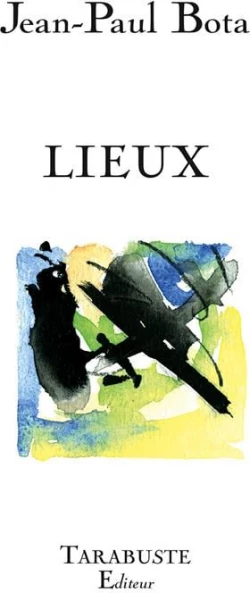
Lieux, Jean-Paul Bota, éd. Tarabuste (2023), note de lecture à paraître in la revue Place de la Sorbonne (printemps 2024)
Lieux
Jean-Paul Bota
Tarabuste Editeur, 2023
Cinq lieux sont successivement évoqués dans ce dernier opus de Jean-Paul Bota : Londres, Lisbonne, Nantes, Chartres, Airaines, et un sixième même, semi-imaginaire : Airaines à Chartres. Quatre villes de ports, de fleuves, de rivière… Même si discrètement évoqués, cette écriture ne saurait-elle se passer de la présence des eaux coulantes, des estuaires, de la mer ouverte sur d’autres ailleurs ?… Mais qu’importe si ces ailleurs ne nous invitent pas à pérégriner sous d’autres latitudes vers d’autres lointains exotiques, car pour cet écrivain l’ailleurs et l’imprévu de nos rencontres dans le monde sont toujours à portée de regard. Et un écrivain qui voyage (et il y en a eu beaucoup, mais souvent voyageurs d’un côté et écrivains de l’autre) n’est pas nécessairement ce que l’on appelle un écrivain-voyageur. Car l’écrivain fondamentalement nomade (dans ses parcours et ses curiosités) engage dans son œuvre tout son être intime et littéraire. Aussi le poète Jean-Paul Bota nous semble-t-il assez bien correspondre à la définition de Jacques Lacarrière qui comparait l’écrivain-voyageur à un « bernard-lhermite planétaire » et le définissait d’abord comme un « crustacé parlant dont l’esprit, dépourvu de carapace identitaire se sent spontanément chez lui dans la culture des autres ».
Dans cet ouvrage, Lieux, comme dans la plupart de ses autres livres, aux titres on ne peut plus explicites, Un ailleurs quelque part, Venise, Pérégrinations, La boussole aux dires de l’éclair, Chartres et environs, la poésie de J.-P. Bota pose inlassablement la question du lieu. « C’est, ainsi que nous l’avons déjà écrit ailleurs, la question que pose tout voyage. Territoire réel de la géographie physique, arpenté, reconnu et délimité, aux repères répertoriés, ou territoire du cheminement intérieur, marqué aux angles usés de la mémoire, se reculant au loin, mais reconstitué, gravé de noms et de visages, dépôts de strates successives, souvenirs de rencontres et de lectures, de silences, de mots et d’images, reliquats d’expériences de vie où se concentre l’essentiel des traces, comme dans les roches anciennes se sont conservés, pour nous mieux raconter notre histoire, ces animaux fossilisés, témoins d’époques disparues mais qui nous habitent encore et continuent de nous interroger ».
Poursuivons par une (innocente et plaisante) provocation, faite par un profane qui ignore quasiment tout des mathématiques et de la physique : Jean-Paul Bota est un poète de l’espace-temps. En physique, l’espace-temps est, nous dit-on une représentation mathématique de l’espace et du temps comme deux notions inséparables et s’influençant l’une l’autre. En réalité, nous dit-on encore, et nous le croyons bien volontiers, ce sont deux versions (vues sous un angle différent) d’une même entité. Ce que nous savons en tout cas, c’est que cette conception de l’espace et du temps est l’un des grands bouleversements survenus au début du xxe siècle dans le domaine de la physique, mais aussi pour la philosophie. Apparue avec la relativité restreinte et sa représentation géométrique qu’est l’espace de Minkowski, son importance a été renforcée par la relativité générale dont nous ne saurions pas dire quatre honnêtes mots… Mais qu’a donc à voir Jean-Paul Bota avec les lois de la relativité générale et la théorie quantique ?… Sinon que l’horizontalité de l’espace et la verticalité du temps se trouvent sous sa plumé réunis en une même dimension…
L’espace, pour Jean-Paul Bota, ce sont ces lieux chers à l’auteur, lieux gigognes ou poupées russes, villes contenant d’autres lieux, quartiers, rues, places, maisons, commerces, brasseries, cafés, monuments, ateliers des peintres et musées qui renferment eux-mêmes l’espace des toiles qui y sont conservées et dans lesquelles s’ouvrent d’autres dimensions. Le temps, ce sont ces différentes strates, comme couches archéologiques superposées, empilements d’époques, de moments artistiques et littéraires, de noms et d’éléments de biographies, feuilleté d’innombrables veines de savoirs et de mémoire où parfois s’associe quelque soupçon d’imaginaire : « Quoi court sur moi, où mon double s’éloigne ? dans la main fermant une part d’ombre parfaite d’obombrer _______________ ou à quoi réduire davantage un hier ou Caravage, des hyènes – pourquoi. ? – rôdent dans la mémoire taillant des fentes dans le souvenir… »(Lieux, p. 59)
Cet ouvrage se présente donc d’apparence sous la forme d’un « livre de voyage » dont les notes (souvent datées) semblent jetées sur le papier dans un style pressé, on le dirait aussi fébrile, à la syntaxe bousculée, la plupart du temps disloquée, souvent exempte de ponctuation, en des phrases qui se poursuivent en toute hâte, s’interrompent, se précipitent vers les suivantes pour ressurgir parfois plus loin, passant (apparemment) du coq à l’âne en suivant les zigzags d’une hasardeuse et imprévisible déambulation, comme dans une rêverie labyrinthique, offrant des choses et des événements une vision kaléidoscopique. « Une textualité, ainsi que l’écrit Michaël Bishop, à la fois émiettée et comprimée, elliptique, funky, excentrique, pleine de petits tics et de ces plis et replis qui ne cessent d’étonner, de pousser à regarder deux fois, trois fois, textualité qu’il faut, absolument, lire, penser, apprécier poïétiquement, selon les dimensions de son site de riche et fourmillante activité, d’art » (Poézibao, mai 2023). Ainsi, cet extrait de la première partie du recueil, Londoniennes, largement consacrée à Turner, à son apprentissage de peintre et ses premières œuvres, à son premier voyage en France, à sa technique et thèmes de prédilection, bateaux mâtés, remorqueurs à vapeur, mer en furie, tempêtes, naufrages : « Tempête de neige encore, à dire la légende que Turner aurait lui-même affronté la tempête et conçu le tableau attaché tel Ulysse à l’affront des sirènes solidement au mât d’un bateau par des marins comme il l’a plus tard raconté cela que révèle l’anecdote au-delà du mythe ou vérité ayant affronté lui-même une réelle tempête en mer sa propre expérience qu’il veut nous transmettre à redire encore avec H L’Incendie du parlement, réveillé par l’incendie Turner et le bateau qu’il loue pour être au cœur de l’événement, toute la nuit à peindre ou la dizaine d’aquarelles… »(Lieux, p. 24) Première partie consacrée aussi à la peinture de Constable, ses ciels, ses nuages, ses orages, avec échos de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, de la bataille navale de Trafalgar, pages où sont, entre autres, convoqués l’Amiral Nelson, Hogarth, Le Lorrain, les maîtres hollandais, Rembrandt, Ruisdael, Chardin, Monet, Big Ben, Philippe Cognée, Van Eyck, Van Gogh, Véronèse, Michel-Ange, Vinci, Caravage, Rodin, Degas, Picasso, mais aussi Vallès, Proust, Freud…
Pourtant, en dépit de ces lieux multiples, de ce dense faisceau de correspondances historiques, visuelles, esthétiques, anecdotiques, littéraires, de ces nombreuses digressions qui provoquent un presque vertigineux télescopage avec la musique, les écrivains, les poètes, et autres peintres, ceci rejoint toujours finalement cela, se reprend, se poursuit, s’épuise, et tout s’y tient au bout du compte, et pierre à pierre s’y rassemble, fait sens. Et que l’on vienne à retirer à ce qui appartient au temps ce qui relève de l’espace, ou qu’inversement on omette dans ces espaces ce qui se réfère à la vie et l’histoire, petite ou grande, et alors on n’aurait de ces pages rien qu’un éblouissant exercice d’érudition ou quelque savant guide touristique sans chaleur et sans âme. Temps et espace ici, indissociablement, sont une seule et unique matière d’une écriture (cf plus haut : « représentation et du temps comme deux notions inséparables et s’influençant l’une l’autre ») qui va son souffle et bat son rythme, cœur et sang inlassables, pulsations et emballements, repos, syncopes et relances. Jean-Paul Bota est un poète de l’espace-temps, mais encore un poète coureur de fond, de ceux pour qui cœur et jambes, esprit et muscles solidaires et confondus, font du temps et de l’espace la même raison d’avancer sans laquelle tout vrai sens de l’effort s’abolit, et n’est plus, s’il s’agit d’un auteur, qu’exercice de style ou entreprise littéraire seulement circonscrite à quelque projet esthétique.
Le titre de la deuxième partie, consacrée à Lisbonne, A l’ombre des corbeaux, trouve sa justification plus loin : « comme je songe Saint Vincent ses reliques depuis l’Algarve le Cap portant son nom et cela jusqu’à Sé la cathédrale deux corbeaux qui l’escortent, corbeaux de mer en fait, cormorans, ils n’existent pas j’entends dans la ville blanche, devenus corbeaux plus courants à Lisbonne… (Lieux, p. 84) ». Réflexion qui invite aussitôt l’auteur à évoquer « Ulysse que l’on dit fondateur de la ville depuis les Romains, lui sa très commune représentation, dessus la barque voguant en compagnie de deux oiseaux, et Saint Vincent parlant 1173 l’arrivée miraculeuse… martyr sur sa barque escortée de deux corbeaux blason de Lisbonne…(Lieux. pp. 84-85) »
Références historiques, soigneusement sourcées, méticuleusement réunies, et légende de l’un et légende de l’autre, comme d’autres récits présentés incertains ou fictifs, tout cela constitue la trame de cette écriture, ses différentes couches de savoir qui entretiennent la matière vive de la mémoire. Et Lisbonne, cette ville historiquement ouverte vers le plus large de l’ailleurs, l’océan et les Indes, est matière à convoquer d’autres références, à commencer par « celui-là dont le premier parle Ctésias, un animal sauvage semblable au cheval, portant sur le front une corne et qui court si vite que nul autre animal ne peut le rattraper, celui-là encore que Pline l’Ancien décrira comme La Bête la plus sauvage de l’Inde (…) le monocéros ou (…) unicorne… (Lieux, p. 71) ». Et ce rhinocéros débarqué à Lisbonne, en mai 1515, date de la première victoire d’un jeune roi français à Marignan, animal rejoignant au Palais da Ribeira la ménagerie de cet autre roi, Manuel I° d’Aviz. Et cet autre rhinocéros que François Ier, profitant de son passage au large des côtes de Marseille vint admirer sur l’îlot d’If, symbole sans doute de chevalerie, ce Panzernashorn représenté par Dürer dans une célèbre gravure sur bois, image qui ne fut corrigée qu’au milieu du XVIIIe S, quand un autre de ces mammifères fut débarqué à Rotterdam le 22 juillet 1741… Mais ces Tableaux lisbonnais appellent, sous la plume de Jean-Paul Bota, bien d’autres références, comme Satie, Valadon, et incontournablement Pessoa, ses pseudonymes et ses hétéronymes, son ancienne maison, ses statues de lui dans la ville, avec nœud papillon, sa seule liaison avec Ophélia Queiroz, sa rupture avec elle, les lettres conservées, et la chapelle éponyme de l’Eglise Saint-Roch qui accueille la statue du saint en bois polychrome, la peinture représentant le même par Gaspar Dias, Apparition de l’Ange à Saint Roch, avec le chien protecteur et le pain qu’il vola à son maître pour nourrir le saint homme.
Dans la troisième partie du recueil, consacrée à Nantes et ses environs, intitulée Du vent dans les grues, Jean-Paul Bota invite encore une copieuse série d’artistes et d’auteurs. Ce seront Stendhal, Vallès, Gracq, Sacré, Vaché, Josse, J. Verne, Julienne David, Baudelaire, Breton, Prévert, Paul-Louis Rossi, Rego, Laurencin, Picasso, Degas, Correia, Cravan, Gonzalez, Duncan, Flavin… Pas de rhinocéros ici, mais un autre pachyderme, le fameux éléphant des Machines de l’île, construites par la Compagnie Royal de Luxe, cathédrale d’acier et de bois (tulipier de Virginie, une allusion à J. V. et La Machine à vapeur) capable de transporter jusqu’à 50 personnes. Au demeurant, cette section commence par l’évocation d’autres monstres d’acier qui veillent sur le port : « Les grues Titan, ainsi de leur nom en référence à leur puissance de levage, l’une jaune, la plus ancienne, aux allures de fusée et l’autre, grise à la pointe ouest de l’île Gloriette, depuis 66 surplombant le bassin d’évitage au lieu où faisaient demi-tour les navires, on dirait une sauterelle (encore que surnommée « pince à sucre »)… (Lieux, p. 91) ».
Usant toujours de même de l’espace-temps, évoqués le château des ducs de Bretagne, les fantômes de J. Verne, l’hospitalisation à Nantes, en 1915, de J. Vaché blessé au mollet, en Champagne, par l’explosion d’un sac de grenades, de la biscuiterie Lefèvre-Utile, et parlant des rues aux noms de corsaires, du quai de la Fosse, du monument à Jacques Cassard, de la place Graslin du nom du financier qui fit fortune dans le café, de ce que l’on devine de l’ancienne opulence de la cité, subsistant dans les belles maisons de maîtres et les hôtels particuliers, peut-être dans La Cigale brasserie le style Art nouveau quoi de la fable partout, sur fond de stuc, or des mosaïques et profond des miroirs, aux cinq salles & petit salon, représenté l’insecte avec sa mandoline sa jupe elle d’Émile Libaudière et café Molière là…(Lieux, p. 97), Jean-Paul Bota peint pourtant en arrière-fond cette époque de la fin du XVII° S. et du XVIII° S. où Nantes connaît un important essor économique grâce à la traite négrière, base de la fortune des armateurs locaux, et devient le premier port négrier français – même si le commerce triangulaire ne représente alors qu’une fraction du commerce maritime en général et que les sociétés d’armement maritime s’intéressent encore à cette époque à la pêche morutière et à l’armement corsaire. Cela, comme l’écrivait encore M. Bishop dans le même article, « procédant toujours d’une alerte mémoire puisant profond dans un vif sentiment d’une interpertinence culturelle et d’un entretissement historique qui baignent les eaux d’un certain hic et nunc où s’aventurent les pas du flâneur comme de tous ceux qui ne savent pas peut-être quelle richesse les entoure et dont, effectivement, ils font partie » (Poézibao, mai 2023).
Les dernières sections de l’ouvrage, Chartres, Airaines et Airaines à Chartres (pure fantaisie géographique ?… non), sont essentiellement marquées par une rupture de ton, et l’on pourrait presque les rassembler sous le titre de Chemin de mémoire, pour reprendre les mots qui reviennent à plusieurs reprises dans ces pages. En effet, rares sont les textes où Jean-Paul Bota, la plupart du temps si discrètement en retrait, se laisse aller à exprimer aussi explicitement quelque sentiment personnel, sinon ici et là par le moyen de signes typographiques ou d’une exclamation récurrente, Aah. Ces dernières pages ne sont plus de quelqu’un qui découvre des lieux ou en approfondit la connaissance, les fouille, les explore, les interroge, cherchant à en extraire toute la richesse possible, mais de quelqu’un qui, revenant dans des lieux familiers, et où sans doute il a vécu, sur les traces de son passé, en revisite la géographie, et mettons bout à bout ces quelques fragments de phrases relevés dans les premières pages, non exhaustivement, parmi bien d’autres dans la suite : « Revenant là Chemin de mémoire […] Où je devine le parc dans mon dos un chemin d’autrefois vers la gare […] halte au café pour 1 bock etc. où je reviens […] le bruit décroissant d’une motocyclette, là comme à l’enfance […] et toujours la maison aux volets verts 1 souvenir d’hier, etc. […] la maison abandonnée comme je reviens là aux marronniers […] et plus loin que reste-t-il où je venais au pré touchant la rivière […] l’ancienne gare voies désaffectées […] le silo que tapisse le lierre vert & rouille […] Le jardin désert et la maison… (Lieux, pp. 127-138) ».
Retour donc sur ses pas de quelqu’un qui constate qu’apparemment rien n’a changé mais que rien pourtant n’est pareil, y retrouvant tous ses repères mais ne s’y reconnaissant plus : « Le muret où je m’asseyais face au pub livrée verte des façades à la place Drouaise le musée de l’école et ces roses trémières là leur blanc pâle le parfum des tilleuls Chemin de mémoire à l’instant où j’allais la rue Muret l’enseigne rouge du boucher qui n’est plus depuis combien de temps la vitrine au blanc d’Espagne à vendre et le salon de coiffure les lettres encore qu’on devine et l’épicerie où était-ce où je venais et le jaune là-bas du fleuriste… (Lieux, p. 129) ».
Ces quelques pages sont parcourues d’une profonde nostalgie, pas loin d’un lyrisme élégiaque où notre cœur se serre, et nous nous souvenons de ces vers de Verlaine : « Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, / Je me suis promené dans le petit jardin… (Poèmes saturniens) ». Dans cette dimension de l’espace-temps dont nous avons parlé plus haut, le temps a repris le dessus pour redevenir cet agent de dégradation et de destruction où, en dépit de la mémoire qui se refuse à voir, tout change cependant, s’abîme, s’efface et se perd, promis à une inéluctable disparition. Les nombreuses strates temporelles qui jusque-là permettaient l’entretien et le jaillissement d’une mémoire vive, semblent devenues dans ces pages autant de couches de peau morte qui nous renvoient à notre finitude. Ô vanité des vanités !
Rien pour autant, dans ces dernières pages, qui puisse nous assombrir puisque toujours « s’ébrouent les feuillages aux vents des après-midi », qu’ « un oiseau distrait le silence de proche en proche frémissent les orties au ruban de l’eau », que « se pose sur câble un pigeon ramier » et que « des vaches là-bas paissent en hauteur à surplomber des cheminées roses & l’ocre des façades… (Lieux, pp. 128-135) »… Subsiste malgré tout quelque pérennité dans la disparition progressive des choses…
Il faut nous engager dans la lecture de ce livre comme on s’engage dans une aventure. Faire confiance. Se fier à… Sans trop savoir où l’on va (comme s’égare Ulysse) mais sûr que s’éloigner de quelques pas de ces rives, on le veut. L’obscurité n’est pas celle qui règne là devant nous mais bien celle des brumes qui bouchent à l’arrière des chemins du retour vers les niches. On lit. Fort de ce savoir que l’auteur nous distille de page en page, selon lequel « le poème est toujours marié à quelqu’un » selon les mots de René Char. Sera-ce celui-ci, un autre ?… Peu importe. Il nous faut entrer dans ce livre comme on s’avance non vers un rendez-vous mais une rencontre possible, un coup de vent. Car un poème, c’est un événement dans le tissu du langage, et Jean-Paul Bota en sait quelque chose. Ses livres sont un pur jeu d’intensités. Des mouvements de forces sont là, toujours au travail. Soulèvements, ruptures, éboulements, plissements de matière, nouveaux surgissements… A ce titre, cet auteur est moins à comprendre qu’il ne nous comprend, nous éclaire et nous guide, nous serre dans ce qu’il nous donne qui nous nourrit. Il nous faut nous engager dans ces mises à nu de nous-mêmes (comme décapage de notre « culture ») qui pensions peut-être savoir, mais savions peu, ou mal. Le monde s’il n’en ressort pas plus compréhensible risque de gagner en saveur… alors le vrai savoir n’est pas loin.
Michel Diaz