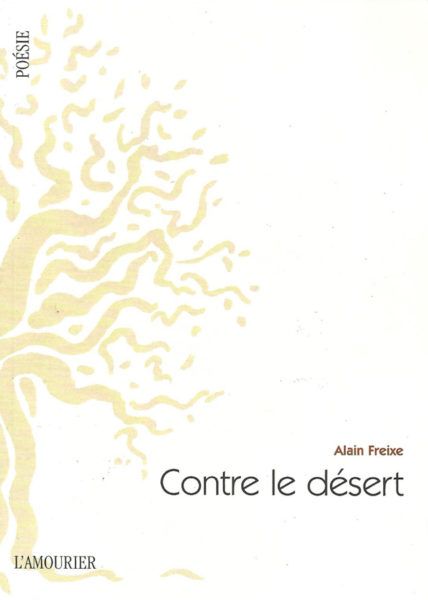 Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017
Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017
CONTRE LE DESERT
Alain Freixe
Editions de L’Amourier (2017)
Dans sa note liminaire au recueil d’Alain Freixe, Contre le désert, et faisant référence à une toile de Magritte, Pierre Legendre écrit: « (…) La lunette d’approche découvre ce qu’il y a derrière les emblèmes, les images, les miroirs: un vide, le gouffre, l’Abîme de l’existence humaine. C’est cet Abîme qu’il nous faut habiter. La raison de vivre commence là. »
Elle commence là. Et puisque, dit l’un des textes, « c’est toujours le soir » et « la venue des ombres sur ce que l’on croit », puisque « le monde, ce qu’on en voit, on l’ignore », c’est cet Abîme d’ombre menaçante que la parole d’Alain Freixe s’efforce d’investir. Mais parole qui est présence au plus près de son être et des choses contre l’Abîme de notre existence humaine. Car face à cet Abîme qui s’ouvre devant nous et nous cerne de toutes parts, nous n’avons que bien peu de choix: celui de s’y abandonner et de se laisser engloutir, de nager quelque temps dans sa nuit, se survivant, se débattant comme on le peut, entre deux goulées d’air, ou celui de s’y appuyer, comme on peut appuyer son épaule à un mur, ou son front au miroir obscurci de soi-même, pour ne pas être dans le « contre » qui oppose, mais bien plutôt pour se tenir « contre » ce qui nous résiste et nous garde debout dans cet effort d’étreindre nos faiblesses et la lancinante douleur de nos désespérances.
Cette parole d’homme que rend lisible celle du poète est présence qui sonde le vide et son gouffre, s’avance « sur les bords du monde » *, se donnant tâche de s’y confronter et, pareil au « rôdeur de crêtes, qui se penche ici, chancelle là », prend parti d’habiter son vertige pour mieux l’apprivoiser, et si notre présence au monde est vertige, on peut faire du vertige sa force. Mais si dans le tableau de Magritte, comme l’écrit encore P. Legendre, « Le battant qui s’ouvre emporte avec lui le paysage, un ciel et des nuages », la fenêtre qu’ouvre A. Freixe (ou plutôt qu’il fracture en en brisant les vitres) donne, elle, sur des paysages dont les fragments perçus nous arriment à notre raison de vouloir exister, au désir d’une faim partageable pour approcher ce que l’on croit saisir du monde. Celui que la réalité sensible nous donne à regarder, à explorer, à déchiffrer, à interroger sans relâche, nous incitant à défier le vide de l’Abîme et à tenir la dragée haute à tout son incompréhensible.
Car A. Freixe est homme de ce monde, et son écriture terrienne mais inspirée en droite prise avec les éléments, feu et eau parfois confondus dans la même brûlure, en prise avec le minéral, le végétal, ce qui murmure dans les feuilles, parle dessous les pierres, en prise encore avec le ciel et l’abrupt de son bleu, avec les forges de l’été, les crépuscules de l’automne et « le vent qui balaie les chemins », avec ce qui s’éloigne dans la transparence du jour et ce qui, dans la cécité qui pèse toujours sur nos yeux, témoigne de la nuit dans laquelle s’égarent nos pas. « Oui, écrit-il, j’ai besoin d’images/ de prises de sang/ sur le monde/ de prises de vue/ de cadrage/ et de leur hors-champ. » Il y a, dans cette écriture, le panthéisme que l’on trouve à l’œuvre dans celle de Giono, un monde où quelque chose passe mais demeure dans le même mouvement vital, son élan archaïque, un « évanouissement qui dure » et nous renoue avec les vieilles forces de nos origines, les voix « des profondeurs du monde » et de nos forêts ancestrales. Ce monde-là, vivant, toute notre conscience d’hommes semble s’y être noyée, mais tout y est « comme en réserve », à portée d’yeux, de mains, de mots, mais toujours ailleurs, et plus loin, dans cet écart toujours ouvert au sens mais qui toujours se tient « dans la grande nuit des pages. »
Si l’on ignore ce que l’on voit du monde, il en « reste un contour qui se perd dans les clairs de jour ». Le travail du poète consiste alors à s’introduire dans ces « clairs de jour » et à rêver, obstinément, « certains soirs de mettre le ciel des mots à l’orage, d’y sertir la foudre, cet éclair qui n’a de cesse. » La tâche du poète est « de guider cette lumière jusqu’aux serrures des mots et faire voler en éclats toutes les portes de la réalité. » Faire aussi voler en éclats ce miroir obscurci de soi-même dont je parlais plus haut, « et s’y voir enfin. » C’est-à-dire accéder aux territoires du réel, qui recule sans doute à mesure qu’on y avance, mais qui est territoire de la parole poétique et de sa vérité.
Face à cet au-delà du sens qui règne sous l’apparence des choses, au revers du regard, il faut que « fermer les yeux soit comme déchirer la page, briser la surface, ce piège à regards. » C’est à ce prix « que l’arrière passe devant ! Le dessus dessous ! » Et le travail de l’écriture poétique est de faire en sorte que l’œil voie « au-delà de l’œil ». Car parole poétique est celle qui jette ce pont du regard intériorisé au-dessus de l’abîme, pour que « le cœur vole au profond. » Habiter ainsi la parole, c’est habiter « la langue des secrets » qui ouvre à on ne sait « quel jour« , mais dépose sur notre langue « cette saveur de terre », nous permet d’espérer « quelques poignées de ciel ». C’est sur ces terres, que les mots défrichent, que le poète installe ses quartiers, pour que le monde glisse depuis sa nuit jusqu’en ses mots et ses images. Terres que la parole fertilise et dont Edmond Jabès nous dit, en y posant ses pierres et y levant ses murs: « J’y bâtis ma demeure. »
Mais l’expérience du langage est rude épreuve, la demeure est maison de paille soumise au moindre coup de vent « des ciels bouleversés ». Et les chemins qui y conduisent sont bien plus qu’hasardeux. « On s’y égare. Se perd. On a peur, parfois. On remonte. On est vivant. »
Vivant, voilà l’enjeu. Rester vivant.
Avant même de pouvoir nourrir l’espérance de bâtir sa demeure, et peut-être d’y habiter, la première raison de vivre serait de travailler à « rester vivant. » Dans la grâce du temps accordé sur lequel, comme sur un étang d’eau lisse, « certains jours/ la montagne se pose », où « il advient quelquefois, ainsi que l’écrit Marcel Alocco dans son Laërte ou la confusion des temps, qu’un matin d’eau pure naisse des sueurs de la nuit. » Une aube claire, semble lui répondre A. Freixe, « fidèle comme cette lumière qui a besoin de tous les mots pour porter son miel, l’amertume de sa douceur jusqu’à nous. »
Mais à quel prix ?… L’inlassable répétition, l’inlassable tourment du recommencement, l’usure des minutes, du retour inéluctable au même point d’incertitude, toujours forçat de son inépuisable inaccomplissement et du doute perpétuel, puisque tout recommence, toujours, quand on croit que cela continue. Puisqu’il est vrai qu’en poésie on marche seul, qu’on se cogne à sa solitude, qu’on s’écorche à ses ronces, que le but à mesure s’estompe. Qu’il nous faut rester là, « à attendre/ dans le muet du monde/ les mots/ qui portent le soleil/ et se rient de tous les froids. » Il faut pourtant continuer, toujours, et s’incorporer au chemin que seul, toujours, génère son inachevé. Puisque, sur les chemins de poésie, on n’avance qu’en se perdant, qu’en ne sachant rien du pays de leur destination. On sait juste qu’on est plus loin quand « l’étoffe des mots se déchire » et « quand se dérobent les pas. »
Il faut aller pourtant, « contre le vide, le gouffre, l’Abîme de l’existence humaine », pour reprendre une fois encore les mots de P. Legendre. Rester vivant et s’attacher à cette faim, comme les ongles de la vague creusent le rocher solitaire. Faim si essentielle « que le désir y risque sa chanson perdue », et faim de ce désir « pour qu’au bout ce soit enfin le jour, quelque chose comme un matin et ses braises où suspendu un feu tremble dans l’absence des flammes. » Aller alors. Creusant sa voix. Traçant ses rides. « Avant, comme l’écrit A. Freixe dans les dernières lignes du recueil, avant de tomber. A genoux. Comme on tombe comme on est amoureux. »
Oui, tomber. Mais pour se relever encore. Se relever. Toujours. « Et dans la marche qui s’en suit saluer du coin des yeux le passage du cœur. Cela suffit pour une joie ! »
Rester vivant ! Les poèmes d’A. Freixe nous y invitent, plus même, nous y incitent. En dépit de la pluie et du soir qui tombent sur ces pages, et de l’ombre portée qu’y jettent nos détresses et les sombres étoiles du ciel, il y a l’espérance toujours de ces joies fugitives que nous réservent les chemins du cœur et notre acquiescement au monde. Cette insistance d’une lumière à se glisser sous la paupière et sous l’apparence des choses. Comme une lumière de résistance, la clarté d’un volet qui s’entrouvre ou le rai de lumière qui tombe à travers un vitrail.
Michel Diaz
05/10/17
* Titre d’un poème in le recueil Comme des pas qui s’éloignent.