Propos du livre
Un recueil de nouvelles réunies autour du thème du passage, la situation de passage, qui à certains moments de nos vies, lorsqu’une fracture se produit, nous fait basculer vers un ailleurs méconnu. Un seuil où l’on a peine à se reconnaître mais toujours révélateur de quelque vestige – ou vertige – intime. Dramaturge, poète, écrivain, Michel Diaz met toute sa science de l’écriture, au service d’évocations fortes : personnages, lieux, émotions, inquiétudes, angoisses, horreurs, espoir… qui éveillent de longs et profonds échos chez le lecteur. Et son sens de la narration lui fait approcher des situations les plus secrètement vécues : Lent effacement d’une comédienne, souvenirs ultimes d’un soldat de la deuxième guerre, rencontre d’une énigmatique enfant en bord de Loire, récit des relations entre mère et fils durant la tempête du siècle… À deux doigts du paradis est un de ces livres auxquels on s’accroche, même si on l’ouvre au hasard.
Extrait : Sortilège de Pan
(…) S’éloignant de la rive, il traversa en pataugeant un bras stagnant du fleuve, de l’eau jusqu’aux genoux, mit le pied sur une petite île et, s’étant frayé un passage à travers la végétation épaisse qui la couvrait, il gagna l’autre berge afin de retrouver le lit qu’emprunte le courant. (tout cet espace déployé dans le regard, sa hauteur lumineuse gréée d’azur et de clameurs, vaisseau de formes fluides éternellement aspirées vers ces vagues lointains où les eaux se rassemblent…) Sur l’étroite bande de sable qui glisse en pente douce vers le fleuve, il aperçut l’enfant. Une fillette de huit ou neuf ans. Pas davantage, estima-t-il. Après avoir jeté un coup d’œil circulaire, il ne remarqua pas d’autre présence humaine, et n’entendant pas d’autre chose que son fredonnement d’abeille, il s’étonna qu’elle fût seule. Absorbée par son jeu, les genoux et les mains enfoncés dans le sable, visage presque au ras du sol, elle ne le vit pas venir. Ses sandalettes de plastique étaient posées à côté d’elle. Elle avait un pantalon rouge, en toile de jean, un tee-shirt vert olive, des cheveux blonds noués en tresses qui se balançaient dans le vide, par-dessus sa nuque penchée. Il resta un moment immobile, sans dire un mot, de crainte de l’effaroucher. Jusqu’à ce qu’elle l’aperçoive, en relevant la tête, debout à quelques mètres d’où elle se tenait. D’abord, elle ne lui parut ni surprise ni effrayée. Peut-être seulement curieuse. Sûrement intriguée. Tout autant que lui pouvait l’être. Pour faire quelque chose, se donner quelque contenance, elle plongea sa main dans le sac de bonbons posé entre ses sandalettes, hésita un instant à lui en offrir. Y renonça presque aussitôt. Dans son regard, il entrevit comme une lueur de méfiance, une braise de rien du tout, mais qu’il voyait briller au fond de son iris. – Bonjour, il dit. – Bonjour, elle lui dit aussi, en le dévisageant.
« A deux doigts du paradis », éditions L’Amourier, 18 euros.
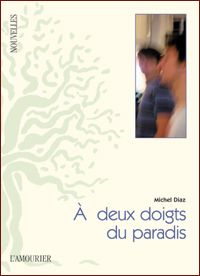
 SEPARATIONS, nouvelles, Editions L’Harmattan (septembre 2009),
SEPARATIONS, nouvelles, Editions L’Harmattan (septembre 2009),