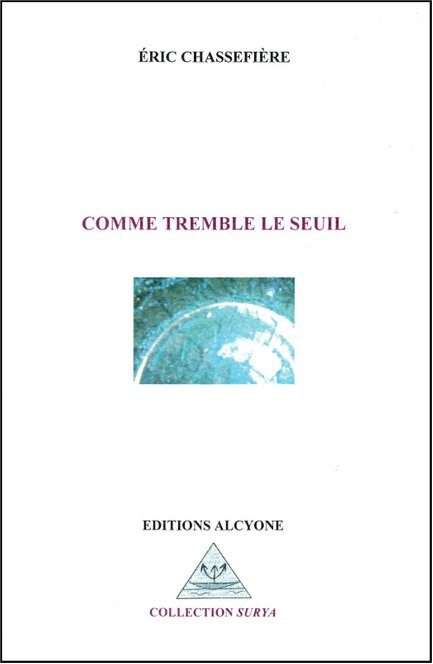
Comme tremble le seuil – Eric Chassefière
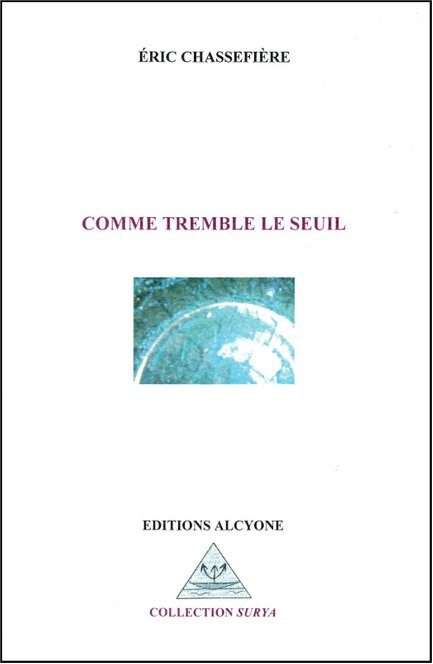
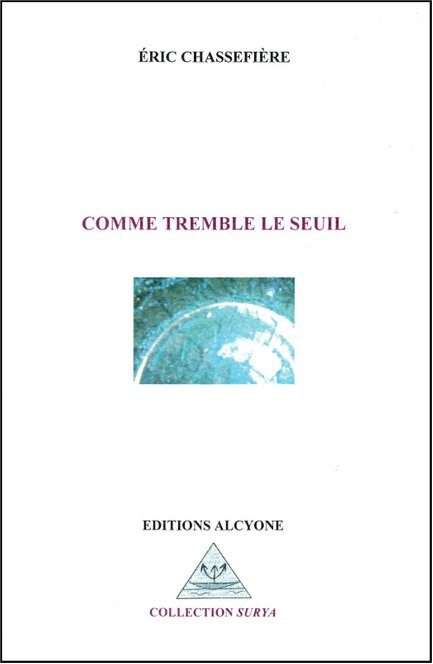
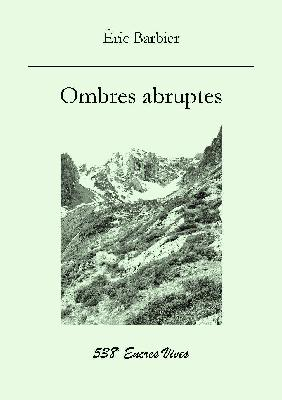
Note de lecture publiée in Francopolis (septembre 2024)
« Michel Diaz nous livre dans ce vaste recueil aux lents méandres de mots et de pensées, conçu dans l’écoute des sources, qui deviendront ruisseaux puis rivières, et ponctué de gravures sur bois de Lionel Balard, une méditation sur la fragilité de l’instant, l’imprévisibilité du chemin, dont le cours léger de l’eau jaillie de la pierre, et scintillant dans la pénombre des fourrés ou entre les cailloux de quelque sente étroite, constitue dans ces pages la métaphore minutieusement explorée.
Cette source jaillie de la pierre, ce chuintement de l’eau qui sourd, une eau nous confie le poète « déjà liée à la lumière, à la parole commençante, ce balbutiement, inséparable encore de sa part de pénombre », ce cours encore hésitant à trouver sa pente, ne sont-ils par ailleurs ceux de la vie, de la parole balbutiante qui explore, « source qui cherche son chemin / … / à l’orée du silence et au seuil de la voix », imprévisible chemin qui serait celui du poème à naître : « une matière souple et fluide, insaisissable, en calme devenir / dans l’évasement de son souffle, vers cet inconnu qui l’attend, la trajectoire du poème / pour peu que l’exigence de sa transparence la maintienne éveillée ».
L’eau qui court, scintille, sinue, rebondit, se fraie passage, se fait au fil des pages matière même des mots du poète, les poèmes deviennent images fugaces de l’eau, à l’égal des gravures aux riches effloraisons de noir placées en regard des textes. Écoutons le poète :
son bruit, une caresse d’air, à peine perceptible, le glissement d’une navigation très lente dans les veines
perpétuelle ambulation qui s’abandonne à la mémoire de son cours, elle est cheminement sans hâte au lieu de sa disparition
ce n’est qu’une brassée de paroles légères, un chuchotis errant, intraduisible, qui distribue les traces de sa voix entre les couleurs et les ombres
La forêt ici se fait corps, la rivière qui s’écoule en elle et l’irrigue de sa mémoire sang qui lui donne vie, mais une vie fragmentée, noyée dans le bruissement de l’impermanence, « don de la fugitive au perpétuel parler incertain, qui inlassablement nous dit l’éphémère et le périssable / nous révélant à chaque instant, au vif des signes, l’inaudible rumeur du temps ».
Il y a dans la poésie de Michel Diaz, cette idée qu’on retrouve clairement formulée notamment dans son recueil « Sous l’étoile du jour », d’une errance de l’homme inhérente à sa condition, errance sans fin dont l’inachèvement même donne sens et substance à sa vie, une « lente errance, songeuse et parfois éblouie, sur nos chemins d’imprévisible », écrit-il dans la dédicace à l’exemplaire transmis par ses soins. Les gravures de Lionel Balard illustrent à merveille cette idée d’une errance sans limite, avec leurs labyrinthes de motifs blancs et noirs s’enchevêtrant dans la profondeur de la page, qu’il s’agisse de formes de fougères s’entrecroisant, d’échelles de reflets s’étageant au long d’une rivière, d’arbres déployant un incendie de noir dans l’incendie de blanc d’un ciel, de mosaïques de cailloux et de racines signalant une sente au fond d’un sous-bois, autant de compositions donnant corps à la déambulation du lecteur « en ce dédale de ciel dur et de berges muettes » que nous offre le poète traçant cours de cette eau qui sans fin se dérobe pour renaître ailleurs.
Il faut se laisser prendre au jeu des méandres et des lenteurs de ces textes qui cherchent, derrière « l’éphémère et l’impermanence des choses », à nous faire saisir le miracle de la poésie et de l’accession à l’état de présence au monde qui en est la condition. Le poète, comme le lecteur, en ces pages, se font marcheurs, portés par le murmure de ces eaux dont peu à peu ils parviennent, peut-être, à saisir la source dans l’intégralité de son cheminement de la naissance à la mort : « le temps n’existerait donc pas / telle est l’eau, de loin si troublante et de près si confuse, qui reste là toujours, mais s’étire et s’échappe comme un chemin, appelé à renaître pour se défaire dans un murmure de galets, de cailloux et de sable qu’aucune main ne fouillera jamais ». Comme si le chemin lui-même se faisait écoulement du temps, que marchant sur le chemin, on atteignait une certaine forme d’éternité, cette humanité peut-être que nous confère notre obstination à atteindre un but que nous savons inaccessible, et nous garde de toute désespérance. Citons Léon Bralda : « Mais nous marchons dès lors [en quête que nous sommes d’un fugace reflet] dans la sonorité nouvelle de l’heure qui murmure le monde, appelle un devenir, nomme à notre encontre ce que sera demain ». Mais laissons parler Michel Diaz :
cette eau, d’aucune forme prise, mais entre errance et veille miroir de toute impermanence, pour dire la lenteur de l’indicible, le chatoiement des cendres du fugace
et la balafre de son rire clair à travers ombres et décombres, la vase et le piétinement des pierres, en route vers l’ailleurs
cette blessure irréparable ouverte sur le vide
Blessure peut-être de l’inachèvement dont nous tirons la force de continuer, explorer sans relâche ces paysages où se répand la source de vie qui nous a donné naissance, et qu’il nous faut explorer au plus près de notre être véritable, si nous voulons vraiment faire poésie, libérer pleinement et sans entraves cette eau primordiale dont faire, tâcher de faire, le cours de notre vie. Un beau livre dans lequel se perdre et sans cesse se retrouver entre naissance et devenir. »
Eric Chassefière
Article publié in Trames nomades, juil. 2024
Sous l’étoile du jour, recueil de Michel Diaz
Sous l’étoile du jour, Rosa canina éditions, 2023.
Le préfacier, Alain Freixe, choisit de ne pas faire réellement une préface, si c’est orienter la lecture des textes de Michel Diaz. Il propose « quelques notes prises sur cette partition qu’élabore sa pratique poétique. ». Ces textes, comme en marge, ont, comme exergue, une citation de Jean-Marie Barnaud : « Tu marches cependant / tu ne sais où tu vas / dis-tu / tu vas vers ton secret / telle est l’audace / cela suffit pour une joie. » Choix très judicieux, ces vers, car Michel Diaz aurait pu l’écrire pour lui-même, lui pour qui la marche nourrit la pensée et le geste d’écrire. Et la marche est aussi la représentation d’un processus créatif.
De ces notes je relève un fragment : « C’est toujours la marche en avant. Vers l’impossible salut. À cause de cet appel insensé qui, du fond de notre finitude, nous a fait roi mage de notre vie en quête du vrai lieu. Telle est l’aventure de l’homme cet être des lointains. L’homme dans la poésie de Michel Diaz remonte ses épaules, relève la tête et poursuit. »
Michel Diaz a structuré son recueil en deux parties. Pierre du vent et Sous l’étoile du jour, qui donne donc son titre au livre.
En exergue à la première partie, une citation de Jean-Louis Bernard, dont je copie la première phrase : « La poésie peut ainsi être vue comme un exode sans fin vers le lieu d’où tout procède, vers la parole d’avant les mots. » Loin des définitions faisant d’un pauvre lyrisme un horizon fermé où le poème tourne sur lui-même, absent à ce qui est, la proposition est d’une autre exigence, déplacée dans une dimension où on habite le langage, pour le traverser en le dénudant comme le ferait la philosophie hors systèmes. Ce premier ensemble est le plus court, et ses huit textes n’ont pas de titres, contrairement à ceux qui suivent. Une autre citation, dans le corps de la première page, reprend la pensée de Jacques Dupin sur le « risque absolu » qui doit être celui de l’écriture « sans point d’ancrage » mais pas étrangère à la mort, à ce « volubilis de la mort ».
Pas de titres mais l’espace, le blanc, qui fait de certains mots des îles : ainsi dit-il, ainsi encore, ainsi écrire, ainsi, cela, celle, ce blanc, alors, / et à ce prix, écrire hors. Répétitions : ainsi, écrire, blanc… Dans l’écriture comme pour la lecture s’arrêter sur ces mots qui surnagent, séparés de la prose du poème, pour poser un constat, et se dire à soi-même que c’est cela, écrire, « cette marche qui défie le vide ». Îles, oui, si écrire c’est affronter « le retour inéluctable au même point d’incertitude ». Être en écriture « comme est le naufragé, seul à nager ».
Pierre du vent, associer ces mots dans ce titre rapproche le plus dense, le minéral, au plus léger, insaisissable. Plusieurs sens possibles. Le subtil vent peut être parfois, un mur, dur, contre lequel lutter. Mais quand on écrit il peut figurer le silence des mots, une absence, un vide de sens, comme une pierre fermée. Cependant un texte donne d’autres clés. Le vent serait, gardant sa nature d’élément ondoyant, fuyant, l’image de cette « langue perdue dans les brumes de la mémoire ». Celle qu’on sait hanter l’inconscient d’un langage personnel, fait malgré tout des mots de la langue commune, mais transmués, car écrire franchit la surface des significations apparentes. Il faut extirper d’une profondeur insondable ce qu’à la fois on sait et ne sait pas, « caché au fond de son silence sous sa dalle de pierre ».
Dans le désir d’écrire, il y a celui de cette « parole perdue, peut-être retrouvée ». Peut-être… Incertitude fondatrice car n’annulant pas le « risque absolu » su par Jacques Dupin et Michel Diaz. L’entreprise d’écrire, ainsi, va au-delà de l’intention de créer, qui est aussi une conséquence du voisinage avec le « volubilis de la mort », cette image de l’exergue. La mort est plurielle, présente dans « la nostalgie ardente d’un futur sans promesse », dans l’effacement ou l’émergence du souvenir des « territoires de l’enfance », qui convoque la nature et la beauté mais aussi « douleur » ou « solitude ». Paradoxale, la nostalgie d’un futur qui n’est pas encore. Ou pas, si on entend le regret de ne pas toujours pouvoir ne rien attendre de ce qui sera. Mais nostalgie révélatrice d’un retournement du temps. La mort est un passé, par « la confuse réminiscence du lieu de l’avant-naître ». Avant-naître… Je pense immédiatement à un titre, énigmatique, Le visage d’avant ma naissance, l’autobiographie d’un Anglais, Llewellyn Vaughan-Lee (La Table ronde), initié par une soufie russe, Irina Tweedie, itinéraire changeant son rapport à lui-même, à la notion d’identité, et son rapport au temps. Je pense aussi à Plotin, pour qui l’âme a la nostalgie du lieu d’avant son incarnation, la terre vécue comme un exil (et le titre d’un texte, plus loin, est terre d’exil). Serait-ce le même, pour Michel Diaz, cet « exil dans la présence au monde » ? Ou au contraire un appel « pour vivre plus vivant » ? Ou l’oscillation, peut-être, l’alternance entre deux aspirations, deux blessures qui peuvent aussi cohabiter. Mais cet « avant-naître » est aussi un temps d’avant tout langage, dont l’évocation permet de rejoindre la capacité « d’écrire hors de soi ». Écrire, et « apprendre à désécrire », pour, d’un côté inscrire « ce rien sans nom », de l’autre « donner vie à ce tout qui n’est pas ».
La deuxième partie, la plus ample, Sous l’étoile du jour, a pour exergues les citations de Frank Venaille et Saint-Pol-Roux. Ou le double sens de l’entreprise (marche et écriture) : déchiffrer soi (« me connaître », dit Frank Venaille), déchiffrer le monde, cette « catastrophe tranquille » qu’est l’univers, d’après Saint-Pol-Roux… Possible transfiguration du réel par l’écriture.
Mais cela commence par la parole d’exil, où on peut penser que se mêlent plusieurs déchirures, dans « cet arrachement d’où l’on vient », mais où Plotin n’est pas loin, dans la tension vers un « ailleurs » d’une présence fracturée, tournée vers « la face d’un ciel » qui ne répond pas. L’étoile, qui guide, est « orientée vers l’aire de sa cendre ». Encore la mort, même si c’est le feu venu de la lumière. Et métaphore commencée de ce qui suivra, quatre textes plus loin, évocation de « ceux qui vivent sous la cendre », parmi les souffrants pour qui écrire.
Exil, aussi, que vivre dans « un monde désaxé habillé d’imposture ». Dès le premier texte il y avait la mention d’une avancée « dans le livre de son exil ». Cela revient dans le texte l’homme qui marche. Puis mention de « ceux qui passent » (…) « déjà passés » : éphémères humains. Lui passe, choisit « l’errance » et « les errants ». Mais cette errance trouve une magnificence par le regard porté sur « l’innombrable des visages ».
Il est à l’écoute d’autrui et de qui est rencontré, choses ou gens (« cet inconnu »), et même d’un ange « dans son improbable présence », ou le temps et le monde.
Ce parcours d’errance passe par la douleur des ténèbres du monde, par l’accueil de l’énigme qu’est le vivant, et la magie que le regard saisit de la lumière, de la douceur de l’herbe ou de « la splendeur d’un champ de tournesols ».
L’écriture… Elle advient par la remontée des mots de cette « langue perdue », par l’acceptation d’une « ignorance de tout » comme une sorte d’absolu de non-savoir qui fait revenir à la source de ce qui est à dire : « ce qu’il sait, c’est qu’il ne sait rein, mais qu’il lui faut l’écrire, pour personne, le vent ou les pierres ». Et de la « nudité première » qu’il avait nommée (de « l’air et la peau ») il fait une opération d’effacement pour faire advenir cet « écrire hors », jusqu’à « enfouir son visage et ses yeux dans le sable du temps broyé ». Cette sorte de transe révèle un bord limite de ce que peut être le « risque absolu » d’écrire. Et elle a un témoin, un pareil : l’arbre. Lui aussi sait une « ivresse ascendante ». L’écriture puise « dans le noir interne du front ». Dans les douleurs et tristesses « d’une impartageable consolation » le poème s’écrit « au bord de l’abîme ».
Le silence est aussi celui d’un ciel vide de dieux. Alors ne compte que la « terre des hommes », sur laquelle s’étendre, et « ce qui est là ». Reste le choix de « ne pas se résoudre à ce lent crépuscule qui tombe sur le monde ». Vie et mort s’accordent dans la conscience et le poète est « sentinelle », qui va, semant « quelques signes ». Mais la sentinelle dressée sur le bord d’un chemin, c’est un arbre. Tronc, écorce, racines, feuilles, branches. Poète et arbre « de même chair vivante ». Or on retrouve autrement l’étoile du titre, ce signe d’espoir devant les ténèbres du monde. Par l’arbre. Jacques Tassin, pour ouvrir son livre, Penser comme un arbre, a mis en exergue cette phrase de Saint-Exupéry : « Planté dans la terre par ses racines, planté dans les astres par ses branchages, il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous. ». Intuition forte de Michel Diaz, avec le choix d’un titre qui trouve un prolongement dans des textes où l’arbre est magnifié, d’étoile à étoile. À la fin du recueil, la sentinelle, ce très beau texte qui dit la fusion entre le passant, poète, et l’arbre, porte le même message que l’ouvrage du chercheur écologue. (Qui d’ailleurs cite beaucoup les poètes : Hugo, Verhaeren, Baudelaire, Bonnefoy… et rappelle la pensée de Bachelard : « Vivre comme un arbre ! Quel accroissement ! Quelle profondeur ! Quelle rectitude ! Quelle vérité ! »). Le message commun est de cesser d’oublier les arbres, d’arrêter, dit Michel Diaz, « l’ignorance de l’ingratitude ». Arbre, encore, je n’ai pu que penser à un autre écho. Car en quelque sorte les poèmes transmettent ce qu’on apprend des arbres, si on s’en approche, les regarde, les touche. Et Mario Mercier, dans une approche qui est celle de la culture des chamans, a écrit un ouvrage consacré à l’arbre, L’Enseignement de l’arbre-maître (Albin Michel). Ne pas voir là un obscurantisme irrationnel. Cette culture, Jean Malaurie en témoigna dans ses Mémoires, De la pierre à l’âme (Terre humaine). Ainsi la poésie fait accéder à une connaissance que d’autres saisissent autrement, par la science ou l’initiation. La poésie et la marche, ou la poésie dans et par la marche, si on comprend la démarche de Michel Diaz.
Dans le dernier texte, juste après le poème la sentinelle, un texte titré il se fait tard à l’horloge du monde. Les étoiles, un arbre dans la nuit, un chien qui aboie. Ses aboiements renvoient « vers le lointain » les déchirures du monde évoquées dans le livre, et comme une prière à la nuit, une litanie chantant ce qui n’a pas eu lieu, et les traces « d’une joie humble » (…) « opiniâtrement espérée ». L’arbre résistait, le poète aussi, pour « ne pas se résoudre »… Et il crée, retrouvant les paroles du « secret perdu », dispersées par les vents.
Recension © Marie-Claude San Juan
LIENS
Page Rosa canina…
L’invention des couleurs
Isabelle Lévesque-Pierre Dhainaut
Editions L’Ail des ours, collection Coquelicot (2024)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 91 (automne 2024).
Deux voix, en communion, se partagent l’espace de ce livre, celles d’Isabelle Lévesque (qui l’illustre de ses photos) et de Pierre Dhainaut (qui ont déjà signé ensemble quelques autres ouvrages ; La grande année, L’herbe qui tremble, 2018 ; La troisième voix, id., 2023). Les poèmes de Pierre Dhainaut, sous la forme de deux quatrains, occupent seuls la première section, intitulée Les cinq saisons (mars, juin, septembre, décembre, mars), alors que la seconde, Carnets de voyage, nous donne alternativement à lire, sous une forme plus libre, se répondant les uns aux autres, les poèmes des deux poètes.
Plaie béante, l’écorce a la forme / d’un cœur à l’arrêt, d’un visage / abattu par le vent d’hiver, d’un poing / qui se resserre une fois pour toutes […]. Ce sont les premiers mots de Pierre Dhainaut, qui ouvrent le recueil, et Le ciel est un ogre blême, ceux d’Isabelle Lévesque, qui le closent. On pourrait y voir, du secret de la blessure, ourlée de mousse bienveillante, à la dévoration de l’espace laiteux du ciel, comme un mouvement d’expansion (j’oserais dire une dilatation des sens) où se diluent notre conscience au monde et notre élan vers cet impossible poème que nos lèvres ne sauront jamais prononcer, quand les nuages frôlent l’apparence trompeuse, / dispersent les mots du poème. Mouvement de cela qui, ramené au jour et même dérobé, confisqué par sa trop grande lumière, vient déranger ce monde où l’on sait, croit savoir, fait semblant de savoir. Cela, qui toujours nous échappe, se métamorphosant en quelque chose d’autre, imprévu et surprise, dans l’impermanence de tout ce qui est. En dépit de nos incurables incertitudes et de de toutes nos inquiétudes.
J’ouvre les yeux, le soleil éclaboussé de neige / se lève, dit l’une, et l’autre : tout reste / avec le ciel à découvrir, c’est-à-dire / à toucher dans la respiration : / nuages, oiseaux… Et c’est bien ce qui touche dans la lecture de ces textes où l’écriture est l’expérience du regard. On y rencontre des mots qui sont un regard, qui sortent du noir en cherchant des yeux, qui voudraient voir ce qu’ils disent, et dire ce qu’on voit. Au point du jour, au bord du monde… / nous prenons le droit de parler ainsi, ici, / le seuil s’éveille à l’instant, à l’attente, écrit Pierre Dhainaut, et plus loin, Isabelle Lévesque, un mot pour tant de silence, verbe pourpre / étoilé du sanglot qui délivre l’hiver. Dans cette parole à voix basse, qui se fraie un chemin dans le réel du monde, on entend battre de l’humain en perpétuel devenir. Il y a là, dans ces mots, des textes qui ne sont pas dans les mots, bien qu’il n’y ait pas de texte sans mots. Ce sont les textes qui nous invitent à voir et écouter en même temps, les sons prenant plaisir à miroiter, ces sons du vent dans les feuilles des arbres, des mots qui ont toujours ici un ton qui ne nous trompe pas. Celui d’une écriture poétique qui nous mène au plus loin, vers un là-bas qui est aussi ce qui vient, cette promesse dans la clarté où la nuit s’enracine. La nuit, écrit Pierre Dhainaut, qui ne sera de retour que sous un nom nouveau. La nuit dont je ne connais pas le nom, lui répond Isabelle Lévesque, différent / chaque matin. / Les voyelles changent, avancent / le nom neuf. Et c’est ce « nom neuf », cette promesse d’éclaircie sans origine, sans réponse, vivante plus que nous, qui cherche à donner corps et présence à ce qui, près de nous, veille et demeure, patient, presque invisible, accordé à notre désir de lumière.
Aussi, nous disent les poètes, il ne nous faut pas redouter l’inconnu, puisque le visible est plein de parfums, mais surtout de couleurs dont la divine assemblée nous aide à contenir l’assaut de l’existence. Laquelle des couleurs, se demande Pierre Dhainaut, accueille ou recrée le mieux la lumière ? Et Isabelle Lévesque de nous dire, quelques pages plus loin : Lis le blanc, sur la lisière : il trace / la frontière entre mars & avril. […] // A chaque instant, cette lumière / nous traverse. Les pétales blancs / portent des indices : apparition & disparition / pour inverser le miracle. Car au seuil du jour, révélant les couleurs, voici qu’une lueur franchit la nuit, frôle nos lèvres, se pose sur notre visage, feu instable qui éclaire mains et paupières, invente douceurs, halètements, sourires, feu savoureux d’amour qui saigne entre blessures de l’aube et morsures des ombres. Au matin prononcé se poursuit le poème, puisque le jour renaît comme doit revenir l’écriture, jardin qui offre au jour des mouvements d’iris, des balancements de coquelicots, quand le monde se concentre pout réciter l’énigme ancienne, ce qui n’attend pas, ce qui s’enfuit et que les mots doivent tenter de dire, de retenir un peu, à défaut de sauver.
Progresser, chaque jour, dans l’incertitude et dans l’ignorance pour rejoindre ses sources : ainsi pourrions-nous résumer la démarche poétique de Pierre Dhainaut qui n’est pas exempte d’angoisse, mais dont le chemin vers le « non-savoir », c’est-à-dire l’effacement progressif du « je » qui favorisera l’avènement de la « voix », celle qui monte de la terre avec le souffle des sources, celle qui renaît des herbes emmêlées, se confond avec la parole des arbres, la respiration du bleu infini, et accueille un autre silence, un silence qui n’aurait d’autre beauté à célébrer que ce que nous aimons au ras du sol, et l’exubérance des fleurs : la fleur du cap, la plus belle, la bruyère, / nous célébrerons sa couleur / dans le tumulte inassouvi des vents, des vagues, / sous un ciel parfaitement bleu. Aller alors vers plus de pauvreté (et nous entendons Rilke ici), dans le dépouillement de soi-même, de tout son superflu, pour pouvoir s’étonner encore que la bruyère ne cesse de fleurir, que le ciel de mars se colore, se remplisse du chant des grives. Entendre ce que dit ce chant : tout prend fin, mais tout ressuscite, / l’espoir dans le matin est le matin. Et toujours la sagesse du jour qui se rappelle les passages empruntés il y a bien longtemps, dans les temps d’innocence, qui se rappelle que la fleur inventée, la fleur présente, c’est elle qui devance les poèmes, ce qu’on dira d’eux, dont les vibrations des syllabes confondront le hasard de vivre avec celui de mourir.
Quant aux poèmes d’Isabelle Lévesque, ils détiennent aussi une part de mystère que l’auteure partage avec son compagnon d’écriture comme avec le lecteur, et qui renvoient à une expérience sensible du monde, aussi bien mentale que physique, qui invite nos yeux à chercher dans le temps la place de là-bas dans le présent d’ici, pour aussitôt en faire un souvenir : La montagne élève sa forteresse de lumière, / je la regarde pour que chante la mémoire / (enfant je glissais sur ces pentes). // La neige, la merveille sur ma manche. S’y lit une complicité intime qui lie la neige, le nuage, le givre du matin, l’arbre immobile qui danse rouge au ciel, le vent d’Armor, les coquelicots qu’il disperse, la lumière pure du silence, les fleurs et leur murmure bleu, tout cela, l’air ou l’or qui, dans le poème, se répondent, et créent un nouvel ordre dont le sillage intact unit les regards. On trouve la même expérience synesthésique chez ces deux auteurs où, comme dans le poème Correspondances, de Baudelaire, « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Expérience qui invite à vivre parmi les choses les plus simples de ce monde, comme à vivre entre les étoiles et vivre entre les mots,
Au lecteur-promeneur d’emprunter la voix/voie des auteurs, leurs routes, leurs regards. A lui, à nous, de glaner dans ces textes ces éclats de conscience fertiles, souvenirs, impressions, semence de pensée, et dans le fatras du temps qui passe ou qui ne passe pas, à lui, à nous, d’avancer sur les rives imparfaites, de franchir le seuil de cette maison où il n’est pas aisé de vivre, et d’accueillir aussi les ombres. Avec bienveillance et humilité.
Michel Diaz, 05/08/2024