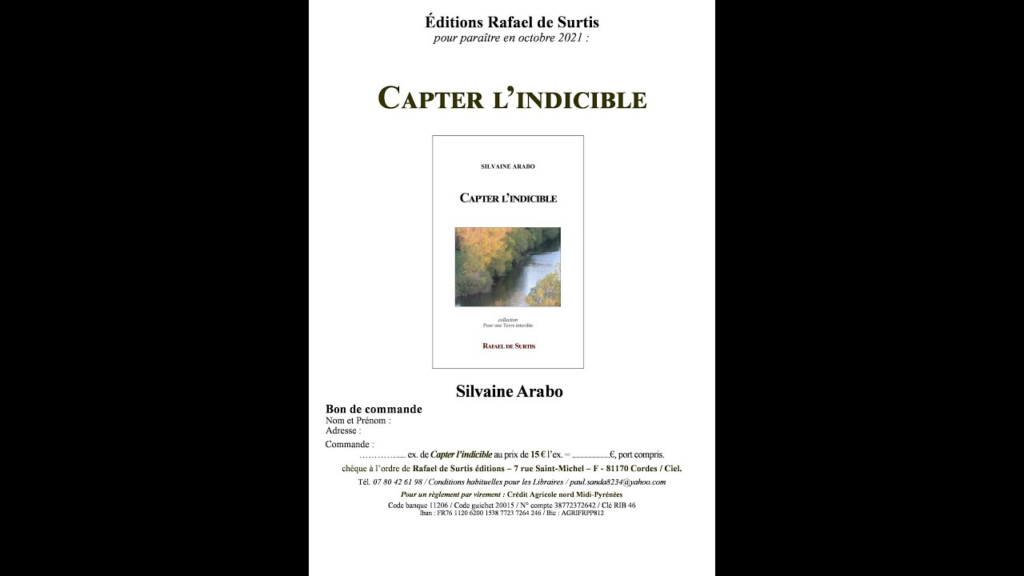
Capter l’indicible
Silvaine Arabo
Editions Rafael de Surtis, 2021
Chronique publiée in ce blog (mars 2022) et in Chemins de traverse N° 61, décembre 2022
Un concerto en bleu majeur
Souscrivons sans réserve à ce qu’écrit si justement Gilles Lades à propos de Capter l’indicible de Silvaine Arabo : « Ce livre prend pleinement le parti lyrique, un lyrisme mystique où la vie multiple, invisible, s’accomplit. Ici la beauté concrète se mêle à l’imaginal du cœur, espace exaltant et libre où s’unissent vertus et splendeurs. » (Diérèse n° 83) Dans ce recueil, en effet, l’adhésion aux beautés du monde devient célébration ardente de ce tout qui est, comme devient révélation cette poésie qui la porte et qui se nourrit si intimement, si naturellement serait-on tenté de dire, du spirituel. Et Gilles Lades ajoute, dès la phrase suivante : « Cette résolution suprême est musicale, hymne à la beauté. » (Ibid)
Musicale, sans aucun doute, et langue accomplie de poète est cette parole inspirée dont une tenace force intérieure (même si traversée parfois par les ombres du doute et « les oscillations du désarroi »), nous invite, page après page, à sentir à l’intérieur une joie qui délire.
Musicale, oui, mais aussi picturale. Car Silvaine Arabo, poète, est également peintre. Le sachant, ayant eu l’occasion de regarder ses toiles et ses encres, il nous est difficile, dans le cadre de cet article, de n’être pas tenté, en ne privilégiant que cette seule piste de lecture du recueil, celle des références aux couleurs (au détriment de toutes autres qui nous permettraient d’entrer plus avant dans l’analyse de ces textes, d’approcher un peu plus la densité de la démarche et la réflexion qu’elle développe en essayant d’en explorer toutes les dimensions), il nous est difficile donc de n’être pas tenté de jeter quelques passerelles entre les œuvres de l’artiste et les textes de cette auteure. Entre les mots de la poète et les images qu’ils suscitent, et celles purement plastiques de la peintre qui use concrètement des couleurs. Mais prenons-en le risque. En effet, sur l’espace des pages où Silvaine Arabo dépose un à un ses poèmes, les couleurs, même si diversement convoquées par la langue, sont omniprésentes, et d’entre elles le bleu émerge, insistant comme fait le bruit bas du cœur, infuse et se diffuse, se répand, se dilue et fait auréole.
Il y a certes, dans ces poèmes, le noir, métaphore (prometteuse pourtant comme celle qui suit) de l’enfermement muet des moissons hivernales, et la nudité de nuit des oiseaux cachés, le sombre marécage que l’on reconnaît au silence absolu de ses colombes, des tunnels de silence, et tous ces jours où l’être avance dans les sombres labyrinthes, sur ce fond d’inquiétude et d’hésitation vacillante inhérente au fait même de vivre, dans l’incertain du temps de notre destinée, entre le poids de nos questions et les ombres qui nous menacent.
Il nous faut pourtant franchir la nuit, les ombres de nos disparus, les lignes vacillantes de nos peurs, de nos souvenirs douloureux. Car en dépit de nos errances dans les couloirs obscurs du temps, du couteau pâle de la souffrance et des pâles solitudes entre des portes qui grincent, la nuit est riche, dans son obscurité même, du jour qu’elle promet et engendre. Et s’il y a aussi la nuit par-delà les tombeaux, nous avons ici la grande nuit scintillante et lunaire, attisée par les pâles images que nous cultivons, et la lumière faible de la lune sur les grands portiques, le sourire des lampes, les pâleurs d’aube et les clartés pâles / D’oiseaux souterrains, la timide clarté des étoiles lointaines ou celle, pâle aussi de la lumière du jour / Comme si c’était demain / Le dernier matin du monde.
Et il y a le blanc, non celui que l’on dit, qui est affrontement du poète au blanc initial de la page, à ce vide absolu où gît tout l’inconnu, ni celui de la mort, ni hostile ni bienveillante, mais d’abord celui qui fait apparaître ce qui s’y trouve enclos, caché au fond de son silence, bouche clouée, témoin sans forme ni contour d’une langue perdue dans les brumes de la mémoire, mais langue dont nous conservons la douloureuse nostalgie, celle, la même qui nourrit et ne peut se nourrir que de la nostalgie ardente du futur, sa mémoire éprouvée dans la chair, ces mêmes territoires, purs instants qu’investit l’enfance en ses jardins d’autrefois, les arbres en prière, la vie-dans-la-beauté ou bien, peut-être, la confuse réminiscence du lieu de l’avant-naître, jardin perdu ou souvenir diaphane des eaux-mères, trace indicible de la déchirure originelle, de la prime blessure d’une irréparable séparation. Et de tout ce encore, douleur et nudité, solitude et brûlure d’être dans l’adhésion au monde et ravissement extatique dans sa présence, le souvenir de ces beautés perdues et retrouvées, ciels salubres, éclats de la lumière, pureté de la montagne, du torrent, de la pierre nue au soleil et au vent, qui réclame d’écrire hors de soi, adossé au mur, fourbissant ses désirs de plus haute vie, en quête toujours de ces grands déserts blancs. Le blanc, échelle enneigée des ailes ivres. Celui des grands oiseaux qui te font chavirer, des neiges scintillantes et des cristaux du givre. Bancheur nue des chrysanthèmes et vagues des blancheurs / Dans la peinture naïve des yeux enfantins. Evocation de plénitude sont ces mystérieux accords blanches orgues du cœur et le chant vrai des blanches eaux, les grands cygnes blancs / Dans une épure, les Blancheurs vagues aspirant à la forme et Ce chemin qui crisse / – Si blanc sous les pas du destin… Toutes ces mains filant le destin du silence / (…) De blancheur en blancheur et cette extase redonnée du blanc. Territoire d’accord essentiel avec l’intime du vivant, paix et joie confondus dans le grand océan cosmique, mais territoire de la poésie, pays très haut / De ces plateaux de neige / Où bourdonnent les ruches blanches, où peut librement s’exalter cette pure blancheur des mains // Qui ne veulent plus redescendre.
Comme il y a aussi le vert et sa jubilation parmi les feuilles, ces calmes cohues d’arbres et l’exaltation folle du vert parmi les feuilles, cette couleur de toute renaissance, celle du printemps qui frappe à nos portes, annonçant la bonne nouvelle, quand la Vie se révèle, portée par le souffle, réanimant ce qu’on croyait ou qui pensait mourir. Alors nous entendrons sous les verdeurs / L’essaim qui bourdonne, avec des yeux doux comme la mer / Nous regarderons de nouveau les feuilles / bruire au soleil sous les doigts invisibles du vent, et abandonnés à son souffle nous pourrons capter l’indicible.
Comme il y a encore, dans les degrés de couleur, cette aube qui n’est rien / Que n’enfante derrière le soleil / Un autre soleil, cela qui nous invite à fixer la lumière les yeux dans les yeux. Une aube qui coule s’écoule lumineux vertige, lumière aux reflets miroitants, qui dénoue le visage de gel de la terre, tremble dans l’air / Dans la tiédeur des feuilles, vibrant comme une fièvre. Et fusent ces images qui évoquent les efflorescences de la lumière, les tourterelles et les sphynx d’or de la mémoire retrouvée, leur explosion secrète de couleurs, les scintillants oiseaux et Le baume du feu, la bulle dorée de l’univers, les dieux beaux / Carrés dans le soleil, les étés flamboyants au cœur de midi, la beauté des pierres ignées d’où jaillit la lumière, l’éclatement soudain du rire / Dans l’embrasement suprême, quand sous tes paupières mûrissent les champs d’or du soleil, et cette lumière où l’on nage, approchant les cîmes dorées de la plus haute exigence, puisque dans les matins réinventés de l’espace / L’or agit l’or est mouvant.
Mais le bleu !
Contre ceux qui, absurdes ne connaissent / Que la musique de l’absurde, et qui jamais ne pourront dire l’âpreté crue du bleu, il est, dans cet ouvrage, la couleur qui émane du cœur des choses, comme si elle en était l’essence, ce qui nous donne à voir, dans la fluidité de sa transparence, le monde dans le processus de transfiguration où doit s’accomplir le regard. Dans la pure conscience d’être et dans son essentiel. Couleur de toute élévation vers l’infini, au plus près du songe des plus hauts oiseaux, note unique et arcane mystérieux, espace symbolique de la rêverie vers lequel l’âme prend son élan. Elle apparaît d’ailleurs dès le premier vers du recueil : Trésorière de la lumière dans l’ombre bleue des soirs (p. 11). Contentons-nous de citer quelques occurrences dans lesquelles le bleu intervient, parmi la trentaine d’autres que contiennent les textes (chiffre incomplet si l’on en exclut les multiples connotations) :
– Prélude aux grandes saisons nacrées / Fugue bleue des jours (p. 12)
– Je te pressens aux grands pics bleus que tu inventes (p. 16)
– On dirait une flamme bleue sur les sables / Là où la mer tendrement s’éteint (p. 18)
– Ici dans cette profondeur bleue tout est signe (p. 23)
– Une grande prière monte et se creuse / Une flottaison d’ondes dans les ombres bleues du soir (p. 38)
– La facture incroyable et bleue du ciel (p. 41)
– Les branches bleues de Van Gogh / Effleurent l’albâtre des cavaliers passants ((p. 43)
– Agenouillement silencieux / Dans l’eau bleue du temps / Je reconnaîtrai les signes / Tiges de la beauté (p. 58)
– Nous irons / Par les sommets bleus du soir / Dans l’ordre ancien des jours / Redessiner l’aura lumineuse / Des temps en allés (p. 62)
– Sur les tempes bleues du temps / Dans l’éclaboussement nu des paupières / Une crête d’aurore nous submergea (p. 67)
Dans le bleu, il y a de grands fils jetés d’un bord à l’autre de la voix. Des fils tramés dans la matière de ces soifs qui se lèvent au creux des bouches, les consolant, comme un défroissé de silence, un expir suspendu, mots posés au fond de la gorge, retenus sur le seuil des lèvres. Toute lenteur et toute paix y sont promises. Tout abandon et tout oubli. Paix et joie confondus écrivions-nous plus haut, car il n’y a que dans le bleu, son éphémère et éthérée substance, que l’on peut tout oublier – même soi – / Devenir / La mémoire des choses, des êtres, du silence / De ces étranges vibrations colorées / Qui traversent l’espace / Pour le nourrir. Car c’est dans le bleu seulement, dans sa transparence et sa fluidité, qu’il est possible que de la psalmodie des cendres /Renaisse un oiseau léger. De vivre d’une vie véritable, dans l’accordance vraie avec les êtres et les choses. Dans le courage d’être.
Dimension principalement verticale du bleu, car il est trait d’union entre deux mondes, le terrestre et celui de l’espace spirituel, les cîmes bleutées des montagnes et la soie lisse d’un ciel supérieur où cœur et esprit se retrempent. « Mais pour cela, écrit Luc-André Sagne, il faut au préalable savoir se détacher de ce qui nous assaille quotidiennement, de ce trop-plein qui nous submerge, de cette laideur qui se nourrit d’elle-même. » Dénouer les sortilèges de la cacophonie, s’extraire des grandes mégapoles qui croulent, se garder de tous ceux qui, à force de dire le mal / A force d’imaginer la ténèbre et sa puanteur / La libèrent. « C’est à cette condition, ajoute Luc-André Sagne, qu’on peut espérer, sinon atteindre, du moins s’approcher de la sublime transparence (…) absence d’épaisseur, pur regard, souffle qui est comme la première étape, le grand signe au bout du chemin vers l’indicible. »
Lisant ces poèmes de Silvaine Arabo, nous sommes inévitablement traversés par le souvenir de ces vers de Baudelaire dans Elévation où le poète, s’élevant lui aussi vers des sommets splendides, dans cette lumière où l’on nage, évolue « au-dessus des étangs, au-dessus des vallées / Des montagnes, des bois, des nuages, des mers », et poursuit par ces mots : « Mon esprit, tu te meus avec agilité, / Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde, / Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde / Avec une indicible et mâle volupté ».
Chemin de crête est le poème, tant que l’on marche, sans esprit de retour, sans la crainte d’une fin et d’un abîme dont on ignore tout, car dans la présence du monde on n’est jamais seul : L’univers est en toi / Entends, ami, entends / Le chant suprême des Transparents ! La lumière que Silvaine Arabo nous invite à partager dans ses poèmes est d’abord lumière intérieure et, avec la maturité de son art, lumière faite souffle à l’intérieur de notre cœur battant et infini. Sa poésie est chant de toute présence / De toute lumière projetée, et c’est en quoi, en cette époque crépusculaire que nous traversons elle nous apparaît, jaillissant comme l’arbre / Sur fond de flûtes et de hautbois, comme une parole essentielle de réconciliation, dans le sens étymologique de ce terme, avec cette part de nous-mêmes que nous disputent les poulies grinçantes du temps.
Michel Diaz, Île de Ré, 09/03/2022