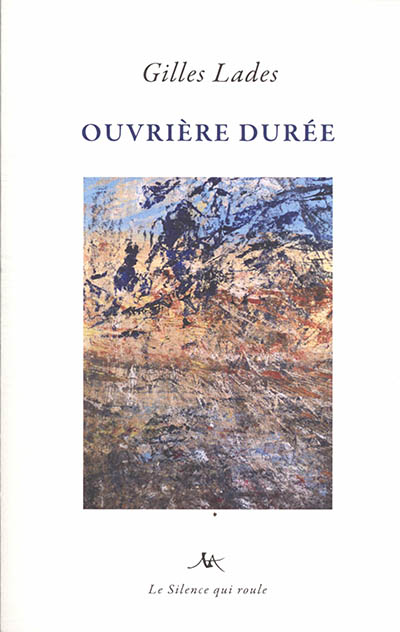
Ouvrière durée, Gilles Lades – éditions Le Silence qui roule (2021)
Lecture par Michel Diaz, in ce blog (mai 2021) et in Terres de femmes , mai 2022
Ce récent opus de Gilles Lades, Ouvrière durée, est composée de cinq sections :I. Du profond de soi ; II. Une brassée de chemins ; III. Reflets de ciel et d’eau ; IV. Des mots dans les mains ; V. Personnes. Et sans doute y voit-on déjà quel mouvement l’anime.
J’emploie le terme « composé » au sens musical de ce terme, car cet ouvrage (qui n’est pas un simple recueil de textes mais un livre pensé et conçu comme un tout rigoureusement charpenté), nous offre l’exigence d’une partition musicale : exposé d’un thème initial qui sera décliné en multiples variations, repris, développé selon des tonalités différentes, variations aussi de rythmes ou d’harmonies, variations encore de tempos et de couleurs de voix que soulignent la disposition typographique des vers et l’ordonnancement des strophes…
Le recueil, qui s’ouvre donc par Du profond de soi, titre on ne peut plus évocateur, commence par un poème qui nous donne d’emblée le premier thème du recueil : L’âge / en ce jour / crispe le cœur // que reste-t-il / chez les morts et les vivants / de tes refus de tes sarcasmes de ta fuite / de ton élan fermé ? Question introductive en forme de bilan de ce qu’a laissé une vie qui marche désormais sur la pente plus raide des jours, ces jours-là / frappés d’inutile, et s’avance à voix grave comme sonneraient les premières mesures d’un De profundis, ou comme sonneraient aussi les mots d’un Memento mori, portés en des vers courts par un sourd, sombre et lent largo qui ne peut que nous poindre le cœur.
Et comment en serait-il autrement, à l’heure de cet âge humain devant lequel l’Abîme se promet, puisque le poème qui suit ne peut que constater : A l’aube / une peur s’empare du sang / le dernier rêve s’enfuit / comme l’oiseau de la ruine noire, que l’angoisse continue de vriller son cristal de glace / de percer les volets / d’entrouvrir la mémoire / sur la lumière opaque.
Question frappée du sentiment de la précarité existentielle, que le poète ne pourra que retourner dans tous les sens, partagé entre crainte, impuissance et détresse devant l’inéluctable qui s’annonce et dresse son mur d’ombre. Heure incertaine, comme l’on dit de celle « d’entre chien et loup », révolte vaine où sombre toute certitude : tu ne sais plus ce qui se décide / du chêne qui va mourir ou de celui qui, vert, triomphe / alors que les sonnailles sont toute la vie / et qu’un cri d’homme hésite entre appel et colère. Indécision d’autant plus grande qu’aujourd’hui / la pendule seule / inépuisée / guide ton souffle et ton pas.
Ces mots sont ceux que dictent l’expérience de la perte, l’assèchement de l’être, la tentation de l’abandon peut-être, ceux de la douleur abrasive et désespérante du temps, Pourtant, lit-on aussi, dans les mêmes pages, comme les contredisant aussitôt : Le corps refuse / l’abandon / au temps profond / comme la mer sans vagues / mais animée d’une vie de pâte à pain / d’un souffle sûr d’élargir son aire /aux limites mêmes de sa force. Ainsi se traduit, en une inversion positive, le passage de la perte à un flux intérieur que le poète, loin d’y renoncer, travaille à restaurer puisque, écrit-il encore, bien sûr les vergers / sont assiégés de friches rancunières / bien sûr le jardin est au fond d’escaliers / tranchants comme des lames // mais ta parole / un jour a valu d’être dite / et tu veux qu’elle reste vive / comme un vin avide d’air et de lumière.
Dès les premiers poèmes du recueil apparaissent donc les éléments du deuxième thème qui seront développés dans la section suivante, Une brassée de chemins. Ces chemins, ce sont ceux qui s’ouvraient, intracés encore et obscurs, sous les pas de celui qui, jeune homme, cherchait à survivre dans le printemps désert, souvenir d’un lointain lui-même à qui s’adresse le poète : un poème parfois /bouge en toi comme un arbre / pantelant d’orages. Souvenir de cet âge où, à la fourche des chemins, s’ouvraient tous les possibles et où la vie s’offrait comme l’unique risque à prendre : Jeune j’étais / à la pointe de la course et du cri // prêt à sombrer dans la ravine / à la moindre mégarde // je suivais les pistes les plus âpres / ignorant si le terme était le but / ou quelque borne aléatoire. Nulle nostalgie cependant, chez l’auteur, ni regret des chemins qu’il n’aura pas su ni voulu emprunter, car si je n’avais qu’un chemin / le sang de la hâte // ce temps-là reste vrai / comme un interminable printemps.
Ces pages posent là, non souvenirs revisités, mais éléments d’une géographie qui ont nourri la rêverie de ses errances, balisé ses chemins de vie, tout ce qui a entretenu autant son rapport au monde et aux choses que contribué à créer son espace intérieur : arbres nus et lointains horizons, murets de vieilles pierres qui servent à parquer les bêtes, bois, clairières, villages, hautes herbes sèches, créneaux de roche et de feuillage… Tous ces fragments de paysage, ces recoins d’enfance, comme ces gestes qui reviennent, dans ces textes, témoigner de cette traversée nocturne des années qu’est la si lente quête de soi-même, de ce travail de terrassier et de carrier qu’est l’écriture poétique quand elle cherche à déboucher à l’air libre.
Certes, puisque comme toujours, plus que jamais, la mort menace, que la vie désormais n’est plus que ce trop peu, devant, que lui accorderont encore les années, tu devras maintenant, écrit Gilles Lades, chercher ton chemin / à la lumière de lampes frêles // tâtonner vers le son de l’âme / en attendant que le bleu d’avril se reforme, Mais bien que la lumière s’apprête à nous quitter, il faut pourtant encore, et sans relâche, travailler à faire histoire avec l’esprit du lieu / et se nouer à l’ouvrage insatiable des heures. Poursuivre, sans relâche, pour demeurer vivant, la tâche de célébration des beautés de la nature et du monde. Poursuivre, jusqu’en ses extrêmes limites et ressources du corps et de l’esprit, ce qui fonde la justification de cette « ouvrière durée ». Conserver, jusqu’au bout, ce regard de ferveur première comme ressource d’espérance qui permet si le malheur / pose un pied large devant toi de regarder vers la fenêtre, d’ouvrir toutes les fenêtres / dans le profond et le lointain, et d’imaginer un instant / les poignées du blé céleste / crissant de sauvegarde aux angles de la nuit.
C’est dans la troisième section du recueil, Reflets de ciel et d’eau, située au centre exact de l’ouvrage, comme en un cœur battant où s’apaisent les dissonances, que le poète opère la synthèse des deux premiers thèmes dont nous avons parlé. Ni abandon à la douleur de la séparation ni résignation amère à la perte, mais démarche d’acceptation sereine (que l’on devine lentement conquise sur soi-même), qui tâche d’épouser toujours le simple bonheur d’exister. Ou se tourne vers quelque ineffable consolation dont le nom se dérobe à la langue de la raison et ne prend tout son sens que dans nos intimes prières: là-haut dans les croisées la solution suprême / la lumière presque oubliée / jusqu’à soi venue / méritée sans savoir / comme un battant de cachot / poussé sur la totale liberté.
Le titre de cette section, évocateur en son image de la musique de Debussy et de sa poétique, nous laisse deviner sans peine dans quel creuset lyrique se mêleront, s’y confondant, les accents de la pure mélancolie (celle, sombre sans doute mais active, de la rêverie où puise l’inspiration créatrice, au plus près de la vérité profonde de l’être, de ses tourments, et de ses mystères enfouis), et l’émerveillement devant les manifestations de la beauté du monde, fussent-elles les plus humbles, comme celle de cet arbuste aux fleurs rouges / (qui) te sidère d’extase. Comme celle de ce rouge-gorge dont l’art est de surgir des buissons de brume / et de vibrer de vie.
Lisant aussi ces vers, tu crains que le couchant / ne renonce à l’aurore / pour s’être couché dans la nuit, on ne peut que reprendre les mots de Gérard Paris, écrits à propos d’un autre texte (Témoins de fortune) mais qui épousent au plus juste notre réflexion : « Entre vie et mort, l’homme dissident, portant la marque d’une écorchure n’a pour seuls viatiques que le frémissement de tout et le souffle donné, et se trouve face à un dilemme : l’exil ou la présence. De l’attente à la splendeur, du tranchant de lumière au glissement de l’ombre tout s’unit dans l’absence et se défait dans les bleus replis de l’inconnu. » A quoi Gilles Lades semble répondre ici : pourquoi dire encore je / alors qu’il s’agit d’aller le long d’arbres / et d’atteindre un toit sombre / à mi-chemin de l’adieu.
Annoncé par quelques réflexions semées ici et là dans les précédentes parties, le troisième thème de ce recueil, celui de l’écriture poétique, occupe la section intitulée Des mots dans les mains. Et s’y pose d’emblée la question du poème, ce qui se passe dans le for intérieur du poète, de la nécessité de ce qui cherche à advenir, avant même que son chant ne prenne forme, dans ce blanc vierge de l’attente, et ce blanc néant du silence qui toujours inquiète la voix qui a su trouver les mots pour l’écrire :Poème pressenti / par l’émotion à goût de fer / un soir si plein de tous les morts enfin réconciliés // (…) si souvent tu t’es cru déserté de parole / de la sonorité tout à part soi / que tu tressailles à la nouveauté / un instant vierge de mots.
Mais chez Gilles Lades, comme chez tout authentique poète, il n’est qu’un chemin / celui du mot / germé comme un safran d’un été de fournaise. Un germe étrange qui nous sauve. Et il écrit encore, à propos des paroles qui donnent chair à ce qui dérobe encore à la pleine conscience : leur chant se risque / comme un pas / enivré d’une ronde. Car la poésie de Gilles Lades, depuis l’âge premier / où chaque lettre éveillait une phrase / dont on ne voyait pas la raison, est aussi poésie dans laquelle le poème, fagot de hâte, est expérience où la parole se risque vers ce qu’elle ignore de ce que se tient devant et qui la tire toujours plus avant. C’est là aussi, pour ce qui le concerne, une mise en rapport avec l’inconnu, avec ce qui disparaît dans son apparaître, avec l’instant quand il est ce qui coupe. Instant qui est également ce qui, comme l’aube est déchirure qui renouvelle, prise et déprise. Instant de grâce, qui cherche à s’emparer du vif / ailes battantes sauvagine, dont il faut conserver intacte la trace de l’imprévu surgissement, mais qui ne saurait s’épargner le lent travail de mise en forme du poème, puisqu’il s’agit d’abord de défricher un peu d’espace et de temps / pour qu’y lève le chant. Alors, le poème attendra / que l’œil vienne vingt fois ranimer les ratures / les maintienne en constante lumière.
Pour Gille Lades, le travail d’écriture est travail d’une force qui vient d’ailleurs, d’avant le poème et que le poème ne parviendra pas à limiter. Cette force, attentive à la beauté du monde et à la présence des êtres, est ce qui le sauve des tourments que l’on sent constamment à l’œuvre en arrière-fond de ses textes, comme ceux qui ouvraient ce recueil, ces ombres qui ne peuvent que peser sur nos nuques humaines, puisque marcher attendre voir / se chevauchent sans but // et qu’être se perd parmi le dérisoire.
Le recueil s’achève sur la si émouvante section intitulée Personnes. Employé au pluriel, le mot désigne ceux, ces quelques-uns, que croise encore le poète dans les rues ou sur la place des villages, et ceux, absents, chers disparus dont le souvenir, à demi-effacé, du visage et du timbre usé de la voix (ou le silence de leur bouche close), viennent hanter ces pages, ombres furtives comme sont les fantômes sur les photos qui raniment des braises de mémoire : Photos / condamnées aux tiroirs // photos d’où monte un sourire / qui devient nôtre.
Mais nous citions plus haut ces vers dans lesquels le poète s’interrogeait sur la nécessité de dire encore « je ». Et c’est alors le pronom indéfini « personne » qui transparaît dans le mot-titre puisque privés, au long des ans, de ceux que nous avons aimés, le monde se dépeuple, que l’heure est froide comme pierre, même si la pluie donne / un reste de soleil. Le « tu » vocatif, le double du poète, si souvent invoqué dans ces pages, a laissé place au « il », mais suffisamment tenu à distance pour n’être plus que l’homme, figure dirait-on dissoute du poète qui ne semble plus qu’aspirer à se fondre dans cet anonymat : l’homme assis ne sait plus / quelle piste l’appelle / quels arbres / le consoleront d’abeilles. Et même encore si l’ancien temps résiste / comme un pont bombardé, même s’il continue, ayant presque tout épuisé des chemins d’attente et de désir, d’aimer le poids du jour / et sa couleur jamais la même, et même si ses mots pourtant vivent toujours / à la manière des moineaux / venus en foule à la fenêtre, « l’homme » semble accepter de quitter la scène des jours, comme l’on marche à reculons, sans savoir si sa maison conservera la lumière / qu’il a fermée derrière lui,.
S’effacer lentement de la scène du monde, ayant fait de douleur et joie ses complices, alors que le souffle errant de la forêt se pose sur la peau, que l’on croit encore pouvoir se nourrir d’éternel / à la moindre douceur de ciel, est-ce cela que l’on désigne par le mot par ailleurs si mal employé de « sagesse » ?
Mais laissons Gilles Lades répondre lui-même, avec ses propres mots : « Aujourd’hui, l’Ouvrière durée est un temps de patience qui ne veut pas se devancer, qui accepte et reçoit le poème comme le cadeau d’un jour de plus, qui nous bâtit autant que nous l’inventons. Le passé revient, tamisé de sagesse, le visage (le sien propre et tous les autres) n’en finit pas de s’approcher et la voix, la juste voix, est plus que jamais traquée, au secret des pas, au hasard des haltes. Alors que défile la splendeur du monde, sublime routine, indéfinie redécouverte. »
Michel Diaz, 25/06/2021