Texte pour une vidéo de Pierre Fuentes (exposition « Autour de nous », galerie Lyeux fertiles, Tours, 21-22 avril 2018).
Pour voir cette vidéo, le mot de passe est: video1errance
Fragments d’une errance
s’est-on assez nourri l’esprit pour survivre qu’on aura tenu son pari, pas si stupide ni insensé s’il nous a permis de franchir, les yeux ouverts, l’espace de ce temps qui nous est attribué sans mesure, dans un arbitraire qui à creuser la part de l’inconnu, son unique question, en fait pour une bonne part l’inestimable prix
on avance, ne laissant nulle empreinte, sur un chemin de feuilles, d’odeurs, de froissements, allant seul, sans feu ni fin, foulant la terre obscure, errant parmi les herbes délaissées, les ramas de branchages morts, dans l’improvisation de la trace et la scintillation du souvenir
en vérité, notre mémoire est plus ancienne que nous-mêmes, feuilleté d’innombrables couches de temps entrelacés, et il nous faut la convoquer pour pouvoir parler de l’instant
en effet, à l’image de ce que nous dit Héraclite, on peut chercher l’évanescence de ce qui se passe dans l’immobilité du temps, mais le nécessaire retour aux essences par la remémoration ne va pas sans quelques questions qui réclament une traque lointaine:
la mémoire est-elle autre chose qu’un acte d’imagination volontaire ? le souvenir est-il reconstitution du passé ? ce passé composé de la mémoire, de fictions et de rêves ?
quoi qu’il en soit de ces réminiscences, on devine qu’elles nous construisent puis nous transmuent en ruines,
des ruines sur lesquelles on marche, comme on le fait parmi les rues des villes dévastées, de celles divisées, mais où l’errance poétique, arpentant de sombres décombres ou se nourrissant des décors de la guerre, y trouve les ressources d’y tirer les éléments sur lesquels bâtir une esthétique de l’imaginaire
mais dans imaginaire, il y a images, évidentes et mystérieuses, mouvements invisibles, imprévisibles et migrants, mis à jour et meurtris dans leur saisissement, comme autant de miroirs qui nous brisent, de corps qui se dissolvent, non dans la brume, mais comme celle-ci se tord en boucles floues et lentes, déchirant leur blancheur aux ramures grises des arbres,
et il ne nous faut, pour les susciter, qu’accepter de se perdre dans son regard, comme l’on accepte de suivre son ombre qui s’avère une exploratrice plus assidue que l’être qui lui est attaché
on regarde alors ces images, sans craindre qu’elles nous transforment en statues de sel ou de pierre, ni qu’elles disparaissent, nous laissant nus et seuls face à la faille du silence, et démunis face au néant
c’est ainsi que se met en branle le travail du regard, que les yeux s’abandonnent et se fardent de désespoir, comme pour mieux valoriser l’essentiel du regard poétique, et simultanément arrachent l’ombre à la préhistoire de son langage, en allant, pour cela, où le regard ne porte pas
ainsi peut-on faire céder l’inaccessible, ou tout du moins tâcher de le transformer en étoile guidant le chemin, en le scrutant jusqu’au plus loin, jusqu’à ce que les yeux s’en détachent et poursuivent seuls l’ascension, car vision et aveuglement sont ici les faces jumelles de ce même chemin
mais pour être fructueuse, l’errance doit faire route en compagnie de la mélancolie, ni tristesse ni nostalgie, mais « mélancolie créatrice », qui n’a rien à voir avec les ténèbres, mais tout avec l’obscur
et c’est là, peut-être, le seul moyen de fouiller les cavernes les plus secrètes et les plus profondes de la mémoire, aux prises avec ce qui, en même temps, lui donne sens et la prive de sens, seule manière de retisser la relation avec tout le perdu
pour cela, les images se doivent de nous faire signe avant de se faire sens, et devenues passage d’un temps suspendu, tenter d’appréhender cet intervalle irréductible entre parole et territoire comme entre vision et regard, ou mémoire et oubli, offert comme une halte à la mélancolie et ouvert à l’accueil de la blessure originelle, seulement accessible à qui a répondu à l’appel silencieux des signes
simultanément, alors, se fait jour le sentiment que tout devient, ou redevient possible, au cœur même de la déroute
aussi, dans une nuit qui s’épaissit, n’est pas encore devenue ténèbres, à travers les régions indéterminées de la quête, les yeux tâtonnent vers leur source et ne fonctionnent plus qu’au souvenir, au plus loin de lui-même, en-deçà de toute mémoire, celui que laissent sur les lèvres les échos lointains d’une langue oubliée,
ou celui que déposent, au verso du regard, les éclats de lumière sur la pierre d’un mur sur lequel se sont imprimées, dans les glyphes de leurs lichens et leurs hiéroglyphes de mousses, les premières images d’un monde que nous avions perdu
Michel Diaz, 01/04/2018
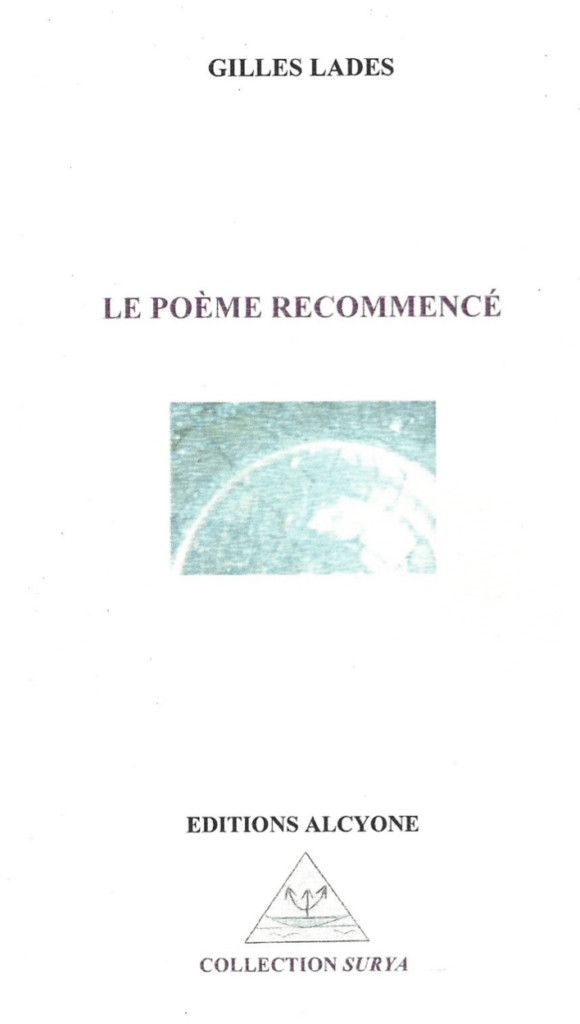 Le poème recommencé – Gilles Lades
Le poème recommencé – Gilles Lades



