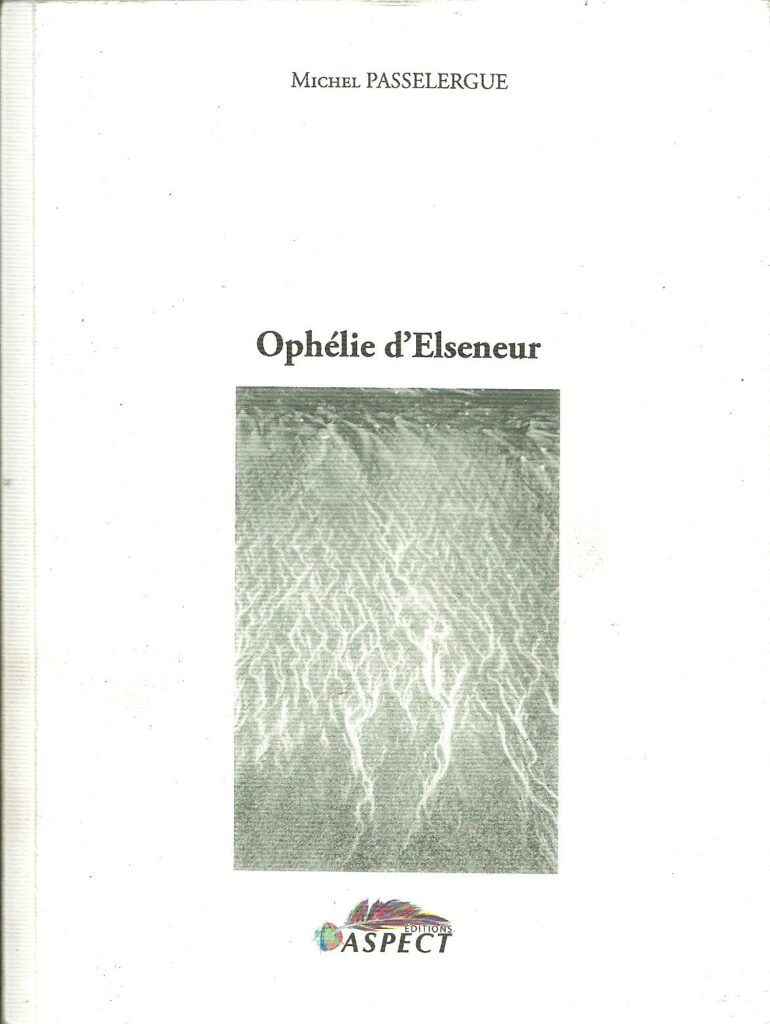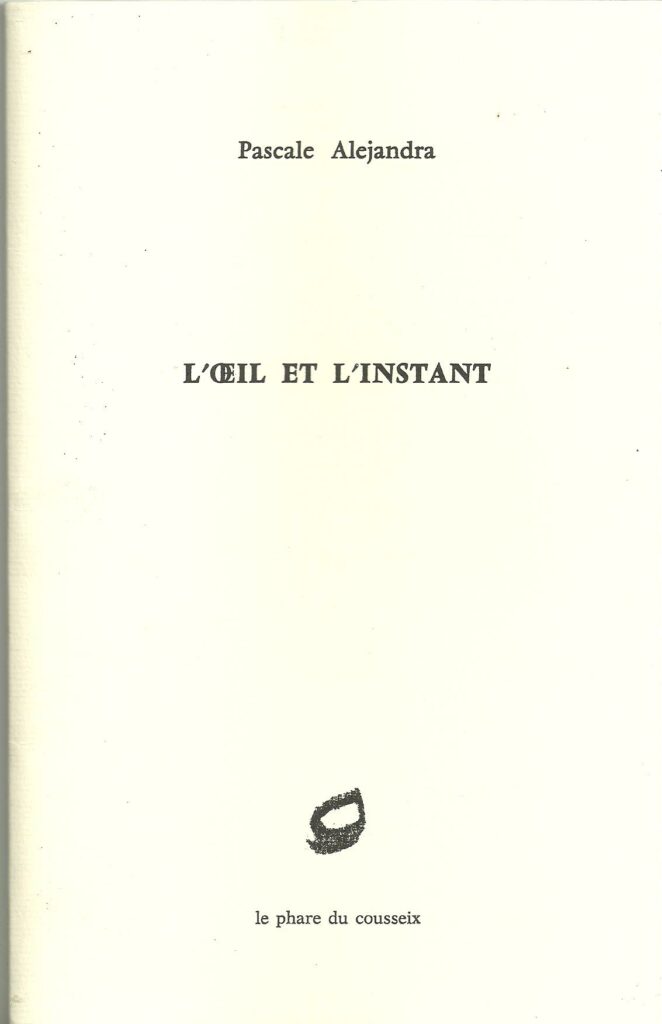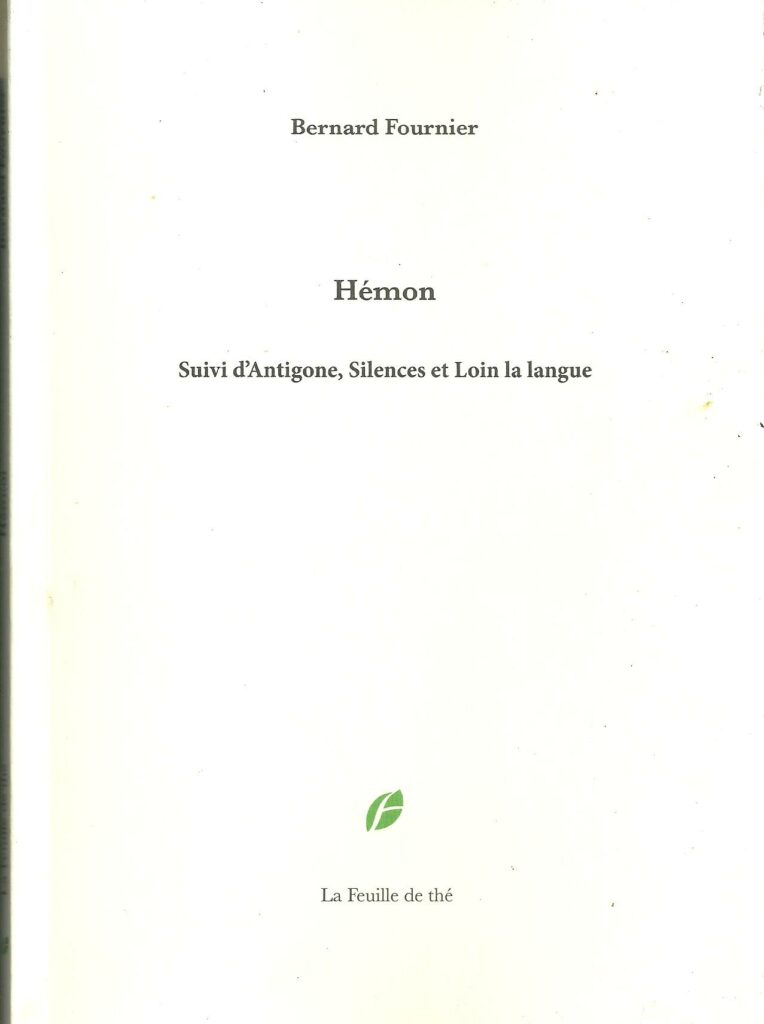
Hémon, suivi d’Antigone, Silences et Loin la langue
Bernard Fournier
Editions La Feuille de thé (2019)
Chronique publiée dans Diérèse N° 78, printemps-été 2020
Hémon, Antigone, Créon, Ismène, Œdipe, les dieux… Bernard Fournier conserve dans son texte, sous forme de récitatif (oui, ce texte semble écrit pour être proféré sur une scène de théâtre, pour être déclamé, crié à gorge déchirée, modulé en paroles accusatrices, assourdi en plaintes funèbres, murmuré à voix basse et secrète, aux marges du silence, et il me semble de la même veine poétique, sombre de la clarté aveuglante et terrible qui, soudain, nous accule à quelque immémoriale vérité, aussi bouleversants que le sont les plus saisissants des monologues shakespeariens), B. Fournier conserve donc l’arrière-fond de cette histoire dont Sophocle a fait sa tragédie : c’est en allant à l’encontre des traditions que Créon bouleverse l’ordre des choses. Il garde l’âme d’un mort chez les vivants en ne lui rendant pas les derniers hommages et fait mourir une femme dont l’heure n’était pas venue, empiétant ainsi sur le rôle des dieux et enclenchant le mécanisme de cette « machine infernale » si l’on reprend ici les mots d’un titre de Cocteau. Créon et Antigone, couple duel, partagent la même fierté orgueilleuse et sans compromis qui les pousse tous deux dans leur obstination, leur solitude et leur certitude, faisant d’eux de purs héros.
Mais ce texte est celui d’un procès, ainsi l’avons-nous lu. De tous les autres protagonistes de la tragédie, Hémon est celui que B. Fournier choisit d’isoler sur le proscenium ou de conduire seul à la barre des accusés, les autres n’étant plus que ceux par rapport auxquels il se définit. La pleine lumière l’éclaire, et il a droit à ce « moment de gloire » qui, pendant quelque temps, fait d’un homme banal un être singulier. A lui de porter sur les épaules, lourde tâche, la médiocrité ordinaire des hommes, celle à laquelle certains d’entre eux tâchent pourtant de résister et contre laquelle ils se battent pour essayer de vivre un peu plus haut qu’eux-mêmes.
Qui est Hémon ? Quel homme est-il pour que l’on se donne la peine de le mettre face à lui-même ? Voilà ce que nous en dit B. Fournier, au fil des pages : Hémon dit oui / Pour mieux s’échapper dans le vent // Hémon n’est qu’un enfant. Mais s’il n’est qu’un enfant, c’est-à-dire un être encore immature et irresponsable, il ne crie pas, ne pleure pas / Il sait qu’Antigone doit mourir. Mais même s’il croit et espère qu’il relèvera Antigone, qu’il pense que ce n’est pas trop tard, il a peur, il est lâche, / Hémon n’est pas un homme / Ni un héros, et il pleure aussi sur lui, sur son âme seule. Il a peur, de cette peur qui troue le ventre et le laisse pantois,/ Peur devant cette femme si forte et qui lui échappe. Hémon a peur de l’avenir, peur du noir, peur de la solitude. Si Antigone meurt, que fera-t-il de lui-même, de sa vie ? Hémon a peur parce qu’il ne comprend pas / Hémon a peur pour sa vie / (…) Il ne veut pas affronter l’obscurité de la grotte, car il veut chanter dans les chemins fleuris / Il veut marcher dans les aubes fraîches / Il veut aimer au-devant des montagnes boisées, et il pense qu’il n’est pas responsable de son père. Mais si on ne peut empêcher une femme qui veut mourir, si on ne peut rien faire contre la mort, et s’il n’a rien choisi, il ne tentera rien pour sauver la femme qu’il aime, parce qu’il connaît cette faible volonté qui ne décide de la place, ni des ombres, ni des muscles. Et s’il s’étonne qu’il puisse être le fils de cet homme d’église et de prières, / Fils d’un roi puissant de savoirs, de sagesse et de livres, il ne se dressera pas contre lui et n’osera pas affronter cette autorité, ce ventre / gonflé du pouvoir, bardé de ceintures aussi fortes que ses certitudes. Hémon laissera Antigone aller à sa mort. Il la laissera y aller, même si, maintenant, il connaît la marche dans l’ombre / Il connaît la révolte / Il connaît le savoir / Il connaît la parole à proférer devant les hommes // Il connaît la science des couleurs et celle des sentiments / Il connaît le goût des larmes et des regrets, des remords, // l’obstination des âmes vers la mort. Certes, Hémon se met en colère, de la colère des héros et de la colère des hommes qui souffrent devant le ciel / Qui remue les montagnes et fait dévier les fleuves, mais même s’il foule aux pieds une partie de lui-même, s’il crie, s’arrache les cheveux et pleure la face au ciel pour calmer son courroux (…) /, il ne sait pas, il ne sait plus contre qui s’adresse cette colère / Contre les dieux, bien sûr, / Contre son père et les dieux / Contre le père d’Antigone, contre tous les pères, contre tous les dieux / Contre le pouvoir des pères / Contre le pouvoir. Et seul sur la montagne, sur le promontoire au-devant des villes fumantes / Il jette sa colère au vent, au ciel, et surtout aux dieux. Autrement dit, de sa colère, il ne fera rien d’autre qu’un brasier de gestes et de cris, ne se heurtera pas aux ordres de son père, mais pleurera sur lui, sur son âme seule, et il laissera Antigone affronter les ombres de la mort. Car s’il sait maintenant comment il faut vivre / Il sait vers quelle croix de chemin on peut hésiter et on ne peut que lui dire : Crie, Hémon, crie à travers temps, crie ce que tu n’as pas fait / Crie ton impuissance, ta pusillanimité, ta lâcheté / Crie ton manque d’amour, crie ton envie de vivre. Et, un peu plus loin encore, ces mots : Hémon, pourquoi as-tu déjà oublié Antigone ? / Déjà tu penses à quelque autre, déjà tu trahis : / Tu pleurais donc faux ?
La colère de Hémon n’est pas colère de la rébellion, ce n’est pas celle d’Antigone, elle est bien plutôt le passage obligé vers l’abandon à la résignation et à la soumission, celle qui, détournant son objet vers d’autres cibles que les véritables, s’aveugle d’elle-même, tourne en révolte vaine et dévoyée. Hémon n’est que victime de lui-même et de sa lâcheté. A lire cependant le texte de B. Fournier, on le devine bon garçon, sensible, intelligent, peu querelleur, un « brave type » comme on dit, qui aurait fait un bon époux, à coup sûr un bon père. Mais il n’est rien que désespérément « normal », conforme absolument à ce que les règles sociales et leurs conventions, à ce que la morale établie et les lois en usage, le respect de l’autorité, les sanctions prévues pour leur manquement, attendent de tout « bon citoyen ».
Hémon n’a rien d’un « homme révolté », et il n’est pas déplacé, dans l’approche de ce texte, de prolonger notre réflexion en faisant appel à Albert Camus pour en circonscrire un peu mieux les enjeux. « Qu’est-ce qu’un homme révolté ? » se demande Camus. « Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. » D’apparence, il existe une limite à la révolte. Cependant, la révolte est un droit. Elle naît de la perte de la patience devant toute autorité abusive et injustement exercée. Elle est un mouvement et se situe donc dans l’agir, se définit par le « Tout ou Rien », le « Tous ou personne ». Si, en premier, elle soumet l’idée d’égalité, position d’égal à égal entre le maître et l’esclave, ou le tyran et son sujet, ou un père injuste et son fils, le révolté finit par imposer cette égalité (qui se traduit souvent par une inversion des rôles). Mais, si l’on suit aussi le raisonnement de Sheler, l’homme révolté n’est pas « l’homme du ressentiment », c’est-à-dire qu’il ne baigne ni dans la haine ni dans le mépris, car la révolte enfante des valeurs. De fait, écrit encore Camus, « pour être homme, l’homme doit se révolter ». C’est la révolte qui extirpe l’homme de sa solitude puisqu’elle est collective, qu’elle est « l’aventure de tous ». Légitime donc, selon le philosophe, elle est l’expression la plus pure de la liberté et semble revêtir le visage de l’espoir puisque aussi, pour reprendre ces mots à Rimbaud, le révolté « veut changer la vie ». Hémon, lui, à cette liberté (le plus souvent chèrement payée, doit-on le rappeler ?) préfère le confort de la tyrannie et de la servitude, en tout cas celle de la soumission à l’autorité paternelle, le refuge dans les plaisirs que lui promet la vie.
Dans cette (re)lecture qu’il nous propose du mythe d’Antigone, B. Fournier actualise nombre de questions qui se posent, à nous, à nos contemporains, hommes d’aujourd’hui en butte à des réalités d’ordre politique ou social, à des décisions de pouvoir, reflets d’une démocratie malade qui ne sait que mater les troubles de rues par la force, mais questions qui apportent la preuve, si besoin en est, que la relecture des mythes qui nous ont été laissés en héritage nous demeure un outil d’indispensable réflexion.
Dans l’esprit où nous avons choisi d’aborder ce premier texte, Hémon, il y a cohérence parfaite dans cet ouvrage de B. Fournier avec sa troisième partie, intitulée Silences, dont alors les mots nous semblent baignés d’une plus éclairante lumière : J’écoute les paroles inédites / retenues au fond des gorges / quand elles ne crèvent pas / de la sécheresse des hommes. Ces mots-là aussi auraient pu être adressés à Hémon : Je me demande quel est ce choc / de mots contre l’armure des hommes. Ou ceux-là encore : Qui me dira où vont les paroles tues / tenues, retenues ? // Existe-t-il un cimetière pour les phrases inachevées ? /Les non-dits ont-ils un recueil, un lieu où se recueillir ? / Sait-on quelles fleurs elles auraient pu faire naître ? Et ceux-là aussi bien : J’interroge l’homme / j’interroge son silence, sa misère / J’interroge les dieux aussi qui ont laissé faire (…) // J’interroge le silence / pour voir à travers l’espace et à travers la lumière / une photo absente.
Mais nous sommes là dans une autre problématique, celle ici du silence qu’interroge la parole poétique et celle de son impuissance, dit-on, à « changer la vie » : J’interroge l’homme / fort, plein d’assurance / qui impose le silence / même aux oiseaux, même au ciel, / même à la lumière qui siffle aux mufles des bêtes / et qui vient trancher les mots dans les limbes des lèvres. Pourtant, écrit Alain Duault, la poésie « livre des combats comme ceux que Van Gogh livrait à la lumière. Elle nous parle de nous ou d’un autre qui doute de nous. Elle n’aspire qu’à tendre à chacun une lame pour fouiller encore cette chair ancienne qui tremble ». Mais entre paroles et silences, se tenant à l’orée des unes et des autres, B. Fournier remplit son rôle de guetteur, se défiant de celles-ci pour mieux tendre l’oreille à ceux-là, pour redonner parole de silence « habité », aux siens, depuis la mort où ils se tiennent, à ceux qui n’avaient pour parler que ce silence qui fait trembler la lèvre / qui persiste dans l’affolement du cœur / qui persiste et se tait, s’éteint / dans la transparence de la lumière. Guetteur « crépusculaire » aussi est le poète, dans sa quête orpailleuse, qui interroge les yeux qui parlent (…) / Ces yeux de silence qui pleurent au moment de parler / dont la lumière peu à peu s’éteint / à l’orée de la parole. C’est, sans doute pour un poète, un apprentissage précieux que celui du silence, pas seulement celui qui lui permet de redonner aux mots leur pleine densité, mais encore celui qui lui donne à entendre ce qu’ils disent quand ils se taisent, comme on se taisait dans les chambres, se souvient-il, dans les chaumières, où il n’était pas de veillées, pas de contes, pas d’histoires. Où le passé n’existait pas non plus, puisque pas d’aïeux, / pas de leçons, / pas de morale : // Seul un pays mystérieux / réduit aux repas et aux jeux. Ainsi, écrit-il, Mon père m’a appris le silence, / pas la parole, / ni même sa langue // Langue d’oc qui pourtant chante / comme lui chantait parfois.
Comment alors, se demande B. Fournier, affronter le monde avec pour seul bagage / son silence ? / Comment entrer chez les hommes / sans paroles ? / Comment s’approcher des ombres / sans crier gare ? // Pas de mots, / pas de livres, / pas de guide. Et nous revient cette phrase de René Char : « Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n’est pas le silence ». Non, puisque Soudain le grand père parle / Dans son silence, il parle / depuis sa mort, il ne cesse de parler / il parle avec abondance / sans dire un mot.
Suivent au fil des pages, se poursuivant dans Loin la langue, cette interrogation sur le silence et sur cette langue d’enfance, non transmise, étrange, étrangère, singulière (…) / révélant des tindouls, des avens, des puits secs et cassants / Des mondes telluriques, des monstres chtoniens, langue d’oc, rivière amaigrie, à peine survivante dans son lit de rocailles. Loin cette langue, écrit l’auteur, Ma langue étrangère, ma langue défendue / à jamais obsolète, prise dans les fougères / retenue par les chênes, tenue par la rivière. Langue volée, nous confie-t-il un peu plus loin, cette langue hors de moi, ma langue interdite / ma langue moins qu’un étendard, plus qu’un oubli. Alors surgissent ces questions : Quelle est ma langue ? Quelle est cette langue ? / Quel est cet idiome qui m’est étranger / qu’on ne m’a pas transmis ? Alors nous vient aussi, à travers la parole d’un autre, l’étrange et mystérieuse nostalgie de la langue perdue, celle que nous tous avons oubliée, en entrant en pays de langage, la parole d’avant les mots, d’en-deçà de toute mémoire, et dont la poésie cherche à réveiller l’abandon. A ramener aussi quelques images, brins d’existence comme de langue, langue silencieuse, langue muette / Langue qui ne dit rien que le silence, mais bribes ultimes que le poète chercherait ici à sauver, comme dans un effort de tout l’être, de ce désastre de la perte et du définitif oubli. Soit des miettes, des touches, des fragments de choses vues et entendues, autant de choses que l’on peut dire quand on revient par la mémoire aux contrées de l’enfance, que l’on remonte du « ravin » ces réminiscences tirées d’un temps mort à jamais, comme de l’oubli et du silence.
Et cette nostalgie de la langue première, celle des temps d’avant toute conscience, celle dont tout un chacun, par le fait même qu’il en a perdu l’innocence, peut se sentir dépossédé, c’est, dans les pages de ce livre, un murmure que l’on entend, quelque chose de rasant, une lumière de bas de porte, mais qui insiste et trouve à passer, à faire encore danser la poussière des souvenirs. Un chuchotis endurant, cette musique même de l’âme quand elle défroisse ses plis sous les souffles des mots que ces textes à la transparence profonde nous offrent en partage.
Michel Diaz, 06/01/2020