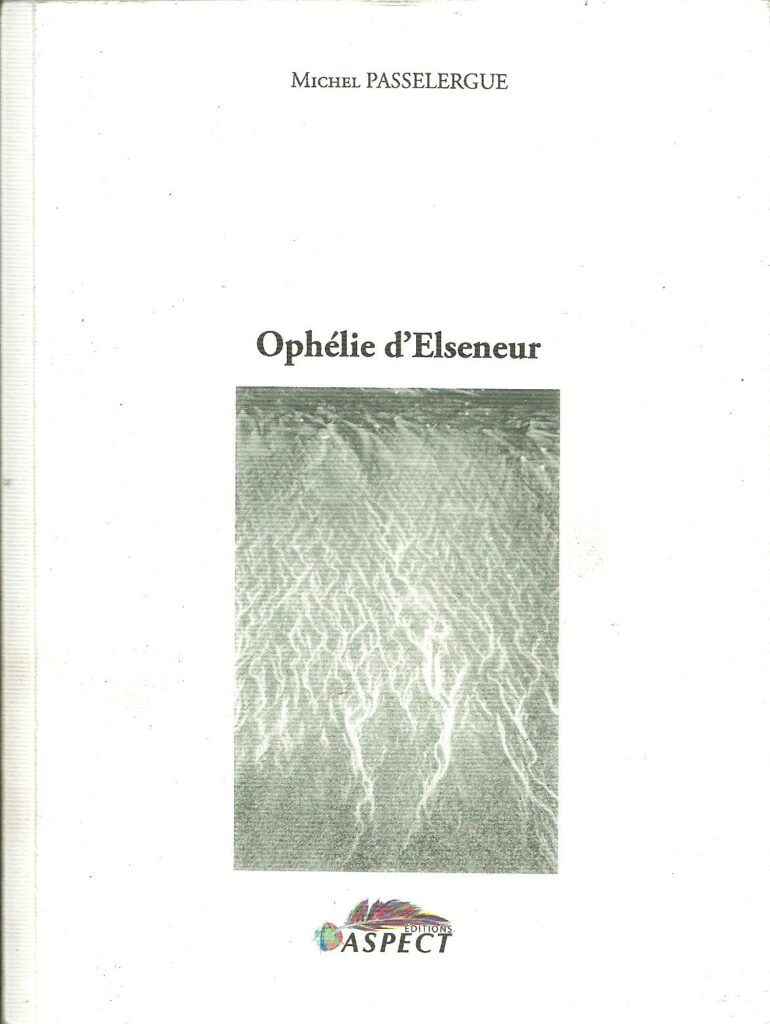
OPHÉLIE D’ELSENEUR
Michel Passelergue
Éditions Aspects (2019)
Chronique publiée dans Diérèse N° 78, printemps-été 2020
« Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles / La blanche Ophélia flotte comme un grand lys… » Ces deux vers de Rimbaud, que l’auteur place en exergue à son livre, et qui ouvrent en nous les abîmes de la rêverie mélancolique, pourraient d’abord nous apparaître comme l’un des points possibles d’appui sur lequel s’exerce l’imaginaire de Michel Passelergue dans son appropriation toute personnelle du mythe d’Ophélie. Ils suffiraient peut-être, si l’on en juge un peu hâtivement, à éclairer, sinon à justifier son cheminement poétique de tant d’années partagées entre silence et solitude, d’autant que, écrit-il, ces textes se lisent comme le journal d’une vie qu’on dirait imaginaire et qui m’appartiendrait à peine. Mélancolie de soleil noir et de lune livide, poèmes d’infinie détresse où nous plonge la perte de tout être aimé (réel ou fantasmé, qu’importe !), parole où tout le désespoir s’ouvre entre les mots. Mais parole fervente aussi sont ces lents poèmes arrachés au chaos, ce thrène sans fin jailli au tréfonds du désir. Puisque encore, écrit le poète à l’absente, Vous enfiévrez, à distance. Je divague, j’évoque, cristallise des orages. Dans la stupeur des vitres, des éboulis. (…) pour tisonner nos blessures, éparpiller un alphabet mal coagulé. Jusqu’à ne plus être, dans la nudité du dire, que celui qui violente braise et rocaille et fait rendre gorge à l’obscur.
« Cet ouvrage », nous dit la quatrième de couverture, « propose une recomposition cohérente d’un ensemble de textes écrits sur une période de plusieurs décennies et consacrés au personnage mythique d’Ophélie. » Plusieurs décennies, en effet, puisque, dans la quatrième partie (avant-dernière) du recueil, intitulé Florilège pour Ophélie, le premier poème est daté du 11 mars 1961 et le dernier du 8/10 août 1997. Mais M. Passelergue, depuis cette date, n’a pas pour autant abandonné son sujet puisque le cycle « Ophélie » s’est prolongé avec les Lettres d’Elseneur, 2008-2014 (Tensing, 2015), avec aussi Fragments nocturnes pour une chanson d’aube, 2015-2017 (Le Petit Pavé, 2018) et se poursuivra vraisemblablement, nous annonce-t-il, par Un roman pour Ophélie.
Outre ce Florilège, on trouve aussi dans cet ouvrage, Ophélie d’Elseneur, des poèmes en prose, Lettres à Ophélie et ces Lettres d’Elseneur, sections entre lesquelles l’auteur a inséré celle qui a pour titre Chansons pour Ophélie. Voilà donc ici rassemblés, écrit l’auteur, ces « textes disséminés au cours de quarante années, et qui sont autant de missives brûlantes ou énigmatiques. » Quarante années ? En vérité, près de soixante, si l’on veut être plus exact et si l’on se réfère à la date de publication du présent recueil.
Voilà donc une œuvre singulière, que l’on pourrait dire de « longue haleine » ou au « long cours ». Singulière par ce constant retour au même thème d’écriture comme par la variété des formes adoptées, mais plus compréhensible en cette « folie » (obsessionnellement « revisitée ») quand on constate que le sujet de ces textes (considéré isolément du reste de l’œuvre du poète, autant que nous puissions le faire !) nous apparaît comme le témoin d’un parcours poétique, et de son évolution stylistique-esthétique, témoin aussi d’une fidélité à ce qui fonde une œuvre en profondeur. Ici, cette figure féminine, amoureuse éternelle d’un amour éternellement malheureux, réciproquement partagé. Figure qui hante l’auteur, et que l’on ne peut s’empêcher de confondre avec cet insensé questionnement de ce, qu’avec la séparation des « eaux-mères originelles », nous avons définitivement perdu. Séparation dont la mémoire d’avant toute parole porte l’indélébile trace, laisse béante la blessure d’une irréparable nostalgie. Questionnement aussi, qui fonde toute quête poétique en sa géographie intime et par lequel, comme le dit Alain Duault, le poète est « aux aguets, il observe et creuse la nuit immémoriale, il tente d’écouter mieux, au-delà de la rumeur du monde, de donner des couleurs aux ombres, de dessiner des cartes pour avancer à tâtons dans notre obscurité-de-vivre. » Et, plus loin, il ajoute « Si la poésie a un sens, il faut le chercher dans tous ces feux qui brillent sur la mer de nos nuits. » Des feux dont M. Passelergue nous rend aussi bien compte en évoquant le personnage insaisissable d’Ophélie puisque, lui écrit-il, Je traquais l’obscur, hantais la profondeur et buvais votre clarté. Vous étiez l’éclair premier, assomption à vivre au plus près d’une langue d’eau pure.
Ces textes de M. Passelergue ne sont pas seulement nourris de, mais ils sont la matière même du rêve, ou de la rêverie active, dont il serait vain de tenter de saisir, sans courir le risque de la pervertir, ce qui en fait la vraie nature, fluide, volatile, fuyante, matière de brume et de songe, émergence d’images dans les replis du mi-sommeil, mots dormants délivrés à mi-voix, apparitions fantomatiques, croquis estompés, surexposant des silhouettes au négatif de mémoire. On peut éprouver quelque réticence à se livrer à une analyse plus intellectualisée de l’ouvrage quand les mots de l’auteur vivent si pleinement d’eux-mêmes dans l’espace onirique où leur musique se déploie : A peine extrait d’un sommeil pesant – sous les cendres, sous la poussière du temps – je vous entendais. Voix d’entre les eaux, vous filiez récits de vents nocturnes, fables et dictons, pour caresser le silence, écrits sous l’orage. Et comme un havre, esquif inquiet à l’ancre, ces cantiques éperdus, au mitant d’une âme ardente. Réticence d’autant plus légitime (pour ce qui me concerne) que ces textes demandent moins à être reçus comme un « discours » organisé autour d’un thème et construit en séquences qui, de l’une à l’autre, avancerait dans une démarche de progression, qu’à être reçus comme un ensemble de poèmes écrits sous l’effet d’impulsions, le désir du moment, ou les caprices de « l’inspiration », affrontant chaque fois leur part d’ombre et leur espace d’inconnu. Textes dont la lecture demande, me semble-t-il, à passer par le corps, par le réseau des nerfs et le vif des organes, dont les phrases, les variations de leur rythme, leurs heurts et leur respiration suivent les soubresauts, les baisses de tension et les soudains envols d’une écriture dont les mots sont à éprouver entre lèvres et dents, sur la chair de la langue, comme gorgées d’eau pure ou durs éclats de pierre, à prendre avec les battements du cœur, calmes ou plus désordonnés, et les difficiles poussées parfois de l’air dans la poitrine. Aussi ces bribes de paroles, adressées à celle qui se tient en pays de parole dissoute, peuvent-elles se lire littéralement dans n’importe quel ordre, presque dans tous les sens, comme le conseillait Rimbaud à sa mère à propos de ses vers, tant leur écriture est polyphonique et polysémique. Une vraie écriture de jubilation semée de joyaux poétiques, comme dans cette phrase, parmi tant d’autres dans ces pages brûlant d’images que frôle l’invisible : Je connaîtrais, dans le delta de vos paupières, le diamètre de la mort – la nôtre, en même harmonie d’être dans quelque lézarde du temps.
Car comment dire cette douloureuse obsession d’une intimité impossible à dévoiler, déchirée entre peine et jubilation sinon en faisant de la langue ce bouillonnement ou froissement discret où les mots qui se cherchent s’accouplent pour mieux se dissoudre en silence ? Eludant tout devenir, j’écrivais de mémoire, vivant l’instant profond. Et vous demeuriez, lointaine, énigme au bout de la langue. C’est pourquoi, écrit encore le poète, Mes lettres vous parviennent, mais enveloppées par le silence, réduites à de violentes convulsions de langue, à un chant lacéré, une ode perforée par toutes obliques du temps. Ainsi encore, écrit-il dans un autre texte, Chaque matin, je dénombre les failles, les écueils : lignes torses ou raturées, notes en marge, phrases sans issue. J’ouvre des blessures dans ce verbe anguleux, arrache encore quelques pages blanches à la nuit. Les ébauches se multiplient – et le poème peu à peu s’effrite. Car les mots ont durci, qui pouvaient transcrire au verso du sommeil nos plus lointaines rhapsodies entre la flamme et l’ombre. Ecriture de l’impossible dire, comme l’est toute poésie qui livre ses combats contre la nuit de la parole, « veut réveiller l’abandon, écarteler la langue obscure qui n’avoue pas, approcher la beauté, ce qu’elle a de fragile » (Alain Duault). Et M. Passelergue semble ajouter ces mots à cette réflexion : Dans la fureur de mots indomptés, je m’acharnais à donner voix à tel matin en amont du désir, comme au hasard tout magnétique de rares déchirures dans la nuit. (…) Mais fouisseur d’images aux injonctions rebelles, je tournais le dos à toute vie rampante. (…) Le temps s’est écarté de nous. Je vous rêve, je vous éveille.
L’auteur de ces fragments d’imaginaire, au verbe éruptif, aux contours tranchants (…) écrits entre feu d’une présence et rupture par absence, poésie du dedans, d’au-delà, de la distance à dire, est un revenant. Il écrit à partir de la mort dans la vie des mots. Quelque chose du romantisme de la plus belle eau s’invite parfois sous sa plume. Comme Ophélie, leur personnage central qui, dès les premières lignes, enclenche les mécanismes du poème, l’auteur qui les compose est un esprit errant parmi les choses, parmi les brumes, en bord de rives, parmi des lieux rêvés, pièces vides de toute présence, chambres de lampe obscure, inquiétants corridors, miroirs qui s’ouvrent comme autant de mots dépliés, feu qui tressaille sous d’obscurs filaments d’insomnie, caressant sur la feuille absence comme présence d’une semblable ferveur de la main. Autant de chemins d’une écriture qui cartographie une sombre, et grave, mais effervescente traversée de soi où il s’agit d’apprendre ce qui est, au-delà du monde sensible, comprendre et aimer tout ce qui vit en nous, par la puissance de l’imaginaire, que l’on porte moins qu’on ne s’y épaule, présences invisibles dans la masse endolorie des heures où s’ouvrent perspectives, poches d’ombre et portes dérobées. Où il s’agit, par des mots haletants, les lèvres au bord de l’infini, de renflouer la mémoire et, d’une voix errante, parler aux méandres de l’âme.
Dans ce recueil à l’ambiance quasi hypnotique, M. Passelergue visite les abîmes de l’intime. Il se laisse tomber dans le gouffre que hante une insaisissable présence, celle qui vit sur l’autre rive d’une même blessure, veut liquider le temps pour mieux passer au-delà des frontières de la sensation comme de la pensée, donne forme à l’angoisse pour mieux la circonvenir.
J’aurais aimé, dans ces lignes, évoquer la poésie de Chrétien de Troyes, celle de Pétrarque et de Maurice Scève dont l’obsession de la quête amoureuse, les images, et parfois les formulations ne sont pas toujours bien éloignées de l’esprit de M. Passelergue, la poésie tissant, à travers les époques, des liens que nous pouvons ni ne devons pas renier, mais en guise de conclusion, je citerai plutôt ces mots de Jean-Louis Bernard à la lumineuse justesse : « Voici une poésie de ferveur et d’inquiétude, de source et d’étang, d’eaux primordiales, une poésie affûtée au tranchant de l’absence et pourtant charnelle, liquide, brûlante, une poésie où « l’attente du silence » se transmue insensiblement en silence de l’Attente (la pure, celle qui n’a plus d’objet). »
Michel Diaz, 03/01/2020