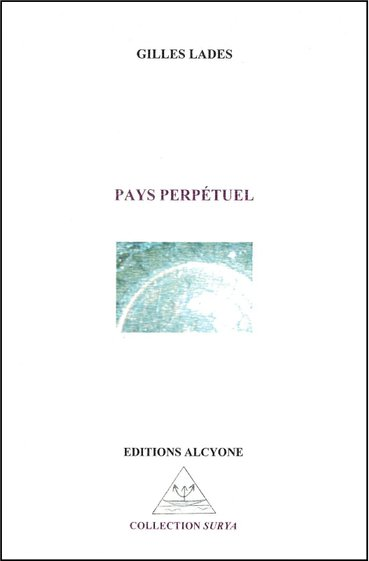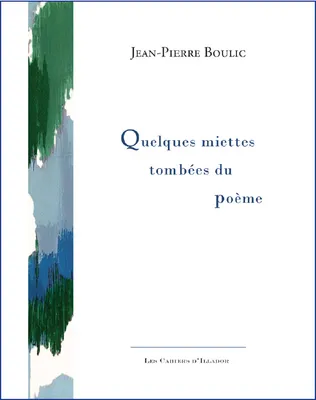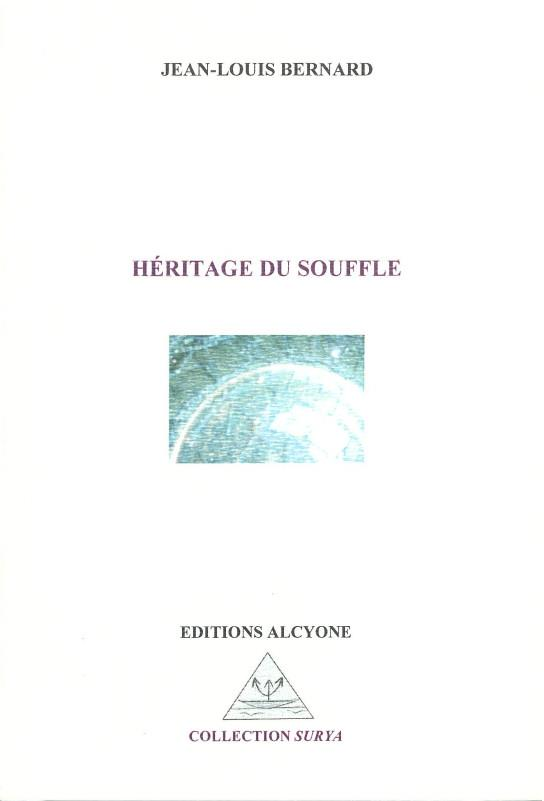
Héritage du souffle
Jean-Louis Bernard
Editions Alcyone (2023)
Note de lecture publiée in Terres de femmes (mai 2024)
Jean-Louis Bernard est l’un des rares poètes contemporains qui explore avec autant de constante acuité la question de notre relation au monde dont dépend en grande partie, sinon essentiellement, notre relation au langage, c’est-à-dire aussi à nous-mêmes. Question existentielle à laquelle il accorde un rôle capital.
C’est pourquoi, écrit-il, corrigeant dès les premiers vers du recueil, Héritage du souffle, les premiers mots de la Genèse, Au commencement, ne fut pas le Verbe, mais la résonance. Ajoutant aussitôt : pour exister / le verbe / s’y adossa / il lui fallut / au préalable / gravir le souffle. Ainsi, le v(V)erbe, parole faite chair, ne saurait-il prendre corps qu’après la manifestation d’une résonance initiale qui, conduite par le souffle, fleurirait en verbe. Et qu’est-ce que la quintessence de la poésie, ce verbe primordial, sinon ce qui, avant même de se faire phrase, est cette obscure résonance que la voix, portée par le souffle, traduit en rythmes et scansions ? Ce souffle qui, ajoute le poète, devint ensuite stances / et paraît-il / parole / parure ou creusement. Creusement, pour sa part, dans le sombre terreau de l’imaginaire, car l’imaginaire est terre d’accueil pour le songe dont notre vivre se nourrit tout autant que notre mémoire : un rythme un souffle / en nos vies argile / pour modeler nos songes / immémorables. Et la parole du poème est aussi, en effet, ce qui nous ouvre à notre espace intime, à ses inconnaissables profondeurs (mon souffle dans la nuit / et la nuit dans l’énigme), ce vers quoi les mots (puisque nous n’avons qu’eux) font passage, cette matière d’imaginaire fondamental d’où naissent les « images », lesquelles renouvellent l’appréhension du mot aussi bien que l’approche de l’objet qui les a suscitées, en redonnant commencement au monde : Aussi Jean-Louis Bernard peut-il écrire, muette la ténèbre / la bonne /genèse pure, avant d’ajouter : devant moi ces lieux / inconnaissables / où la lenteur / abreuverait peut-être / mes cavales d’oubli.
L’écriture poétique de Jean-Louis Bernard cherche donc, entre seuil et passage, se cherche, quête inlassablement la source d’elle-même, cette lointaine et mystérieuse résonance, conduit par ce désir sans illusion qui bâtit une à une les pierres du chemin, sur fond de brumes et de solitude. Elle est celle d’un homme qui va vers l’improbable lieu qui recèle le sens introuvable des choses, d’un homme que l’exil condamne à une nomadisation sans feu ni fin, pousse à ne demeurer qu’un être d’éternelle errance, étranger à lui-même. Sa parole est ce fil d’Ariane qui suit les méandres d’un labyrinthe, qui ne mènent vers d’autres issues que celles où le conduit son souffle, à travers les décombres des jours. Peut-être vers ce qui nous hante et subsiste, perdu, en nous, du langage des origines : J’écris / les mythes et les rites / et mes racines nomadisent / dans l’évanescence / du feu. Cependant, se demande le poète, en relançant par là le sens même de sa quête : l’héritage du souffle / est-il pour l’arbre / ou pour le vent ? A quoi il se hasarde cependant à répondre : Le poème / au péril du naufrage / vogue, en nuançant ainsi sa réflexion, grand silence blanc / du poème / où guette furtive / l’harmonie d’avant le monde.
Mais l’errance doit faire route en compagnie de la mélancolie, ni tristesse ni nostalgie, mais « mélancolie créatrice », qui n’a rien à voir avec les ténèbres mais tout avec l’obscur – seule manière en vérité de retisser la relation avec tout ce perdu, disposé alors à l’accueil de la blessure originelle, seulement accessible à qui a répondu à l’appel silencieux des signes pour essayer de dire par le chant l’impermanence du rivage / et la clarté / des abysses.
Aussi, dans une nuit qui s’épaissit, n’est pas encore devenue ténèbres, à travers les régions indéterminées de la quête, les yeux fermés tâtonnent vers leur source et ne fonctionnent plus qu’au souvenir, au plus loin de lui-même, en-deçà de toute mémoire, celui que laissent sur les lèvres les échos disparus d’une langue oubliée, celle d’avant les mots, à l’aube du langage. C’est pourquoi il nous reste / à redescendre / vers ce qui s’abrite / au-dessous du réel / l’obscur et l’abyssal / du monde.
Si la nuit est son territoire, l’incertitude est son chemin, ses questions et ses doutes son plus sûr viatique. Jean-Louis Bernard n’écrit pas pour « comprendre », car il n’a aucune réponse à offrir sur ce qui nous maintient entre exil et errance, mais pour dire et pour exister par la résonance des mots qu’il assemble dans la chair du poème, ces mouvements de langue, de lèvres et d’air, qui tentent, non de déchiffrer, mais au moins de restituer la parole indicible du monde, dans une parole chair / à l’affût des / réminiscences.
C’est ainsi que se met en branle le travail du regard, que les yeux s’abandonnent, se fardent d’inconnu, pour mieux valoriser le regard du dedans, et simultanément arrachent l’ombre à la préhistoire de son langage, en allant pour cela où le regard ne porte pas, en allant quérir / l’écheveau des nuits / pour un improbable / démêlage, et inventer des notes de ténèbres / pour dire la clarté. Ainsi peut-on faire céder l’inaccessible, ou tout du moins tâcher de le transformer en étoile guidant le chemin, en le scrutant jusqu’au plus loin, jusqu’à ce que les yeux s’en détachent et poursuivent seuls l’ascension, car vision et aveuglement sont ici les faces jumelles de ce même chemin où la lampe / n’attend plus que nous / pour capter les éclairs / qui nous traversent.
En vérité, notre mémoire est plus ancienne que nous-mêmes, feuilleté d’innombrables couches de temps entrelacés, et il nous faut la convoquer pour pouvoir parler de l’instant, chercher l’évanescence de ce qui se passe dans l’immobilité du temps, et arpenter / mémoire blanche / l’aride corridor / où l’herbe s’absente, où chaque grain / y a valeur de monde, où toute fin / y est commencement. Comme il nous faut aussi convoquer ces réminiscences dont on devine qu’elles nous construisent, puis nous transmuent en ruines sur lesquelles on marche, comme on le fait parmi les rues des villes dévastées, de celles divisées, mais où l’errance poétique, arpentant de sombres décombres, ou se nourrissant des décors du désastre, y puise ses ressources, jusqu’à cette blancheur qui porte l’écriture. Autant d’images, ramenées du voyage / dans l’hiver intérieur / sous la bannière des présages, évidentes et mystérieuses, mouvements invisibles, imprévisibles et migrants, mis à jour et meurtris dans leur saisissement, comme autant de miroirs qui nous brisent, de corps qui se dissolvent, déchirant leur blancheur, comme le fait la brume aux ramures grises des arbres. Et il ne nous faut, pour les susciter, qu’accepter de se perdre dans son regard, comme l’on accepte de suivre son ombre qui s’avère une exploratrice plus assidue que l’être qui lui est attaché. Il nous faut alors regarder ces images sans craindre qu’elles nous transforment en statues de sel ou de pierre, ni qu’elles disparaissent, nous laissant nus et seuls face à la faille du silence et démunis face au néant. Ne nous reste alors qu’à graver gravir / songes moissonnés / sur les pentes des origines sur lesquelles l’inoublié s’attise /au riant des fontaines / à leur murmure inexorable.
Le chemin poétique de Jean-Louis Bernard nous invite à marcher en bordure d’abîme, rien n’y est balisé qui nous assurerait d’un but, tout y est incertain, et tout nous y égare car cet égarement est le sens même des chemins d’existence et notre seule raison d’être, car toujours nos égarements nous ramènent / à l’inapparu du chemin. C’est-à-dire au mystère de la vie même. Et il ajoute, quelques pages plus loin : la voie / est pure distance / ne pas la parcourir / simplement la / chercher. Quête incessante et inlassable, comme nous l’écrivions plus haut, à travers ces poèmes, composés de vers brefs, dépouillés de tout inutile, finalement de peu de mots. Mais une frappe obstinée, un rythme pour que cela tienne, cet effet d’une sourde énergie, de cette fatigue que le poète impose au langage, comme on brise les mottes d’un champ pour remuer et aérer la terre. C’est une poésie amincie à l’extrême et forgée à l’enclume de l’essentiel, comme aiguisée au feu d’une persévérance qui entend continuer à refuser d’être vaincue. Même si, debout exténué / le poète s’obstine à sa parole / pour dire / l’impossible parole, même s’il sait qu’en jetant sur le blanc de la page ses phrases en péril / sincères et / inconsolables / aux rides du poème / s’accroche l’incertain.
Mais la poésie de Jean-Louis Bernard ne cherche pas à nous consoler. Elle se contente de parier pour une requalification du monde et des hommes qui y vivent en tâchant d’y trouver quelque sens. Une poésie qui avance, hésite, trébuche, tombe, se relève toujours. Qui opère en rase-mottes du temps et des choses, et dont la lumière tremblée, intermittente toujours, lutte avec la porte fermée des jours. Pour passer. Dessous. Au ras. Eclairer, par la seule force du non-renoncement – et celle, selon la formule de R. Char, de ce « désir demeuré désir » –, les seuls chemins qui mènent / à ce qu’on ne voit pas, et qui seuls valent la peine de travailler à vivre.
Michel Diaz, 21/04/2024