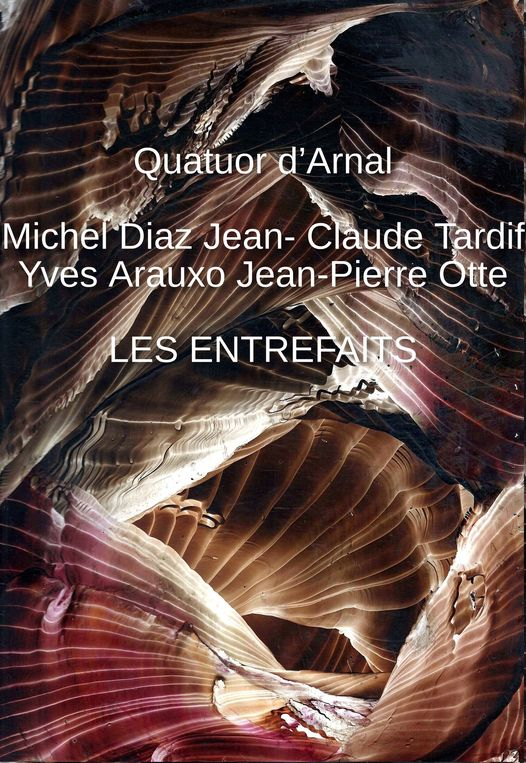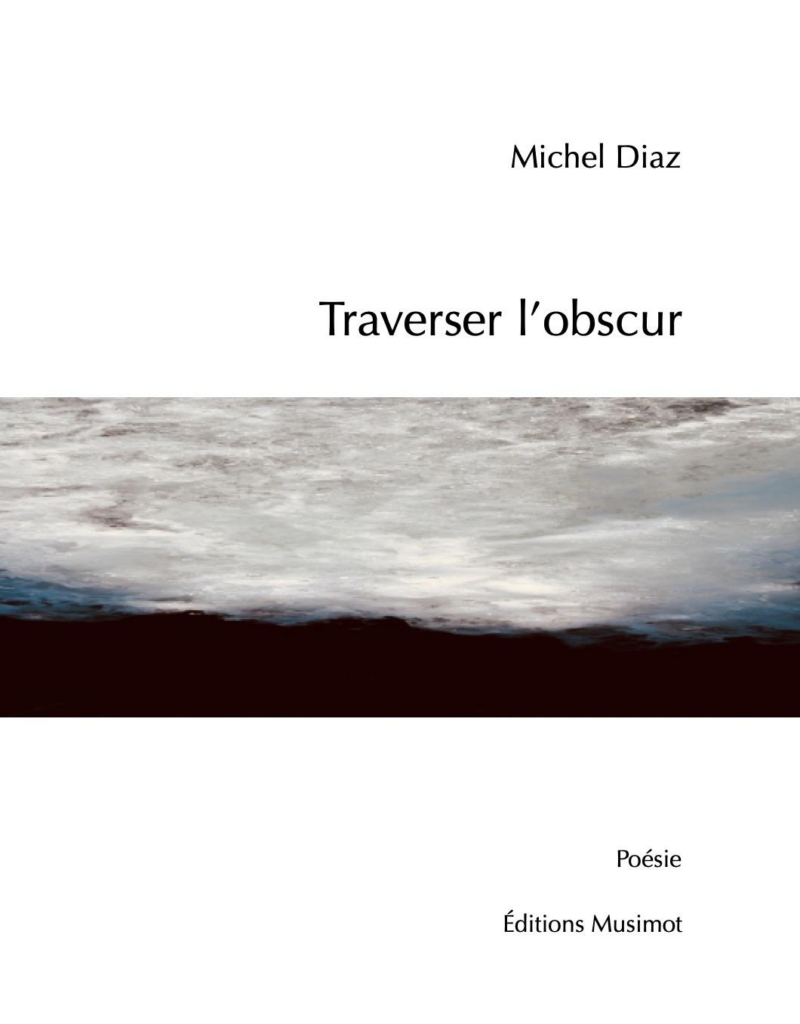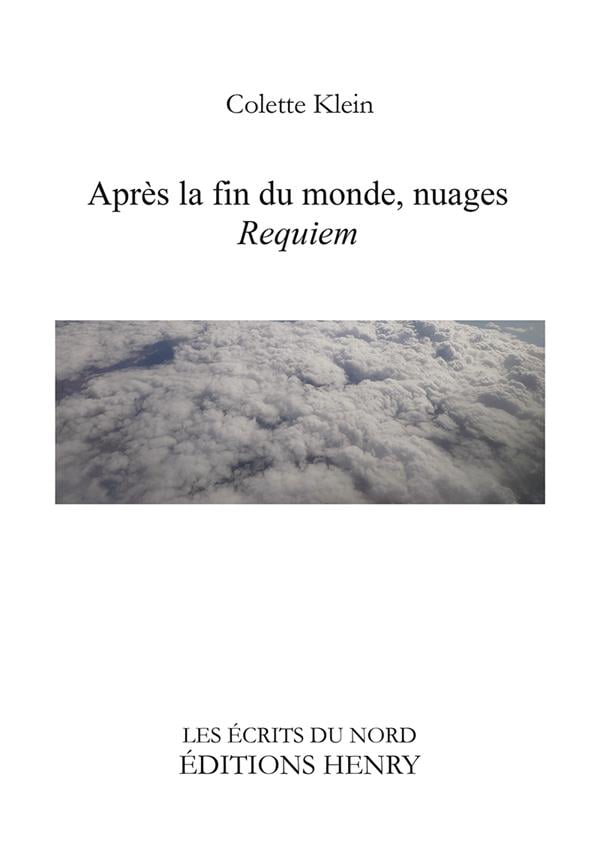L’invention des couleurs
Isabelle Lévesque-Pierre Dhainaut
Editions L’Ail des ours, collection Coquelicot (2024)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 91 (automne 2024).
Deux voix, en communion, se partagent l’espace de ce livre, celles d’Isabelle Lévesque (qui l’illustre de ses photos) et de Pierre Dhainaut (qui ont déjà signé ensemble quelques autres ouvrages ; La grande année, L’herbe qui tremble, 2018 ; La troisième voix, id., 2023). Les poèmes de Pierre Dhainaut, sous la forme de deux quatrains, occupent seuls la première section, intitulée Les cinq saisons (mars, juin, septembre, décembre, mars), alors que la seconde, Carnets de voyage, nous donne alternativement à lire, sous une forme plus libre, se répondant les uns aux autres, les poèmes des deux poètes.
Plaie béante, l’écorce a la forme / d’un cœur à l’arrêt, d’un visage / abattu par le vent d’hiver, d’un poing / qui se resserre une fois pour toutes […]. Ce sont les premiers mots de Pierre Dhainaut, qui ouvrent le recueil, et Le ciel est un ogre blême, ceux d’Isabelle Lévesque, qui le closent. On pourrait y voir, du secret de la blessure, ourlée de mousse bienveillante, à la dévoration de l’espace laiteux du ciel, comme un mouvement d’expansion (j’oserais dire une dilatation des sens) où se diluent notre conscience au monde et notre élan vers cet impossible poème que nos lèvres ne sauront jamais prononcer, quand les nuages frôlent l’apparence trompeuse, / dispersent les mots du poème. Mouvement de cela qui, ramené au jour et même dérobé, confisqué par sa trop grande lumière, vient déranger ce monde où l’on sait, croit savoir, fait semblant de savoir. Cela, qui toujours nous échappe, se métamorphosant en quelque chose d’autre, imprévu et surprise, dans l’impermanence de tout ce qui est. En dépit de nos incurables incertitudes et de de toutes nos inquiétudes.
J’ouvre les yeux, le soleil éclaboussé de neige / se lève, dit l’une, et l’autre : tout reste / avec le ciel à découvrir, c’est-à-dire / à toucher dans la respiration : / nuages, oiseaux… Et c’est bien ce qui touche dans la lecture de ces textes où l’écriture est l’expérience du regard. On y rencontre des mots qui sont un regard, qui sortent du noir en cherchant des yeux, qui voudraient voir ce qu’ils disent, et dire ce qu’on voit. Au point du jour, au bord du monde… / nous prenons le droit de parler ainsi, ici, / le seuil s’éveille à l’instant, à l’attente, écrit Pierre Dhainaut, et plus loin, Isabelle Lévesque, un mot pour tant de silence, verbe pourpre / étoilé du sanglot qui délivre l’hiver. Dans cette parole à voix basse, qui se fraie un chemin dans le réel du monde, on entend battre de l’humain en perpétuel devenir. Il y a là, dans ces mots, des textes qui ne sont pas dans les mots, bien qu’il n’y ait pas de texte sans mots. Ce sont les textes qui nous invitent à voir et écouter en même temps, les sons prenant plaisir à miroiter, ces sons du vent dans les feuilles des arbres, des mots qui ont toujours ici un ton qui ne nous trompe pas. Celui d’une écriture poétique qui nous mène au plus loin, vers un là-bas qui est aussi ce qui vient, cette promesse dans la clarté où la nuit s’enracine. La nuit, écrit Pierre Dhainaut, qui ne sera de retour que sous un nom nouveau. La nuit dont je ne connais pas le nom, lui répond Isabelle Lévesque, différent / chaque matin. / Les voyelles changent, avancent / le nom neuf. Et c’est ce « nom neuf », cette promesse d’éclaircie sans origine, sans réponse, vivante plus que nous, qui cherche à donner corps et présence à ce qui, près de nous, veille et demeure, patient, presque invisible, accordé à notre désir de lumière.
Aussi, nous disent les poètes, il ne nous faut pas redouter l’inconnu, puisque le visible est plein de parfums, mais surtout de couleurs dont la divine assemblée nous aide à contenir l’assaut de l’existence. Laquelle des couleurs, se demande Pierre Dhainaut, accueille ou recrée le mieux la lumière ? Et Isabelle Lévesque de nous dire, quelques pages plus loin : Lis le blanc, sur la lisière : il trace / la frontière entre mars & avril. […] // A chaque instant, cette lumière / nous traverse. Les pétales blancs / portent des indices : apparition & disparition / pour inverser le miracle. Car au seuil du jour, révélant les couleurs, voici qu’une lueur franchit la nuit, frôle nos lèvres, se pose sur notre visage, feu instable qui éclaire mains et paupières, invente douceurs, halètements, sourires, feu savoureux d’amour qui saigne entre blessures de l’aube et morsures des ombres. Au matin prononcé se poursuit le poème, puisque le jour renaît comme doit revenir l’écriture, jardin qui offre au jour des mouvements d’iris, des balancements de coquelicots, quand le monde se concentre pout réciter l’énigme ancienne, ce qui n’attend pas, ce qui s’enfuit et que les mots doivent tenter de dire, de retenir un peu, à défaut de sauver.
Progresser, chaque jour, dans l’incertitude et dans l’ignorance pour rejoindre ses sources : ainsi pourrions-nous résumer la démarche poétique de Pierre Dhainaut qui n’est pas exempte d’angoisse, mais dont le chemin vers le « non-savoir », c’est-à-dire l’effacement progressif du « je » qui favorisera l’avènement de la « voix », celle qui monte de la terre avec le souffle des sources, celle qui renaît des herbes emmêlées, se confond avec la parole des arbres, la respiration du bleu infini, et accueille un autre silence, un silence qui n’aurait d’autre beauté à célébrer que ce que nous aimons au ras du sol, et l’exubérance des fleurs : la fleur du cap, la plus belle, la bruyère, / nous célébrerons sa couleur / dans le tumulte inassouvi des vents, des vagues, / sous un ciel parfaitement bleu. Aller alors vers plus de pauvreté (et nous entendons Rilke ici), dans le dépouillement de soi-même, de tout son superflu, pour pouvoir s’étonner encore que la bruyère ne cesse de fleurir, que le ciel de mars se colore, se remplisse du chant des grives. Entendre ce que dit ce chant : tout prend fin, mais tout ressuscite, / l’espoir dans le matin est le matin. Et toujours la sagesse du jour qui se rappelle les passages empruntés il y a bien longtemps, dans les temps d’innocence, qui se rappelle que la fleur inventée, la fleur présente, c’est elle qui devance les poèmes, ce qu’on dira d’eux, dont les vibrations des syllabes confondront le hasard de vivre avec celui de mourir.
Quant aux poèmes d’Isabelle Lévesque, ils détiennent aussi une part de mystère que l’auteure partage avec son compagnon d’écriture comme avec le lecteur, et qui renvoient à une expérience sensible du monde, aussi bien mentale que physique, qui invite nos yeux à chercher dans le temps la place de là-bas dans le présent d’ici, pour aussitôt en faire un souvenir : La montagne élève sa forteresse de lumière, / je la regarde pour que chante la mémoire / (enfant je glissais sur ces pentes). // La neige, la merveille sur ma manche. S’y lit une complicité intime qui lie la neige, le nuage, le givre du matin, l’arbre immobile qui danse rouge au ciel, le vent d’Armor, les coquelicots qu’il disperse, la lumière pure du silence, les fleurs et leur murmure bleu, tout cela, l’air ou l’or qui, dans le poème, se répondent, et créent un nouvel ordre dont le sillage intact unit les regards. On trouve la même expérience synesthésique chez ces deux auteurs où, comme dans le poème Correspondances, de Baudelaire, « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Expérience qui invite à vivre parmi les choses les plus simples de ce monde, comme à vivre entre les étoiles et vivre entre les mots,
Au lecteur-promeneur d’emprunter la voix/voie des auteurs, leurs routes, leurs regards. A lui, à nous, de glaner dans ces textes ces éclats de conscience fertiles, souvenirs, impressions, semence de pensée, et dans le fatras du temps qui passe ou qui ne passe pas, à lui, à nous, d’avancer sur les rives imparfaites, de franchir le seuil de cette maison où il n’est pas aisé de vivre, et d’accueillir aussi les ombres. Avec bienveillance et humilité.
Michel Diaz, 05/08/2024