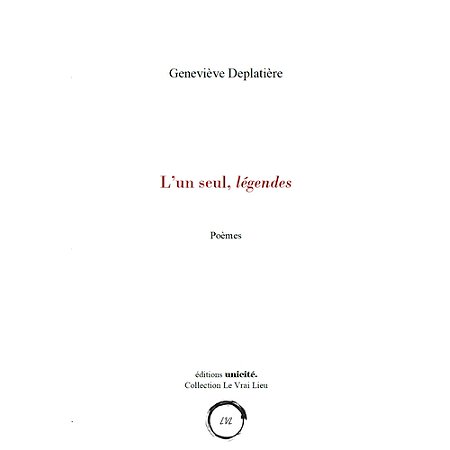
L’un seul, légendes
Geneviève Deplatière
Editions Unicité, Collection Le Vrai lieu, 2020 (59 p.)
Note de lecture publiée dans le N° 86 de Diérèse (hiver 2023)
Je ne dirai rien sur le titre de ce recueil, a priori énigmatique, évitant ainsi de donner une interprétation qui en orienterait, voire en fausserait la lecture. « Le titre d’un livre, disait Jacques Dupin, n’est pas une annonce, un programme un couvercle. Il n’est ni un condensé ni une émanation du texte. A peine un signal, un repère (…). Il doit à la fin rejoindre le poème, mais il vient d’ailleurs, d’une autre case de l’imaginaire. » Si le titre d’un livre n’est pas une clé, mais «plutôt un trou de serrure laissant le regard pénétrer », comme ce poète le disait encore dans cette interview, je me contenterai de ce trou de serrure pour avancer que dans L’un seul du titre, je crois aussi lire « linceul » (ce linceul sacré au revers de / l’insupportable), ce linge blanc qui cherche à pacifier la mort et qui, par une inversion symbolique de la couleur, peut aussi bien devenir « lange », linge où le cycle de la vie s’amorce, et qui par assimilation des sens peut évoquer ce si étrange blanc de la page où s’aventure la poète – qui sait que maintenant / tu pourras t’en aller seule / sous une page blanche.
Les trois sections de ce recueil, « Passages du clair-obscur », « Dans un désir de rosée », « Mise en scène », sont précédées chacune d’une citation de Bernard Noël, Pascal Quignard et René Char, qui nous indiquent clairement le balisage de l’ouvrage, en donnent les étapes et en marquent la progression.
En effet, ce recueil n’est pas qu’une simple collection de poèmes mais un livre construit qui s’offre à nous comme une invitation à cheminer sur un territoire de réflexion et de questionnement où les mots se révèlent indissociables d’une démarche et d’une expérience de vie.
Il y a d’abord, dès la première page où l’auteure s’adresse à elle-même (comme presque tout au long du recueil), cet indéfinissable tremblement d’un désir innommé qui, remontant du fond des eaux obscures de la rêverie, fissure le silence comme au commencement de ce qui cherche à devenir parole : Sur fond de tes pensées / qui dérivent / tu cherches une trace / ajourant ta peur / de l’ombre / de ton insondable histoire.
Que sont ces mots, se demande l’auteure, qui s’imposent à la pensée et glissent sur la page : Ne serait-ce que poudre aux yeux, d’or ? Sont-ils de ceux qui entretiennent la pensée toute faite et s’emploient à penser pour nous, cimentent nos croyances, alimentant ainsi notre « long travail d’illusion », selon la formule de B. Noël ? De ceux plutôt qu’inventent tes sens navrés / d’inexplicable qui te courbent dans l’ombre ?
Mais si lumineuse qu’elle nous apparaisse par moments, la poésie de Geneviève Deplatière est une poésie inquiète. Inquiète de cette inquiétude fertile qui nous fait nous tenir aux aguets, dans la vigilance de cette veille que réclame l’état d’être-au-monde. La lumière, pour elle, ainsi que je l’ai dit pour quelques autres puisatiers de la parole, n’est pas un état d’âme ni d’esprit qui lui est naturellement donné. Il lui faut la gagner, jour après jour, mot après mot, sur la pénombre qui nous cerne, les doutes et les peurs, sachant que ces éclats dont s’éclaire le cœur ne sont que des joies éphémères, des moments dont la fulgurance fait tout l’inestimable prix : C’est le prodige du jour // à hauteur d’aubépine / blanche comme / un songe qui remplit les yeux / d’une enfant qui dort / auprès d’une source qui coule.
Ecrire serait donc, pour Geneviève Deplatière, travailler à se déprendre de ces illusions du « vivre » et celles d’ « être humain » auxquelles, par paresse et facilité, nous nous abandonnons. Ce serait, pour cette poète, s’essayer à tracer sa route dans les mots, avancer au bord du naufrage et trébucher dans le silence, quitte à perdre pied dans la lâcheté des heures perdues / ou la rage des pas qui piétinent. Car la seule fonction du poème est de nous ouvrir l’œil pour nous inviter à entrer dans l’innocence fulgurante / d’une toison d’épines et de pétales / à tresser d’espérance, laisser le désir monter à l’assaut d’une course nouvelle // Si au sommet une clarté. Mais écrire, pour pouvoir, en de brefs instants, saisir la beauté, sa douceur / qui te vient dans les mains, sème des mirages est effort qui réclame et impose que l’on ne cède rien aux complaisances dans lesquelles parfois la poésie s’égare, et soulever d’entre les périls / ta silencieuse traversée.
Parfois pourtant, écrit l’auteure dans la deuxième section, Il se peut qu’un instant / sur la grève tu verses tes pleurs, tant / l’exode des aubes t’accable. Comme encore Il se peut qu’en un instant pur / tous les âges viennent à ta rencontre / dans l’alluvion des baisers et des mots qu’ils charrient. Instants de désarroi ou de fugitive allégresse, car travailler à te sentir vivante, écarter devant soi les ombres qui nous hantent, braver cette incertaine traversée du temps, comme affronter l’espace d’inconnu sur lequel ouvre le poème, c’est aussi défier la mort. Et rien ne nous sera donné qu’il ne nous faut aller prendre. Aussi la poésie de Geneviève Deplatière s’avance-t-elle Comme dans la grande forêt /où le soleil joue sa lumière / dans ces rouleaux, obscurs d’être / si proches.
Mais écrire, c’est toujours un même geste, Ouvrir les mains, redéfinir les contours, / car chaque pas prend du temps, ce même geste qui est à l’œuvre quand ce mouvement de la main et du corps lève devant lui l’inconnu, quand il ne s’agit pas de traduire une expérience antérieure avec ses sentiments et ses secrets mais quand cette manière d’aller est elle-même le lieu de l’expérience, la réponse apportée à un passage de vie, à ses éclats : si nos rêves embusqués s’affranchissent de l’ombre / qui gît sur eux / l’amour fou du souffle alors, s’il mange dans nos mains, / fera reculer le désert.
L’écriture de Geneviève Deplatière est à la fois quête et révélateur de l’être, cérémonial intime des sens en éveil et réceptacle des secrets frémissements de l’être : Ici, de jour en jour, / et la rumeur des désirs / comme le vent passe.
En dépit des incertitudes et des douleurs qui accompagnent « le métier de vivre », et même quand, parfois, derrière tes lèvres, les cordes des mots sont brisées, la poésie de cette auteure est traversée d’un bout à l’autre (et je dirai même de part en part) par l’opiniâtre ligne mélodique où se tiennent les notes les plus hautes de sa voix, ses couleurs les plus claires. Le disent explicitement les mots qui ouvrent la troisième section : De toute façon, le jour demande son passage, / même, au solstice montant d’après neige, celui qui / mord / les boutons de rose, / car il fait chanter les arbres. Et elle écrit encore, un peu plus loin, Force est… de vivre, d’aimer tant / et quand de faire le point, d’ouvrir encore les yeux / Le solstice nous aventure plus loin, car Dire poursuit l’horizon / c’est dire sa force.
Cette parole, de page en page, hésitant quelquefois et doutant parfois d’elle-même, comme luttant à voix blessée « contre » ce qui offusque la lumière du cœur, travaille incessamment pourtant à tenir bon et se tenir debout « pour » assurer ce que la vie exige de ferveur dans l’amitié du monde et dans l’amour de l’autre, et cet équilibre de l’âme sans lequel le fait d’exister ne connaît aucune assomption.
Michel Diaz, 19/06/2022
