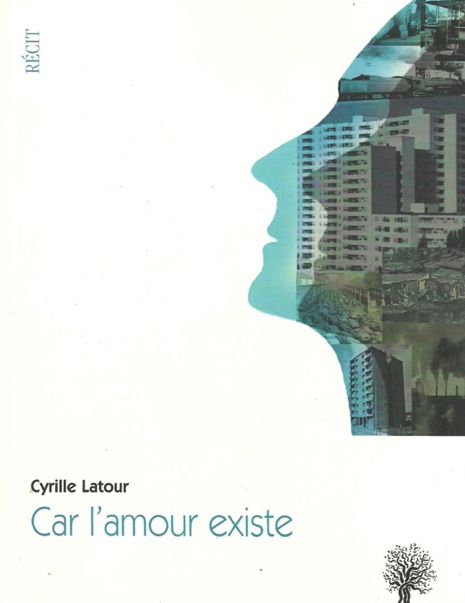 CAR L’AMOUR EXISTE – Cyrille Latour
CAR L’AMOUR EXISTE – Cyrille Latour
Editions de L’Amourier (2018)
« La nuit sera blanche et noire » (G. de Nerval)
Ce livre, dans le drame qu’il nous révèle et nous livre pudiquement, par fragments successifs, est traversé de pages déchirantes qui nous touchent au plus intime.
Mais quelle est la nature de ce texte ? Il appartient à la catégorie des objets littéraires non (ou peu) identifiés. En lui, rien qui puisse vraiment le ranger dans un genre bien défini qui nous en fournirait la méthode d’approche. On pourrait cependant, comme nous le suggère la présentation de l’ouvrage, retenir la formule de « récit de vie ».
Les premières lignes de la 4ème de couverture nous présentent ainsi cet ouvrage, en commençant par une citation:
«L’ordinateur diffuse le film que tu ne regarderas plus. Sur l’écran, il ne me reste que les mots pour tenter de redessiner, en transparence, le reflet de ton visage.
Ce très beau film, qu’elle ne regardera plus, est L’Amour existe, de Maurice Pialat. Parce qu’il fut prélude à leur rencontre, le narrateur en tresse ici le récit avec cet autre, celui de leur courte vie ensemble, interrompue par son geste, à elle.»
Ce geste, Cyrille Latour l’évoque dès la 3ème page de son livre:
«Quand je repense à cet été, à notre attente, je peux dire tout ce que tu as fait– en quoi, concrètement, tu as transformé cette attente –, mais je ne saurai jamais comment tu as attendu.
Deux mois plus tard, tu donneras la vie. Encore douze de plus et tu te donneras la mort. Terrible puissance du don – mais la mort ne se donne pas, tout juste se reçoit-elle.»
A travers la voix du comédien-récitant J. Loup Reynold, ce sont les mots de M. Pialat que l’on entend dans L’Amour existe, court-métrage d’une vingtaine de minutes en noir et blanc, réalisé en 1960, un des premiers du réalisateur.
On peut, avec Cyrille Latour, légitimement estimer que ce court film est un chef-d’œuvre. Ce n’est, au demeurant, ni tout à fait un documentaire, ni un essai, mais un poème cinématographique à la mélancolie poignante, qui s’articule autour des mots délivrés en voix off, des longs plans panoramiques dessinés par l’œil de la caméra et de la musique de G. Delerue. On y voit doucement défiler les images grises, tristes et désolées, désolantes de solitude, de la banlieue d’alors, d’entre Pantin et Courbevoie, ou de la périphérie Est de Paris. On y voit aussi défiler les images navrantes et compactes des heures de pointe sur les quais ou dans les couloirs du métro, les embouteillages des vies pavillonnaires prêtes à tous les sacrifices pour échapper aux horizons concentrationnaires des barres d’immeubles, quitte à planter leurs quatre murs au bout d’une piste d’atterrissage d’Orly ou de Roissy. On y voit encore des images des bidonvilles de Massy à la fin des années cinquante, celles des barres HLM parfois quasiment aveugles.
Ce que propose M. Pialat dans ce film, ce n’est pas une étude sociologique de la banlieue, mais une évocation, pour dire « le parachèvement de la ségrégation des classes », la promiscuité des appartement HLM « qu’on ne choisit pas », pour dire la vie de travailleurs qui n’ont que la « vieillesse comme récompense », et la mise à l’écart des centre-ville, là où les rares horizons sont ceux des zones industrielles et commerciales. C’est un film d’amour, triste et rageur, sévère mais lucide, dont le propos, résolument politique, sur la banlieue, sur le quotidien sans futur des habitants de la périphérie parisienne reste vrai, 55 ans après sa réalisation.
C’est tout cela, cette tristesse, cette rage sourde, cette sévérité lucide et ce même regard politique, que l’on retrouve, fidèlement transposés, clairement assumés, dans le livre de Cyrille Latour.
Il était nécessaire, je crois, pour mieux parler de la « nature » de ce livre si singulier, de rappeler ce que nous montre le film de M. Pialat, puisque Cyrille Latour, prenant appui sur ses images, les commentant l’une après l’autre, plan après plan, retranscrivant les mots de la voix off, ses inflexions et ses silences, y tresse son « récit de vie », ne le superpose pas à eux, mais l’y mêle, les confondant parfois, comme en des effets de miroirs, l’un devenant alors l’éclairage des autres.
On peut penser, peut-être, à la démarche de M. Duras, comme dans India song, par exemple, faisant un livre de son film et déplaçant son œuvre d’un genre vers un autre pour lui proposer un nouveau statut. On peut, je crois encore, se risquer à le dire, tant Cyrille Latour, qui n’est pas l’auteur de L’Amour existe, se le réapproprie pourtant intimement, semble en récrire tout le scénario jusque dans les moindres détails, semble en réinventer le matériau, en tout cas le « rénove » et le « revisite ». Ainsi, comme on le lit encore dans la présentation du livre, « le cinéma devient texte, et le récit de vie se fait image au creux de l’absence ».
Le trouble qui nous prend à la lecture de ce livre, nous poursuit, sa lecture achevée, provient bien entendu de l’incompréhensible « geste », de l’irrémédiable « c’est arrivé« , mais il provient aussi de quelque chose d’indéfinissable qui est, dans son déplacement de l’angle de vision, comme le compte-rendu « hyperréaliste » des images de la réalité, celles grises, tristes, désolées, proposées par le film de M. Pialat, celles de la banlieue contemporaine, tout aussi désolées, évoquées par l’auteur du livre, et celles incrustées dans sa mémoire comme autant de photos ou d’images mouvantes de l’être disparu. La superposition de ces regards, de ces strates d’images, provoque au cours des pages (c’est en tout cas mon expérience de lecture) quelque chose d’halluciné.
Par « halluciné », je veux dire que cet ouvrage est produit d’un regard qui, posé sur les choses (les images de la banlieue filmée dans années soixante, confondues avec celles, tout aussi réelles, d’aujourd’hui, qu’il arrive à l’auteur de superposer sur les mêmes lieux), provoque un trouble de la vue qui en fait apparaître, avec une intense acuité, ce que le regard, tout d’abord, n’aurait su aussi bien percevoir. Il en émane, comme une saisie par un troisième œil, une impression de « surréalité » qui, au-delà des apparences du réel sensible, en fait jaillir un sens qui ne peut s’imposer que comme une évidence, en serait la « révélation » (au sens photographique du terme), l’apparition de quelque chose qui met à mal notre lecture du réel, banalement infirme, mais l’ouvre à d’autres angles de vision et de compréhension.
 L’une des vertus d’un ouvrage qui ne doit d’exister qu’à la seule et urgente nécessité de son écriture, est d’interroger l’incompréhensible, d’apporter quelque sens à ce questionnement et à l’absurde vérité du monde, donnant ainsi à son auteur la seule dimension qui vaille. F. Nietszche écrit, dans Le gai savoir: « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » L’expérience de vie (et de mort) et la démarche d’écriture, dans le cas de son livre, autorise Cyrille Latour à regarder en face l’un des aspects de cette vérité dont la dureté nous brûle les yeux et l’esprit, et dont certain(e)s, à l’éprouver dans ce qu’elle a d’insupportable, vont jusqu’à en mourir. L’art, quelquefois, ne suffit plus.
L’une des vertus d’un ouvrage qui ne doit d’exister qu’à la seule et urgente nécessité de son écriture, est d’interroger l’incompréhensible, d’apporter quelque sens à ce questionnement et à l’absurde vérité du monde, donnant ainsi à son auteur la seule dimension qui vaille. F. Nietszche écrit, dans Le gai savoir: « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » L’expérience de vie (et de mort) et la démarche d’écriture, dans le cas de son livre, autorise Cyrille Latour à regarder en face l’un des aspects de cette vérité dont la dureté nous brûle les yeux et l’esprit, et dont certain(e)s, à l’éprouver dans ce qu’elle a d’insupportable, vont jusqu’à en mourir. L’art, quelquefois, ne suffit plus.
C’est cette « vérité » que Cyrille Latour (à la suite de M. Pialat) désigne comme l’un des visages d’un monde où l’air que l’on respire devient de plus en plus terrible. « Cela » qui semble justifier, en tout cas expliquer, en arrive-t-il à nous dire, ce « geste » de désespérance qui, d’abord, aux yeux du lecteur, ne semblait relever que d’un mal être personnel au monde, d’une décision incompréhensible mais solitaire. Cette « vérité » que chacun fréquente quotidiennement et que le plus grand nombre, s’y accoutumant, finit par ne plus voir ou tâche, pour l’exorciser, s’en défendre, la tenir à distance, de ne rien changer à ses habitudes, la voilà dite dans ce livre:
« Violence du monde, violence du groupe ou violence solitaire retournée contre soi […] le monde entier est en danger. […] Et au moins, n’as-tu pas eu à voir se confirmer ce que ta peur lucide te répétait en boucle jusqu’à l’usure, à proprement parler jusqu’à la déraison: le monde entier est un danger. »
Et puis, comment continue-t-on, aujourd’hui comme hier, à maltraiter les hommes ? A leur imposer une vie qui ne peut que les rendre malades d’eux-mêmes et du monde, « jusqu’à la déraison » ? « Temps de vie fragmenté, du domicile au lieu de travail, du lieu de travail aux commerces, des commerces au centre-ville, du centre-ville à la périphérie. Et tant de vies en morceaux, découpées par la palpitation permanente des feux de détresse. […] Faut-il que les lieux de vie soient si invivables pour devoir les quitter aussi souvent ? Deux heures, trois heures, quatre heures de trajet par jour. Faut-il que le temps ait si peu de valeur pour le gaspiller en embouteillages et heures de pointe ? […] Entassement dans les wagons surchargés. Second trajet en autobus. » Voix et regard à l’œuvre dans le film de M. Pialat, comme ceux de l’auteur du livre, ne font plus qu’un, ici encore, et s’accordent pour dévoiler « l’humiliation quotidienne à laquelle ils préfèreraient probablement oublier qu’ils ont accepté de se soumettre ». Vies d’êtres épuisés par l’inexorable routine, la longueur des trajets, l’ingratitude du travail. Déportation massive, quotidienne, à laquelle il leur faut consentir. Rien n’a changé. Tout se répète, continue, et on aurait envie de dire « en pire », car l’horizon des espérances s’est résolument assombri. Aucun rêve ne semble plus possible, et la violence du monde n’a pas baissé les armes, loin de là. Non, nous répète Cyrille Latour, comme un leitmotiv, « la guerre n’est jamais très loin ».
Aussi, voilà aussi ce qui, au bout des mots finit par s’imposer:
« A bien y regarder, ton mal n’était en rien l’expression de ce qui n’allait pas en toi, mais plutôt de tout ce qui autour de toi, autour de chacun d’entre nous, ne va pas en soi, ne va plus de soi. Tu n’as fait, au fond, que réagir sainement à un environnement qui ne l’était pas. »
Et puis, voilà encore, comme suite logique de ce qui précède, une autre scène du film de M. Pialat: une femme en maillot de bain, qui plonge dans la piscine en plein air du quai Michelet à Levallois, dont le corps disparaît un instant de l’image. Et Cyrille Latour écrit:
« Vertige qui me glace. Je ne peux assister à ce saut sans une violente angoisse. Je ne peux supporter cette absence – saut qui anticipe, répète ton propre saut; absence qui prévoit, redouble la tienne. Elle saute, disparaît – premier être humain sur lequel s’attarde son regard depuis la nuit blanche et noire – et tout est brusquement dépeuplé. »
Oui, cela fait bien référence à cet autre « saut », celui de Gérard de Nerval dans « la nuit blanche et noire » de son désespoir et aux derniers mots qu’il nous laissés. Et c’est dans ces quelques pages du livre, que je viens d’évoquer, que situe le cœur saignant du livre, là qu’il bat au plus près des images du film, où se scelle sa clé de voûte.
Contre l’oubli, ce livre se remémore. Livre de vie, en vérité, et au-delà de l’inconsolation. « Faire son deuil », dit-on couramment aujourd’hui, en se conformant aux formules prêtes à l’emploi. Expression détestable, me semble-t-il, car injonction à recouvrir (ou à combler) le manque de l’absence. En fait, il n’y a pas de deuil possible, quand l’absence a ouvert sa béance, autant inacceptable que démesurée, et que l’amour perdure au-delà de la mort, et contre tout l’oubli. « Faire son deuil » devrait plutôt être l’effort d’œuvrer à maintenir cette béance ouverte pour y approfondir et cultiver notre expérience de la perte. Cyrille Latour s’y emploie, qui écrit à la fin de son livre:
« Tu as donné la vie. Tu m’as donné la vie. […]
[…] Après toi, après le plein de toi, je n’ai que des bris. Le plaisir, la joie, l’abandon, la confiance, la douceur ne pourront s’offrir que par morceaux, sans unité ni cohérence. Pourtant, j’en ai l’intuition étrange – insolente, incongrue mais nécessaire -, ils constitueront tout de même un avenir. Vie brisée, mais vie quand même.
Je ne veux pas demander grâce, mais rendre grâce. Car l’amour a existé – par la grâce de toi.
Car l’amour existe. »
Derniers mots dictés par l’amour. Ce que l’on doit en conserver d’intact et de plus lumineux. Ils ne doivent cependant toute leur force, à la fin de ce livre, qu’à tous ceux qui les précèdent, qui leur ont permis de grandir et de solidement s’enraciner dans le terreau de la douleur, d’acquérir le plein sens de leur paisible certitude.
Cette certitude est celle que le titre de l’ouvrage affiche, affirme, et qui est contenue tout entière dans le « car », la conjonction de coordination qui impose, incontestable, la relation causale d’une proposition à ce qui en découle. Dans ce titre, en effet, qui devrait logiquement être (……………) car l’amour existe, Cyrille Latour fait l’économie de la première partie de la phrase dans laquelle se résume le livre entier qui se retrouve dans ces mots:
« Je dois assumer sans toi maintenant ce risque que nous avons pris – vivre -, mais ton geste n’y change rien, n’y changera jamais rien. Ne pourra jamais prendre ce qui est pris. »
Par ce livre qui questionne et qui le questionne, le regard largement ouvert, dans sa pleine mesure d’homme, en être qui travaille à « transformer le pourquoi en pour quoi« , Cyrille Latour nous donne une leçon de vie et, par-delà la mort, rend le plus bel hommage qui se puisse à sa compagne disparue et déjà, par ces pages, « rend à (s)on geste sa dignité », comme par sa promesse de « (s)e montrer à la hauteur de (s)on sacrifice ».
Michel Diaz, 10/05/2018