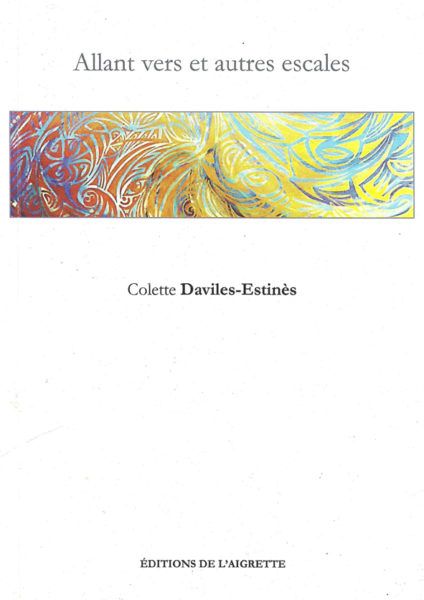 ALLANT VERS ET AUTRES ESCALES
ALLANT VERS ET AUTRES ESCALES
Colette Daviles-Estinès – Editions de l’Aigrette (2016)
…
La poésie de Colette Daviles-Estinès est de celles qui convoquent le monde, indéfiniment renaissant et indéfiniment redécouvert, que la marche des mots accompagne :
« Chaque jour
Un mot comme un pas
J’écris : la bruyère rouge rampe
A fleur de pierre »
Chaque jour est un autre, nouveau, « cicatrice » du précédent, trace de celui qui suivra. Où il faut tout réinventer, sans autre choix que de le prendre en charge et s’y aventurer, comme on marche en terre nouvelle, et réhabituer ses yeux à la lumière, ré-accommoder son regard à ce qui constitue l’énigme du Réel. Comme au sortir de la pénombre ou des mauvais rêves des hommes, on doit d’abord se confronter à ce qui nous aveugle d’évidence, et qui est la beauté du monde dans sa simplicité première. Chaque matin,
« Il faut dénouer l’aube
comme un ciel s’éventre au palmier voyageur. »
Le monde est là, qu’il faut tenter de « ressaisir » et de ré-habiter. Y retrouver sa place, essayer d’y inscrire le fragile de sa présence, d’y rebâtir un provisoire nid que le vent, on le sait, risquera de jeter à terre, mais un nid grand ouvert sur l’espace du ciel et les quatre fenêtres de l’horizon. On peut alors :
« Imaginer
trois marches empilées dans le paysage
D’un côté, du blé
coiffé en brosse par le vent
De l’autre, des lavandes moussues
ou peut-être la mer […]
Imaginer une porte en bois
hissée bleue sur les marches
Aucun mur n’est bâti autour
ni alentour
C’est une chose heureuse
Habiter le seuil d’une porte ouverte
adossée à la lumière »
Mais « habiter le seuil », ce n’est pas se tenir à la marge du monde, en lisière du temps et des choses, c’est seulement faire le choix d’assumer que l’on est toujours de passage, dans le Temps sans limites du Monde comme dans les lieux de la Terre, en halte provisoire et en continuel cheminement vers ce qui nous appelle, nous attend, plus loin, « ailleurs », et de se définir dans « l’être-ici » comme en durable transhumance.
Mais pour l’auteure de ces poèmes, imaginer une maison sans murs, qui a toujours sa « porte ouverte », c’est aussi refuser l’idée de se laisser emprisonner dans un quelconque lieu (fût-il « heureux ») quand on sait que l’on est condamné(e) à un perpétuel exil, et que d’un « nulle part » on peut faire autant un « partout ».
« Je n’ai que l’embarras du choix de mes rivages », écrit Colette Daviles-Estinès, ou encore, malgré le retour au lieu des origines, « Où ne pas être l’étrangère ? »
Et c’est ce sentiment d’exil qui traverse tout ce recueil, à l’œuvre de manière récurrente dans les titres (Racines, Exil, Un retour étranger, Aller, Tram away, Cicatrice, Dérive, Allant vers, Transhumance, Au large de, pour n’en citer que quelques-uns) comme dans les textes eux-mêmes. Ainsi peut-on lire ces mots, dans le premier d’entre eux :
« Je voudrais arriver.
Je voudrais être de retour
quelque part
rien qu’une fois. » (Racines)
Ou ceux-là, qui ne sauraient être plus explicites :
« Je sais d’où je viens
Je suis d’Expatrie » (Mon pays)
Ou encore ceux-là, que l’on trouve à la fin de l’ouvrage :
« Ce que dépayser veut dire » (Revenir)
Ce sentiment du « déracinement » est moins d’ailleurs celui d’une souffrance explicitement exprimée, qu’une nostalgie lancinante des « racines désenlisées » qui « cherchent fleuve tranquille pour y flotter. » Une douleur existentielle qui, travaillant à « exhumer ce qui n’est pas », le convertit en oraison au monde, en ode au « pan de jour » que le soleil embrase, aux mouettes qui, « comme des frondes / tournoient leurs cris poivrés », ou à « la lumière des blés ».
Et il faut croire que la poésie est quelquefois remède au métier d’exister. Qu’elle peut être le pays où le déraciné, s’arrimant aux mots du langage, y trouve les outils pour assurer sa quille et sa ligne de flottaison. La dérive devient alors dans les eaux du poème, « allant vers et autres escales », ce qui révèle de l’endroit (que l’on peut entendre à la fois comme lieu de transposition d’un intime tourment et remise en place des choses) où l’on se donne le devoir d’aller « pour se tenir au large », c’est-à-dire loin de ces rives où, comme l’a écrit Rimbaud, « on ne peut, sur son front, qu’essuyer la suie des jours sombres. »
Les mots de la poésie de Colette Daviles-Estinès sont ceux de ce chemin qu’elle suit en silence, un silence où l’on voit que « quelque chose pourtant est en train de se faire. » Et si elle-même se demande ce qui se joue dans la lumière, « c’est lourd, c’est léger – je ne sais pas », nous savons, à la lire, que c’est vers la légèreté de l’âme que ses pas cherchent à la conduire, en tous les cas vers quelque chose qui nous allège aussi de notre pesanteur de vivre, et qui est « comme recueilli ».
Nous avons bien saisi ce mot dans son acception de « recueillement », mais si l’on veut, ici encore, jouer avec les mots, nous pouvons redonner tout son sens aux termes de « recueil de poésies », puisque celui-ci est un livre où tout ce que l’auteure avait de plus sensible et de plus précieux à transmettre y a, en effet, été « recueilli ». Il ne nous reste qu’à la recevoir avec toute l’attention nécessaire à ce qui nous est offert en partage.
Michel Diaz, 03.10.2016

Merci infiniment Michel pour ton regard.