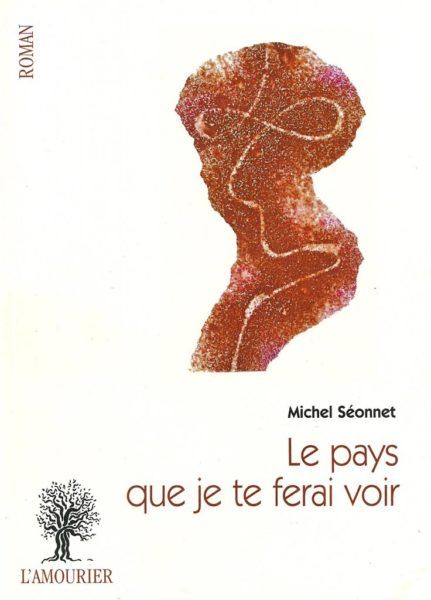
LE PAYS QUE JE TE FERAI VOIR – Editions L’Amourier, 2014
Michel Séonnet
Roman lu par Michel Diaz – Chronique publiée sur le site des éditions L’Amourier et dans la revue L’Iresuthe, N° 33.
En ces temps où nous apparaît tellement urgent et indispensable de jeter des ponts par-dessus la mer Méditerranée, de s’appliquer à relier ce que les cultures d’ici-là-bas ont de plus précieux à s’offrir, de travailler aussi à rappeler quelques épisodes assez honteux de notre histoire coloniale, de dénoncer encore ce qui contraint, sur l’autre rive, les migrants clandestins à s’embarquer coûte que coûte pour atteindre la nôtre, certains livres, comme celui-ci, s’octroient pour tout cela le discret mais utile pouvoir dont peut user l’acte d’écrire.
Mais un ouvrage vaut, déjà, par le choix des termes qui l’inaugurent. Le pays que je te ferai voir, c’est d’abord cela que promet de faire, en son futur de certitude, le titre du récit de Michel Séonnet.
Et se pose d’emblée l’énigme des pronoms. Qui est ce « je » qui parle ? Et à qui parle-t-il ? Est-ce l’auteur à son lecteur que ce « te » désigne et implique ? Ou son héroïne à nous-mêmes ? Ou ce personnage à un autre ? Et dans ce cas lequel, et auquel des autres s’adresse-t-il ?… Et de quel pays s’agit-il ? Est-ce un pays réel ? Un lieu imaginé ? Et quelle sorte de voyage nous est-il proposé de faire ? Pour quelle découverte ?…
Ainsi sommes-nous, dès le seuil de ce texte, pris d’un léger vertige. Grâce d’un titre, en tous points magnifique, formulation d’un mystérieux sésame, appel, invitation à on ne sait trop quel inconnu, car nous voici, déjà, soumis à la question du lieu et confrontés à la transmission d’un savoir dont, apparemment, jusque là, nous étions ignorants. A quelle réalité géographique du monde avions jusqu’à lors échappé, ou dans quelle contrée de l’imaginaire se propose-t-on de nous emmener ?… Force est de constater, pourtant, que dans ces quelques mots, initiales majeures du livre, se pose comme un bruissement la voix nocturne du conteur, une voix qui ferait écho à celle, confidente, des Mille et une nuits, ou à celle qui nous conduit dans les merveilles du pays d’Alice.
Mais entrons dans ces pages. Une femme, Louise, propriétaire d’olivaies dans le sud de la France, essaie de retrouver les traces de son père, Louis, adjudant de la coloniale pendant la guerre d’Indochine, capturé par le Vietminh, mort vraisemblablement lors d’une tentative d’évasion, selon la version officielle. Père dont le retour, espéré d’abord par l’épouse, malgré le temps et les années, n’a laissé dans l’esprit de l’enfant, grandie dans cette interminable attente, que la blessure ouverte à l’éternelle absence, un attachement passionnel au souvenir du disparu: « Pas un anniversaire de la mort supposée de son père où Louise, avec force cris si nécessaire, chantage, pleurs, n’imposait à la mère de monter au village pour un dépôt de fleurs au monument aux morts et une messe ensuite. »
Mais pourquoi avoir tant tardé à entreprendre cette enquête, et pourquoi la conduire au Maroc près d’un demi-siècle plus tard, plutôt qu’en Indochine sur les lieux de la disparition ? Il reste, certes, sur la terre marocaine, personnages fantomatiques qui prendront peu à peu consistance, quelques survivants d’un lointain passé, anciens goumiers de cette compagnie que commandait le père, évadés peut-être avec lui et témoins supposés de sa mort. Mais qu’ont-ils maintenant à offrir à Louise, sinon une mémoire défaillante pleine d’images indécises, des souvenirs plus que confus, sinon contradictoires, une lettre illisible, une photo douteuse et des versions invérifiables de la survie de l’adjudant ?… Ainsi, très vite, le livre instaure des « trous noirs », matière opaque où gisent toutes certitudes, deux femmes, deux amours que sépare une mer, deux reflets de miroir dans lequel se reflète le même, époux et père déserteur ici, ancien soldat remarié là-bas, mais deux images qui, jamais, ne peuvent correspondre pour y donner à lire les traits d’un unique visage. Y aurait-il aussi deux hommes et entre ces deux-là lequel est le vrai père ?… Dans ce faible écheveau de preuves qui, de l’une à l’autre, en s’entrelaçant se défont, vérités qui pâlissent à mesure que l’on avance, il y a quelque chose qui s’apparente, se superposant à la quête de Louise, tous les éléments d’une énigme que l’on qualifierait presque d’enquête policière, si ce n’était qu’elle est conduite par le seul désir de lumière et les exigences du cœur.
En vérité, dans ce roman, et c’est le tour de force de l’auteur, il n’y a aucune contradiction entre les différents degrés de la réalité (géographique, historique, d’aspect documentaire, presque ethnographique parfois ou d’allure fantasmatique), comme il n’y en a pas non plus entre le réalisme des situations et le ton qui convient aux conteurs, ceux-là qui, comme ils le faisaient jadis, ici, à la veillée, ou là-bas sur les places publiques, se plaisaient à débobiner le fil de leur imaginaire et à lui laisser libre cours.
Réalisme, disais-je, de nature « documentaire » avec l’évocation du conflit d’Indochine, les détails de certaines opérations militaires, les conditions de détention des prisonniers du Vietminh, ou encore l’évocation on ne peut plus expressive de tel village marocain, l’entrelacs des ruelles étroites de la médina, la scène intime d’un repas, les routes des montagnes ou les chemins et champs noyés de cette boue visqueuse qu’ont laissés derrière eux les passages des pluies torrentielles… Mais quoique étroitement intriqué dans ce matériau narratif, et en scellant les fondations, dès les premières pages du récit se détache le ton singulier du raconteur d’histoires: celui qui, sans forcer la voix, passant d’un lieu à l’autre, et remontant le temps d’un moment de l’histoire à un autre, maintenant provisoirement une action en suspens pour reprendre le fil d’une autre, abandonnant son personnage là pour le reprendre ailleurs dans des lieux et temps différents, plus tôt, plus tard, mais aussi déplaçant les repères qui balisent la quête, les détruisant parfois l’un contre l’autre en les confrontant ou les exposant à trop de raison, brouille les pistes et fait de la réalité concrète cette évidence insaisissable et ouverte à tous les possibles, comme l’est tout autant le matériau du rêve ou de la songerie. C’est cette liberté, que s’octroie le conteur, qui donne à ce récit, composé de séquences brèves et qui pourrait sombrer dans le désordre entre les mains d’un moins habile, cette sinueuse envolée de musique polyphonique dont on sait que dans ses détours et son avancée en ellipses elle suit la ligne secrète qui la mènera au bout d’elle-même.
C’est cette liberté que, logiquement, on retrouve dans l’écriture même, dans la manière qu’a l’auteur de poser les mots sur la page, belle écriture souple, fluide, à la syntaxe bousculée souvent, et on serait tenté de dire désarticulée, si ce n’était que de la longueur de ces phrases (qui relève parfois de l’exploit), on peut voir s’élever comme un long ruban de fumée se déployant en arabesques, comme un appel de muezzin ou comme un chant de flûte lancinant qui vous saisit au cœur et vous envoûte. Ainsi commence et se déroule par exemple celle-là, « Ses pieds s’enfonçaient dans la terre fraîchement labourée, chaque pas semblait en faire remonter une odeur obscurément ancienne mais que le labour avait en quelque sorte rétablie dans une jeunesse perpétuelle, vitalités enfouies qui reprenaient vigueur au simple contact de l’air et desquelles (mais ce n’était peut-être qu’une illusion) émanait une humeur doucereuse, charnue, halo comme en diffusent ces plantes que l’on dit aromatiques (thym, marjolaine, centaurée) et pour qui l’odeur n’est en rien un plaisir, une sorte de joliesse dont elles agrémenteraient leur présence, mais une barrière de défense, un bouclier, une cloche d’humidité qui les met, tant faire que se peut… », phrase qui s’achève dix-huit lignes plus loin et qui, dans l’enivrante évocation des sensations diverses éprouvées par Louise, ne peut que nous transmettre, à nous aussi, lecteurs, ce sentiment de « formidable allégresse » qui s’empare d’elle à ce moment-là. Allégresse qui prend sa source dans ce que nous promet le titre, disions-nous, où dans « ce que je te ferai voir » tient déjà tout ce qui fera basculer le destin de ce personnage.
Je parlais plus haut de musique parce qu’il y a dans ce texte, construit comme une partition, un exercice continu d’allègement, un appel à l’élévation comme dans un stabat mater, un exercice d’exorcisme du passé qui conduit Louise à lentement se dépouiller de ce qui, au départ, constituait le premier objet de sa quête. Et survient un moment de partage du temps où quelque chose dit qu’il est déjà trop tard: « Tous ces mots sortis de la bouche du vieil homme étaient pour Louise comme des feuilles qui s’envolaient d’un arbre. Il aurait fallu qu’elle coure pour les rattraper […] Mais c’était trop tard. Elle était venue trop tard, trop vieille , pour que la confirmation des faits qui avaient obsédé sa vie puisse de quelque manière lui apporter apaisement. » Trop tard pour tout ?… Rencontres et partages jalonnent ce récit, comme, entre autres, ceux que fait Louise avec Ali, l’ancien goumier, compagnon d’armes du disparu, ou avec le père Adolphe, ce prêtre entièrement voué à la mission de soigner les migrants rescapés des naufrages en mer. Je citerai ici Marie-Jo Freixe qui rend ainsi justement compte de cette inattendue et ultime bifurcation dans le cours du récit: « Peu à peu, la recherche du passé perd de son urgence, le présent s’impose et ce sont d’autres situations douloureuses de perte, de disparition qui apparaissent. Le texte se fait alors politique dénonçant par la voix d’Ali: « Passeurs, recruteurs, tous les mêmes ceux qui sont venus nous chercher pour l’Indochine, ceux qui sont venus nous chercher pour les usines, et ceux qui viennent maintenant chercher nos fils à prix d’or pour des rêves inaccessibles. »
Si le texte se fait politique, il se fait aussi, à coup sûr, chemin d’initiation et de révélation. Et, en effet, c’est au contact de ce pays, et tous sens confondus, exaltés, de ses couleurs, de ses parfums, de ses saveurs et de ses bruits, comme aussi dans l’approche des gens qu’elle y découvre, dont font partie le père Adolphe et tous ceux-là encore, assiégés de détresse, et ce petit enfant que sa mère a porté valeureusement à travers le désert, jusqu’à mourir d’épuisement, ce tout petit garçon, baptisé Louis, bébé encore (ce fils qu’elle n’a pas eu) dont l’existence, tout comme jadis la sienne, s’ouvre sur la misère de l’absence, que Louise confrontée à d’autres dimensions du monde et de l’humanité se déploie en une autre dont l’éclosion éclate brusquement en musique de fête et de vie: « Déjà les cantiques fusaient au rythme des percussions africaines. Le petit Louis à nouveau dans ses bras, la danse continuait. La djellaba blanche bien trop grande pour l’enfant leur faisaient comme une traîne. »
Il est des livres qui, au contact de la tragédie du monde, projettent des clartés, lumière vacillante mais obstinée qui veille dans les âmes de bonne volonté. Le roman de Michel Séonnet fait partie de ceux-là, qui nous apaisent pour un temps de la douleur humaine, ouvrant la porte sur un horizon de collines lointaines dont il est nécessaire de croire que les vieilles forêts amies qui recouvrent leurs crêtes ne seront pas, elles aussi, brûlées au feu de la désespérance.
Michel Diaz