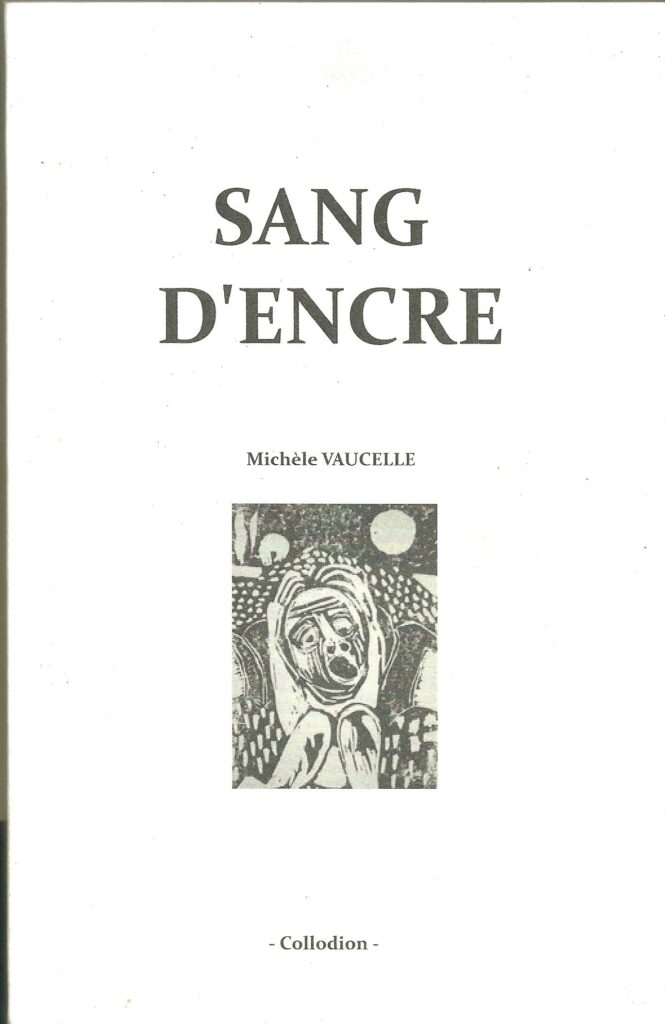
SANG D’ENCRE, Michèle Vaucelle
Editions Collodion, 2019
Chronique publiée sur le site des éditions Collodion et publiée dans Diérèse n° 79, automne 2020
Déglutir le monde
Récemment publié aux éditions Collodion, ce beau livre sur beau papier, remarquablement mis en page, réunit l’essentiel des poèmes de Michèle Vaucelle, illustrés par six linogravures de l’auteure, gravures d’une grande force expressive, figures torturées, souffrantes et hurlantes, aux limites du supportable. On lit, dans ces pages, ces mots, qui en semblent le commentaire : Pourquoi / faut-il / que ces / visages / absorbent / la douleur ? On peut y ajouter ceux-ci, qui répondent au même désir de questionner la matière même de l’être, Ce qui te / mange / la chair / De l’intérieur / Quand tu ne peux / plus rire / Quand
Si M. Vaucelle écrit, peint aussi et dessine, il est bien difficile de séparer ses textes de ses travaux d’artiste. Cet ouvrage a le grand mérite de les réunir pour nous mieux montrer combien ces deux aspects de son activité fusionnent dans le même creuset créatif, faisant jaillir du même contenu des formes d’expression différentes mais originalement conjointes. Quelque chose de radical et qui ne se soumet à aucun compromis esthétique ni à aucun souci d’émouvoir ou de plaire, ne cède en rien non plus à une brutalité poétique « mal dégrossie » (en tout cas bien peu en usage chez les « bien-écrivants ») qui ne réclame que d’épandre sa coulée de lave, caillots de mots et concrétions de phrases jetés sur le blanc de la page comme on se fait vomir en enfonçant ses doigts en fond de gorge : Il y avait de la matière / Des mots / En bandoulière / Un exutoire / Pour la mâchoire // Sous les coups de boutoir / Et les crosses / La tête fulminante et féroce / Eclate enfin.
M. Vaucelle a d’abord été tentée par l’écriture, et elle écrit depuis longtemps ce qu’elle n’ose pas appeler des « poèmes » (on se moque d’ailleurs de savoir s’ils le sont), mais des textes qui s’imposaient dans leur nécessité. Si elle « griffonnait » déjà, comme elle dit, parlant de ses dessins, ce n’est que bien plus tard, il y a une dizaine d’années, qu’elle s’est mise à la peinture, comme on se lance à l’aventure.
Et, en effet, c’est bien d’une aventure qu’il s’agit puisque M. Vaucelle, pure autodidacte, n’a jamais reçu aucune formation artistique, ni suivi aucun cours d’histoire de l’art, ni jamais fréquenté non plus le milieu des artistes. Ce qu’elle fait et ce qu’elle a appris, c’est (en dépit des regards sceptiques et effarouchés par la violence de ce qu’elle montre comme par sa manière d’expressionnisme souvent poussé jusqu’à la plus complète défiguration), en se confrontant humblement aux matériaux du peintre, d’abord « des toiles bon marché, des pinceaux et des tubes de premier prix, n’importe quel support utilisable, des morceaux de drap, des papiers peu coûteux, du carton ou de l’isorel ».
Si le désir de peindre a, aujourd’hui, pris le dessus, écrire et peindre, nous l’avons déjà dit, ne sont pas vraiment séparables dans la démarche de M. Vaucelle, et les relations évidentes qui s’instituent entre ces deux pratiques, quand on considère l’ensemble de son travail, permettent de voir que la peintre s’efforce de mettre en images les éclats de vie intérieure que propulsaient ses mots, tandis que la poète se tient, elle, dans le retrait, mais continue de lui dicter les lignes de force et les obsessions qui s’expriment dans ses peintures. Il suffit, pour s’en convaincre, de reprendre ses mots : « Les mots brûlent / Et me bousculent/ Tout ce qu’il y a / A l’intérieur/ Avec ce rien cassé/ Déglutir.
On ne pourrait dire les choses avec plus d’évidence. Derrière le cri / L’effroi. Les premiers mots de ce recueil en donnent d’emblée la couleur, celle d’une présence au monde qui, plus que désarroi, se révèle en effet panique et effroi : C’est / Le début / De ça qui meurt (…) Le début / C’est / Je suis / Dans mon chaos / Je ne vais pas devant / Ma tête est à l’envers / Je ne vais pas derrière // Et je ne sais plus rien.
Désarroi et effroi liés à la nécessité de s’arracher à la matrice originelle pour être jetée dans un monde de violence, toujours en guerre contre les vivants et contre la vie même, arène de la lutte du tous contre tous, de soi contre soi-même, où la mort programmée d’avance, la peine à exister et les cris sans réponse jetés vers un ciel vide ne laissent que bien peu de place à l’espérance de quelque lumière : Il y a bien longtemps quand j’étais en ton centre et tu me nourrissais Il y a bien longtemps j’ai oublié Les mots j’étais là-dedans recroquevillée les mains sur la tête pour ne pas avoir mal au monde / Octobre on allait bien faire quelque chose […] Avec ce rien cassé on allait bien faire quelque chose…
Rien d’autre à faire, dans un premier temps, et face au désastre de naître, qu’imaginer le Glissement (de) / Tous ces os / Et l’en-dedans / Çà grouille / Çà rouille / La couronne / Les dents mangent les yeux / Et l’en-dedans // La chair coule / Et l’à-côté […] Ce cerveau / En marche / Bidouillé / Barbouillé / Arraché de nulle part / Et les ongles / Et les yeux / Et les côtes / Par-dessus / AVEC / Plein de petites / Cases / Et des cils un peu partout.
Rien d’autre à faire, puisque nous sommes morts d’avance, le crâne déjà plein de vent, qu’interroger son corps et sa pensée, écrit l’auteure, et que Là où ça grouille / La tête / Dans mon ventre / Là où j’ai peur / Là où j’ai mal / Je creuserai sans fin ces enchevêtrements. Puisque, dit-elle encore , Je ne fais que passer / Et je hurle et je peins / Et tout est éphémère.
Peindre et écrire donc. Et rien d’autre à faire non plus que « Déglutir le monde », et ce sont là les mots empruntés à un poème de M. Vaucelle : « Déglutir / le monde / Tout est là / Au bout de ce tuyau / Radical / Avec les mêmes maux / Recommencer / Progression / lente / Et douloureuse / De la bouillie / Glissement / Œsophagique / déglutir »
Oui, tout est là, peut-être, au début, dans ce mouvement de la gorge pour avaler un peu de l’air et de la matière du monde, comme on le fait pour sa salive, une déglutition qui ne va pas de soi. Déglutir le monde et le digérer, douloureusement, et le restituer dans l’urgence des gestes, l’élan des émotions, les nœuds de l’oppression, mais s’il le faut aussi dans le spasme du haut le cœur et le vomissement ou, au bout de sa digestion, dans ce qu’en auront fait les obscurs et interminables méandres de nos intestins.
Lignes de forces, disions-nous plus haut, et obsessions que les images de l’artiste mettent en scène avec la même obstination et la même vigueur qui s’autorisent, dans son écriture, à ne s’embarrasser ni de trouvailles et d’effets de style, ni d’affectation poétique : Là où j’ai peur / Là où j’ai mal / Je creuserai sans fin / Et je me fous de ce que l’on peut dire / J’écris que la mort me fait peur / J’écris que mes mains sont en pleurs / Que l’Amour me fait rire / Que le monde est en guerre.
M. Vaucelle, poète d’un « art brut » (comme on le dit dans d’autres domaines de l’art) par nécessité existentielle (donc artiste authentique), fait aussi partie de ces peintres qui n’installent entre la main, le pinceau, la toile, tout support qu’elle emprunte, aucun intermédiaire. Ni caches, ni pochoirs, ni bombages, ni papiers ou tissus rapportés, collés, cousus, ni aucuns matériaux intégrés aux tableaux (ou si peu !). Si peu d’intermédiaires que c’est parfois la main qui dépose à doigts nus les couleurs et les triture sur la toile. Son travail d’artiste, comme son écriture, font peu de place au compromis, au souci de séduire, mais ne sont qu’élans successifs de survie comme on se tient, debout, au pied du mur et tient tête à l’inéluctable, comme à la peur, malgré la peur, on fait une grimace et on adresse un bras d’honneur : J’ai la tête à l’envers / Mot à mot / Il faut tout retourner / Changer le sens / Et dans le déchirement / Que vienne la peau / La chair avec / Que s’arrachent les masques.
Les toiles, en ce qui la concerne (ou les divers supports qu’elle utilise, papier, isorel, bois, canevas), s’apparenteraient aux murs d’une maison mentale sur lesquels seraient projetés ses visions intérieures et ses traductions subjectives des choses, des images fantasmatiques, des scènes qui emprunteraient à la fois à ce qui ressortit de ses obsessions personnelles et des image déformées d’une réalité dont elle sait qu’elle peut adopter des apparences incongrues, caricaturales, grotesques, quelquefois monstrueuses – et dont les contours équivoques, les traits forcés, les expressions hagardes de ses personnages, pourraient s’apparenter à ceux de la folie, ou en tout cas à ceux des phénomènes hallucinatoires.
Ses peintures sont ces murs que M. Vaucelle transporte avec elle, des murs dressés à la frontière de deux mondes, également hostiles, des murs qui ne séparent l’intérieur de l’extérieur que pour mieux souligner ce qui, de l’un à l’autre, s’interpelle pour se confondre quelquefois en un. C’est là aussi que s’abolissent les distances entre le peintre et son tableau pour ne laisser place qu’à un inventaire de visages crépusculaires, à un champ de ruines d’humanité au milieu duquel elle avance : Plus rien / Je ne sais pas si c’est le vide / Ou si c’est la mort / C’est comme une boule à l’estomac / Tout au fond de la gorge j’ai mal ça gratte / Ça racle je saigne / Et je crache mon sang et ma salive / (…) Il fallait que je montre ce que je suis en somme / Ce qui me bouleverse ou me révolte / Que je vomisse enfin.
M. Vaucelle se tient donc , en ses peintures, dans cet espace intermédiaire, cet « espace de flottement » (ce sont les mots qu’employait l’auteur dramatique Arthur Adamov pour parler de son propre théâtre), pas no man’s land déshabité, mais territoire d’entre-deux, de rencontre et d’affrontement, où se retrouvent convoqués, en même temps, le matériau sensible de l’imaginaire onirique, de la douleur la plus intime, et celui d’un réel social, puisé à la réalité concrète de la vie, comme aussi, on ne peut en douter, à la réalité clinique ou psychiatrique qui en fait tout autant partie. En cela aussi, les œuvres de M. Vaucelle relèvent d’une profonde humanité, et ce qu’elle y montre de plus pathétique ne fait toujours, obstinément, que nous renvoyer à nous-mêmes, à notre solitude et à notre misère d’humains, à ces semblables que, peut-être, on serait tenté de haïr, mais au signe desquels on répond, que l’on aurait envie de tenir aux épaules et, pour reprendre les mots de César Vallejo, « de les serrer entre (ses) bras, tout contre (sa) poitrine, ému, ému, jusqu’au sanglot ».
Aussi, cette peinture, tout comme son écriture, sont-elles indifféremment cette scène, espace « d’entre-deux », comme nous l’avons dit, où sont représentées, dans une même « mise en scène », les deux versants d’une réalité, intérieure, extérieure, que l’on a coutume de séparer, par facilité, mais qui sont, se superposant, les deux aspects de ce rapport au monde qui composent la réalité totale de tout individu. De son combat pour exister, simplement exister, tenter de vivre un peu plus haut que tout ordinaire désespérance. Cela que disent les derniers mots du livre : A éprouver // Voilà je me dissous / Perdre la face / Et puis / Gratter reformer déformer / Renoncer rompre le lien / Chercher creuser frotter et assaillir / Retournée détournée / Trouvée / Par là / Là où ça meut.
Michel Diaz, 21/12/2019