Note de lecture publiée dans Diérèse, N° 77, automne-hiver 2019
Passants, Antoine Emaz (Editions Unes, 2017)
Les nuits échangées, Raphaële George (Editions Unes, 2018)
Voilà deux livres achetés en même temps, il y a quelques mois, aux éditions Unes. Deux petits livres très soignés, sur beau papier, à la belle impression, comme les éditions Unes savent les faire, et contenant chacun un texte court (7 pages pour le premier, 14 pour le deuxième), composés de vers brefs, quelques-uns seulement par page, petit verre d’alcool à haut degré.
Choix de l’éditeur (certainement), coïncidence intéressante (ou effet du malin hasard) ? Il se trouve, en tout cas il me semble que ces deux poèmes fonctionnent, en vis à vis, comme les panneaux d’un diptyque, semblent dialoguer l’un avec l’autre, et se faire écho ou réponse.
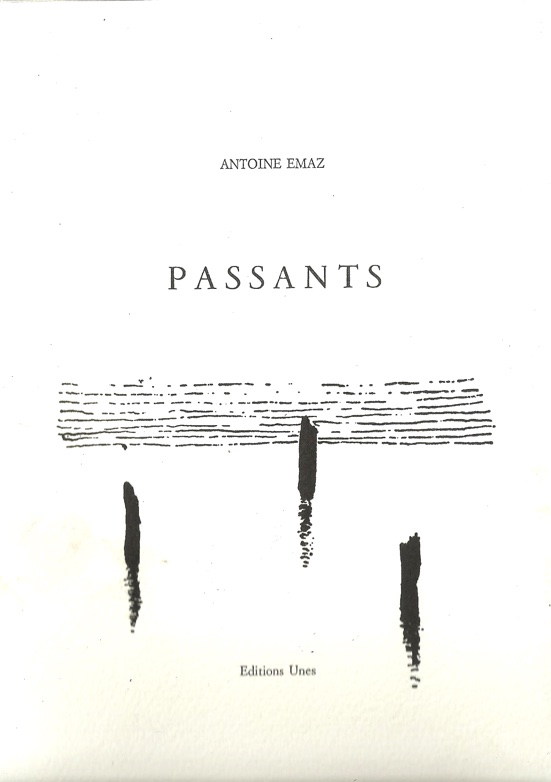 Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.
Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.
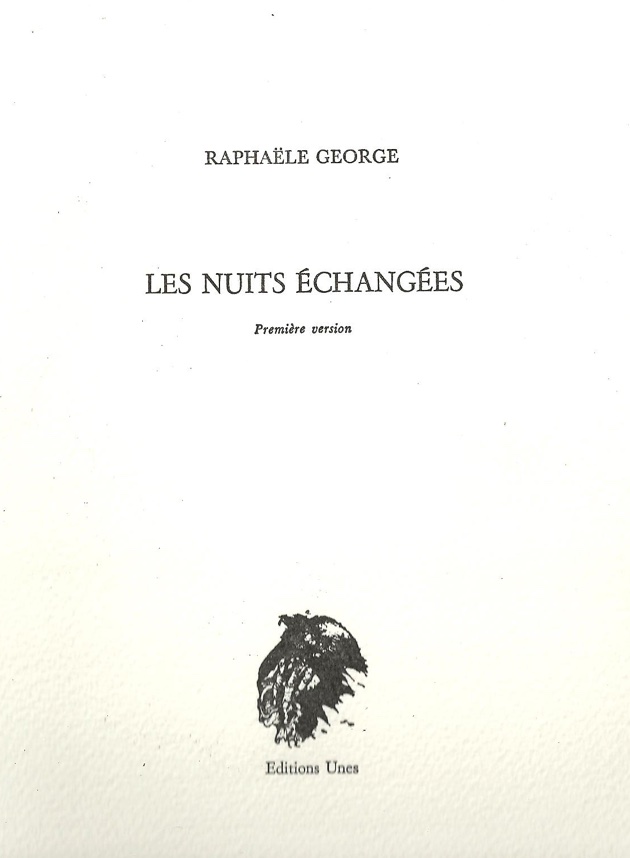 Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.
Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.
Lassitude qu’on sent au bord de la désespérance, qui n’est pas pour autant renoncement à vivre, mais traduction d’une fatigue existentielle, cette sombre mélancolie qui s’empare de l’être quand il est pris dans cette errance où passé, futur et présent s’alignent sur le même front d’incertitude qui dicte aussi à A. Emaz ces derniers mots : qu’est-ce qu’on en sait/au fond de l’œil/de la tête dans l’œil/et les vagues et le vent//on ne sait plus//sans avoir peur.