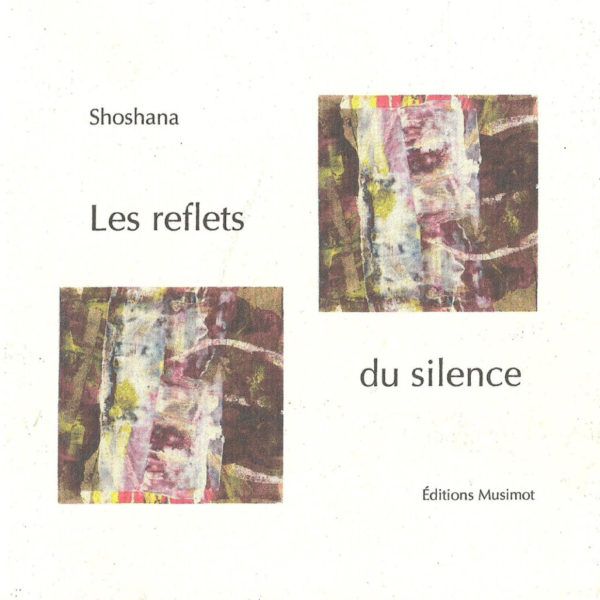 LES REFLETS DU SILENCE
LES REFLETS DU SILENCE
Shoshana
Editions Musimot (2017)
Chronique publiée dans le numéro 50 de Chemins de traverse.
Voilà un bien joli petit livre, publié par les éditions Musimot qui nous proposent, cette fois encore, un enchantement de lecture. Mais Monique Lucchini, qui dirige cette maison, sait-elle faire autre chose que de beaux petits livres ?
Voici comment commence celui-ci, par ces mots que l’on pourrait croire adressés aussi bien à nous-mêmes qui les lisons :
« toutes les rivières ont leur écriture
que lisent les oiseaux
et à l’instant où le vent mâche la pluie
des mots te poussent sur le corps
comme des plumes »
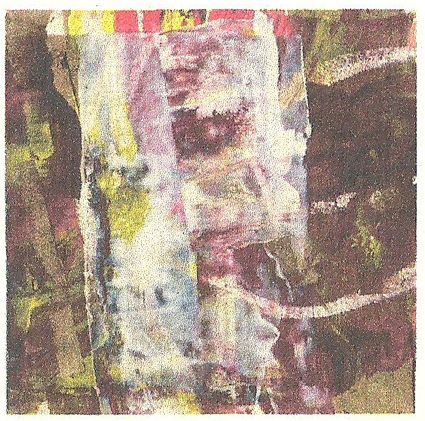 Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. »
Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. »
Dans cet opuscule, Les Reflets du silence, l’auteure, Shoshana, a aussi semé les illustrations qui se font les complices du texte. Si bien que l’on ne sait si ce sont les mots qui se posent sur les images, les couleurs sur les mots, tant les uns et les autres semblent consubstantiels. Mais pour mieux évoquer leurs accords, il faudrait parler de musique, des mots, des yeux, du sens. Et celle qui semble conduire l’écriture de ce poème, en écho réciproque des peintures qui l’accompagnent, nous invite à prêter l’oreille, non pour l’entendre mais pour l’écouter.
Car la musique, ici, est bien ce qui définit sa nature d’art immatériel, « juxtaposition de couleurs sans nom » et de « parfums insaisissables« , cette éclosion de « formes infinies » qui ne fait qu' »enrouler ses structures« , ce mouvement arborescent ou « le temps glisse sur lui-même » en « polissant les grains d’instants« . Elle est cette « toile mouvante » en expansion discontinue, cette « architecture en fusion » qui construit son « château de sable ruiné » dans les intervalles du temps, au rythme de la voix, dans ses couleurs liquides. Musique de la langue aussi est celle qui rejouant « sans cesse sa précarité » n’existe que plus fortement par les silences qui l’irriguent dans ses profondeurs.
Ce texte qui cherche à fixer, par instants, ce qui des mots comme des gestes, surgit à l’improviste des images, envol de « rêves contagieux » dans la « trace des lettres« , s’essaie à capturer la voix de l’indicible qui s’exprime dans le vent, la vague, les reflets de l’eau et les dessins de la lumière. C’est un texte dont les mots tremblent au moment où l’auteure les pose sur la page, comme tremblent les fleurs au bout des tiges qui les portent. Ils ont ce tremblement de qui, dans sa fragilité, cherche sa juste place dans l’éphémère du concert des choses, exister pour mieux disparaître. Comme s’effacent, dès que perçus, le geste de la danse, l’inflexion de la voix, le mouvement qui porte le pinceau, toutes choses dont cependant nous conservons la trace vive.
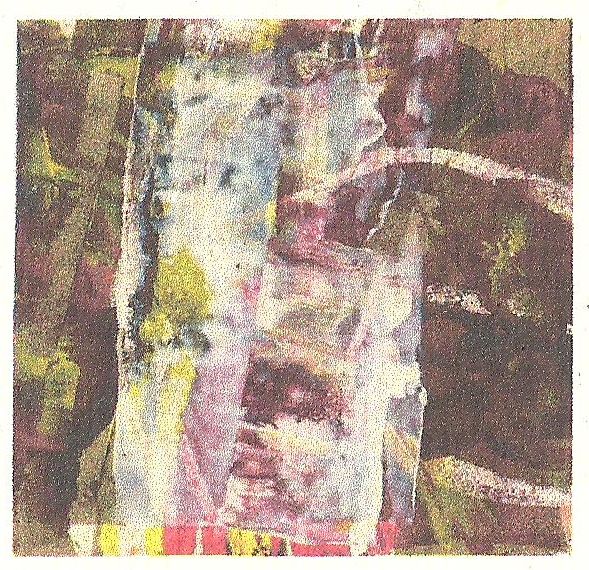 C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.
C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.
Les ombres convoquées ici, ce sont les morts, présences silencieuses qui nous accompagnent. Pas vraiment silencieuses car « ce qu’ils disent est bruyant mais ne s’entend pas« . Si nous ne les entendons pas, c’est encore que « la lumière refuse de graver leur message en relief / sur la peau du monde« . Et pourtant la frontière est bien mince avec ce qui se tient de l’autre côté de nos sens usuels, que nous ne pouvons ni voir ni entendre, signes indéchiffrables que l’on nous adresse de l’au-delà, mais dont l’approche poétique nous donne l’intuition en se tenant aux marges du silence, en limite de mots et de compréhension, dans l’indicible d’un réel que nous devinons infini. A ce moment du texte surgit, plus fort, ce qu’il nous faut bien appeler l’émotion du sacré. Et c’est cette notion (qu’il ne faut pas laisser en privilège à ceux qui s’en désignent les représentants et s’en font les dépositaires jaloux) qui donne vraiment sens au monde et à ce que nous en savons. Nous justifie dans nos désirs d’en appeler à ce qui nous dépasse et fait que quelquefois, saisis par la beauté mystérieuse des choses, « nous ruisselons de larmes / plus anciennes que nous« .
Nous tenons là un texte d’un lyrisme limpide, précis et retenu. Chaque mot, poussant l’autre, dans une « intensité tendue », et comme posé là, sur le fil de la voix, y est à sa place comme si le lecteur devait l’entendre pour la première fois.
Le poème de Shoshana allume entre ses lignes une lampe discrète sur le moment du temps où nous le découvrons, et sur nous-mêmes. Oui, René Char avait raison d’écrire que « certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire« .
…
Michel Diaz, 28/02/17