ENQUETE SUR UN POETE DISPARU – Jean-Jacques Mahet
Chronique (version mise à jour) publiée dans Diérèse N° 77, automne-hiver 2019
» Comment, frères humains, ne pas vous dire que je n’en peux plus . «
César Vallejo, Poèmes humains
Je m’étais proposé, il y a quelques mois, d’aider une amie à déménager la maison qu’elle venait de vendre. M’échut la tâche délicate de vider deux armoires remplies de livres pour en faire un rapide inventaire et décider de leur destination : ceux qui n’étaient bons qu’à être jetés, ceux qui échoueraient chez un bouquiniste, ceux enfin qu’il fallait conserver. C’est au cours de ce tri hâtif que je tombai sur un livre en piteux état, tranche à moitié déchiquetée, couverture tachée d’auréoles brunâtres, traces de café renversé ou conséquences d’un séjour ancien dans un lieu exposé aux affres de l’humidité.
C’était un recueil de poèmes, intitulé P o è m e s d u silence , œuvre d’un dénommé Jean-Jacques Mahet, un auteur dont jamais je n’avais entendu parler. Il avait été publié, en 1976, aux éditions josé Millas-Martin, aujourd’hui disparues (leur fondateur, éditeur des poètes de la Beat Generation en France, est mort en 2011), mais dont on sait, pour peu que l’on s’intéresse à la poésie, qu’y étaient publiés des poètes comme Roger Arnould-Rivière, André Laude ou Edmond Humeau. Feuilletant cet ouvrage, distraitement d’abord, me contentant de lire quelques vers ici et quelques autres là, je découvris, par bribes, ce qui méritait que l’on s’intéresse à cette écriture. Ces quelques lignes, par exemple :
Ma main passe comme un poisson / chavirant de la paume / comme pour mendier / un peu de douceur / un peu de douceur / et beaucoup de vérité […]
Ailleurs, encore, et toujours au hasard : J’aime l’extérieur des fêtes / là où les lumières meurent / et où l’ombre est toujours la même/ quelle que soit la joie des hommes / là où l’on a attaché les mules / qui s’ennuient se lèchent / et dont les vulves remuent […]
Et puis ceci encore : Le rossignol prisonnier de la glace / chante un chant tellement froid / que le cœur se fêle / au milieu de la nuit// un homme qui s’est perdu / cherche dans la nuit hostile / la flamme d’une bougie / un signal humble de reconnaissance / parmi les grandes épaves noires […]
Ou encore cela : Je suis nu dans la maison vide / mon sexe est dur / comme un poignard sans main pour le brandir / comme un poignard sans cœur où s’y plonger / courbe avec a u bout le rubis du gland / en forme de cœur renversé […]
Je pris alors le temps de lire quelques pages, me rapprochant d’une écriture aux qualités certaines, y découvrant des textes d’une belle matière, sombres et tourmentés, où l’on peut déceler çà et là les influences du surréalisme, poèmes de la solitude, transpirant de désespérance, mais chaque fois teintés de l’humour noir de l’autodérision dans lesquels on peut deviner aussi (quand cela n’est pas explicite) un penchant certain pour l’alcool.
Je mis l’ouvrage de côté et l’emportai chez moi pour le lire dès le soir même. Et la lecture que j’en fis ne fut pas moins que bouleversante. Voilà un court poème, à la désinvolture douloureuse, pour illustrer ce que je viens d’écrire; il s’intitule ironiquement « Nirvana » : Les mots me manquent / et ma fatigue est souveraine / je voudrais dormir sous un manteau de poussière / et que l’on me retrouve avec / deux petites bougies de Noël dans les yeux / une rose une bleu pâle / souriant comme un idiot / et que l’on me mène doucement / revêtu d’une couverture d’hôpital / vers la vieille Rolls noire / puant l’essence et le cuir moisi / vers un espace clandestin / et dont le numéro n’est dans aucun bottin
Qui est, ou qui était Jean-Jacques Mahet. Qu’avait-il écrit d’autre ? Qu’était-il advenu pour que son nom (du moins en ce qui concerne mes connaissances) ne soit plus qu’un nom d’inconnu ?… On peut, certes, estimer que son œuvre n’est pas une œuvre majeure, inscrite sur les tables de la poésie contemporaine, n’ayant ni les qualités littéraires ni l’envergure de celles d’un Reverdy, Guillevic ou Queneau… Il n’empêche que le peu que j’en avais lu (un recueil de 78 pages) m’avait persuadé que cette poésie valait la peine qu’on la lise.
Les jours suivants, convaincu que je trouverais sur l’auteur des informations éclairantes, j’ai interrogé longuement l’internet, j’y ai même passé des heures qui ont pris largement sur mes nuits… Sans rien trouver d’autre que deux ou trois entrées à son nom, des rubriques minimalistes qui ne mentionnaient chaque fois qu’une courte liste de ses œuvres, et désespérément rien d’autre. Si, tout de même, quelques minces traces : Jean-Jacques Mahet avait publié, tout jeune, un recueil chez Seghers, deux chez Millas Martin, avait plus tard collaboré à quelques revues, dont Arpa en 2009, dont le numéro 97 accueillait des poètes comme Jean-Marc Sourdillon, Yves Roullière, Jean-Baptiste Pedini, François Teyssandier, Jean-Pierre Farines, et à un autre numéro d’ Arpa en 2010 (numéro que je me suis procuré aussi, comme le précédent), qui accueillait Jean-Paul Siméon, Claude Held, Jean Rousselot, Luc Estang, Jean-Claude Renard, René-Guy Cadou, Alain Freixe ou Jean-Michel Maulpoix, où il était, comme on le voit, en excellente compagnie. Il avait précédemment publié dans la revue Strophes, en 1964, pour un hommage collectif à André Breton auquel participaient aussi des poètes comme Jean Frémon ou Luc Boltanski. J’ai alors consulté les catalogues des défuntes éditions Millas-Martin et Séghers, et entre autres revues, épluché patiemment un à un les sommaires des numéros d’Arpa, de 1977 à 2011, sans jamais trouver mention de son nom, ni d’aucun de ses textes sauf pour ce qui concerne ces deux livraisons. Et rien d’autre, nulle part : aucun article, aucune information biographique et aucune réédition, comme si cet auteur n’avait laissé d’autres traces que ces maigres rebuts si parcimonieusement délivrés. Un poète disparu, corps et biens, rayé de la mémoire, absent du paysage littéraire, englouti dans l’oubli, comme en un sarcophage pour la fin des temps.
Au cours de mes recherches, j’ai tout de même trouvé une date de naissance (1938- ), aucune de décès, brève notice enfoui dans un recoin obscur de mon serveur, et ne comportant que le nom du poète, la date mentionnée plus haut, et une liste de ses œuvres, « indisponibles ». Je suis tout de même parvenu encore à trouver l’un de ses titres, Même sang , proposé par un bouquiniste breton, installé à Morlaix, dont la boutique porte le nom du « Chat qui souris ». Il y avait un numéro de téléphone. J’ai appelé pour commander le livre, curieux de savoir s’il avait d’autres titres disponibles. Le bouquiniste pourrait-il me renseigner un peu plus sur l’auteur. Vivait-il encore ? Dans quelle région, quelle ville ?… L’homme ne savait rien. Il avait seulement trouvé, dans le grenier d’une maison qu’on déménageait à Morlaix, un carton, jusque là jamais déballé, contenant vingt livres du même titre.
Le recueil Même sang a été publié, en 1994, dans une maison d’édition qui porte le nom de « Collection Forum », mais là encore internet m’a laissé bredouille : aucune maison d’édition n’existe à ce nom, n’a jamais existé non plus… S’agissait-il d’un compte d’auteur ?… Dans les dernières pages du recueil, on trouve la liste des ouvrages publiés, que je reproduis ici et dont j’indique la date de publication: Noviciat , Ed. Pierre Seghers (1952-53) Interdit aux chiens , Ed. Millas-Martin (1964) Poèmes du silence , Ed. Millas Martin (1976) Celle aussi de ceux à paraître : Un bleu grand comme l’œil, Mauvaises eaux, Ordre du sable. Malgré mes recherches patientes, aucun de ces trois derniers titres n’a été publié à ce jour, et il y a pourtant presque vingt ans qu’ils étaient annoncés. Voilà tout ce que l’on peut apprendre sur Jean-Jacques Mahet : quelques titres d’ouvrages, quelques dates de parution, une disparition du catalogue de ses éditeurs et aucune trace de lui dans les quelques revues auxquelles il a collaboré. Cela tient de l’énigme. Mais, faute de pouvoir en apprendre un peu plus, mes supputations s’obstinent à buter sur l’hypothèse d’un mal existentiel incurable. Et/ou sur les méfaits de l’alcoolisme. Supputations peut-être fantaisistes, mais qui me sont une clé provisoire pour comprendre cette œuvre en discontinu et le silence qui les cerne.
Entre Poèmes du silence (1976) et Même sang (1994), l’écriture a changé, gagnant en simplicité et en apparente légèreté quand leur fond exprime pourtant le même désespoir et la même difficulté à vivre. Beaucoup des textes qui composent ce dernier recueil sont composés à la manière de chansons et quelques-unes de comptines ou de fabulettes, comme : Dans un jardin public / il y avait un cerisier / dont personne n’osait / cueillir les fruits / car l’arbre appartenait à tous ou : Un oiseau traverse le vide / un enfant saute à cloche-pied / dans la cour où sourit le chat/ Le ciel est bleu comme le chat / le ciel s’éteint puis le chat.
L’écriture de ces textes, dans leur ensemble, s’apparente (toute comparaison gardée) à celle d’un Robert Desnos, jouant avec les mots et les formules, les images précieuses et le langage familier, et usant parfois d’un système d’écriture emprunté au surréalisme ( « la nuit tombe sous mes paupières avec un fracas d’oiseaux morts déversés par la pluie ») et peut-être aussi inspiré par la Beat Generation. Voilà un texte, intitulé « Simple » qui donne, lui, la couleur du recueil : Rien n’est évidence / ni le couteau qui tranche / ni l’être qui s’enfouit / dans le bleu du silence / ni celui qui se bat afin d’être entendu // Le lâche et le héros / sont dans le même enfer / et si « belle est la vie » / comme on chante aux refrains / donnez – moi aujourd’hui / le plaisir immobile / d ‘être sans avenir // pierre dans un jardin/ infirme dans un square / perchoir pour les pigeons / négatif souriant / en des photos d’absence.
Texte qui fait écho, dans la distance, à celui-ci, « Manipulation », extrait de Poèmes du silence :
Je perds mon temps à vivre / je serais plus utile sous forme / de presse-papier ou sous vitrine / en gaudemiché servile et beau / m’engloutissant sous des jupes / fastueuses quel orgueil […] // je serai plus utile / sous forme de vieux livres / arrangé en coffret plein de cigarettes / perfides ou d e masques oubliés / en des malles aux rivets de cuivre […] // Je perds mon temps à vivre / et les objets ces compagnons / brillent autour de moi / comme les pierres / les belles pierres des terrains vagues
Enigme, écrivais-je plus haut ?… A moins que, tout compte fait, le poète n’ait lui-même organisé le scénario de sa disparition. Il y a, dans ce même recueil, ce texte en forme de bilan désespéré et qui a toutes les apparences d’une confession autobiographique, écrite au ras des mots et à fleur de souffrance, dans une écriture triviale plus proche de la prose rythmée que de la poésie, une écriture qui perd pied; il s’intitule « Lettre » et on serait tenté d’y voir la courbe d’un destin; à la publication de ce recueil, Jean-Jacques Mahet avait trente sept ans : C’était pour vous dire simplement / que je suis très malade / à cause que je bois beaucoup trop / et surtout parce que j’ai bu beaucoup trop / quand j’étais jeune homme / et alors je n’arrive plus à me concentrer / suffisamment pour écrire et même / que la poésie maintenant je m’en fous / complètement et même que ça / m’emmerde mais quand même pas / autant que mon boulot et la vie quotidienne /
qui sont à se foutre à l’eau tellement / c’est con et sans espoir
L’écriture, on l’a vu, ne s’arrêtera pourtant pas là. Le dernier recueil publié en 1994, dix-huit ans plus tard, Même sang , semble nous signifier, au-delà de son titre, que l’on vit dans un corps, territoire dont on ne peut abolir les frontières, mais irrigué toujours par les mêmes désirs de vie ou les mêmes venins. Désirs de vie, élan vers l’autre et vers le monde offert, il y en a ici et là pourtant, mais très vite éteints par les ombres du crépuscule et la tentation du refuge dans l’immobilité, un thème récurrent, et dans la disparition de soi-même. Ainsi, ces quelques vers extraits de ce même recueil : C’est si beau le soleil / Aussi beau qu’un femme / et lorsqu’il disparaît / on voudrait en mourir / ou inventer en soi / les saisons immobiles / de l’éternité . Ou ces vers, eux aussi empreints d’une spiritualité qui, tout à coup, lâche sa bonde : […] Un bleu profond comme un voyage / au cœur du Temps perdu / vers un ancien pays / Un bleu d’extase et de repos / à faire bander les rêves […]/ Un bleu à effacer l’oubli / l’injustice et la mort / et toute idée de dieu / Un bleu vital indescriptible / un bleu à obscurcir les cibles
Essayant d’en savoir un peu plus, j’ai écrit à Gérard Bocholier, directeur de la revue Arpa , pour lui demander s’il pouvait m’indiquer l’adresse de JeanJacques Mahet. G. Bocholier m’a aimablement répondu en me donnant « la dernière adresse connue » du poète, celle de 2009, quelque part dans banlieue parisienne. J’ai envoyé, bien sûr, une lettre à laquelle je
n’ai jamais eu de réponse. Entre temps, la première version de cet article, paru en 2015 dans une revue littéraire, avait attiré l’attention d’un lecteur (directeur lui-même d’un site littéraire numérique) qui me disait, dans un courriel, qu’il connaissait quelqu’un qui avait connu Jean-Jacques Mahet, qui le fréquentait peut-être encore, et il me fournissait quelques informations relatives à cette personne qui m’aurait permis de le contacter. J’ai donc écrit à cette dernière qui s’est avérée incapable de donner suite à ma demande. Tout récemment, en juillet 2019, un autre lecteur de ce premier article de 2015, m’envoyait un courriel où il me disait qu’il avait connu personnellement JeanJacques Mahet. « Il se trouve, me disait-il en substance, que nous étions, lui et moi, dans la même classe au lycée Paul Lapie de Courbevoie entre 1951 et 1955. J’ai des souvenirs de lui comme lycéen, qui ne présentent pas grand intérêt, hors l’échange, un jour, d’une traduction latine contre un poème improvisé… Il habitait Courbevoie et c’est peut-être là qu’on trouverait des informations sur ce qu’il est devenu. On le savait poète déjà, féru des proses de Rimbaud, et peut-être, comme d’autres, tenté de se prendre luimême pour un nouveau Rimbaud. Nous étions en seconde, je crois, quand Seghers a publié sa première plaquette, Noviciat , dont certains avaient pu acheter un exemplaire. Pour moi, je l’ai perdu de vue en quittant le lycée et Courbevoie… » Un courriel de la même personne, quelques jours plus tard, me brossait le portrait d’un jeune homme rebelle et provocateur, en conflit avec l’autorité et habité par la poésie. Inutile de dire que mes démarches auprès de la mairie de Courbevoie, comme auprès de celle où il habitait « aux dernières nouvelles » sont restées sans effet.
Il y a cela de bon dans les livres, et c’est que, pendant le temps d’une lecture, on arrache un auteur oublié au désert du silence où il s’était perdu. JeanJacques Mahet écrivait, dans l’un des poèmes cités plus haut, » donnez-moi aujourd’hui / le plaisir immobile / d’être sans avenir », et l’on retrouve, dans d’autres textes, de manière récurrente, ce souhait morbide de disparaître sans laisser de traces. Sur ce point-là, si telle était sa volonté, il a presque complètement réussi.
Michel Diaz
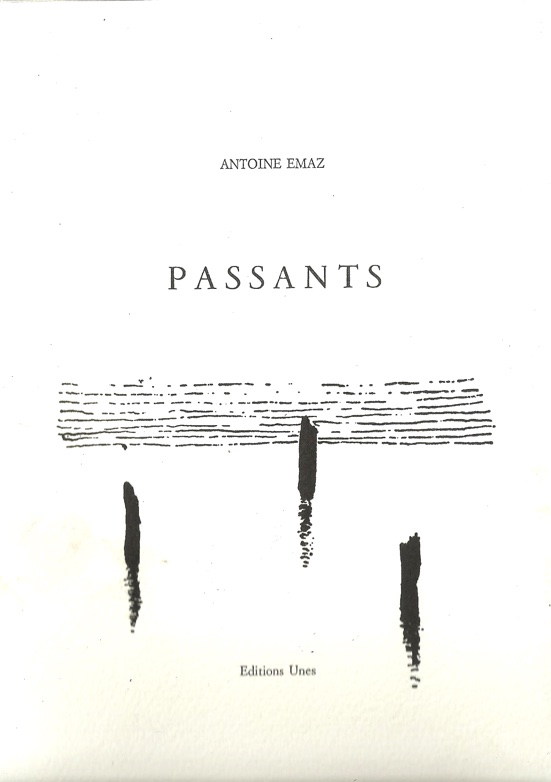 Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.
Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.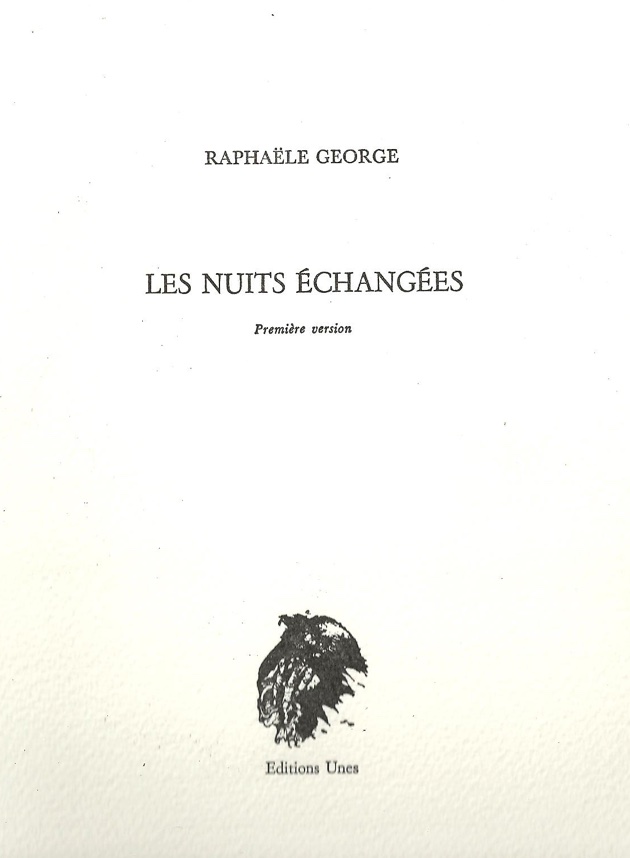 Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.
Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.
