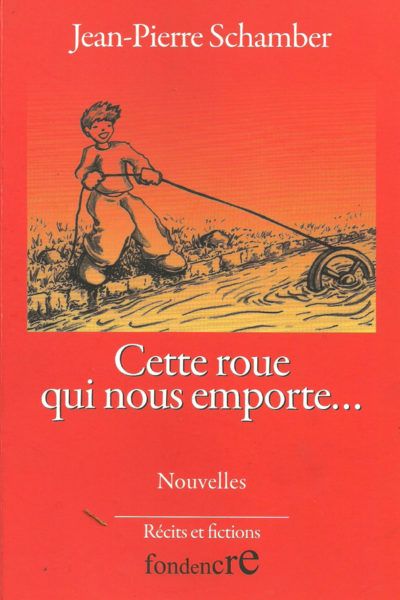 CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber
CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber
Editions Fondencre (2008)
Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, les lecteurs français n’aiment pas les nouvelles, ou en tout cas les boudent. Les libraires aussi, qui hésitent à les exposer sur leurs présentoirs, voire les refusent à leurs diffuseurs. Se donnant pour priorité, sans doute, de satisfaire l’engouement du lectorat pour le roman (genre dont l’impérialisme lamine sans ménagement presque tout le reste de la production littéraire).
La publication d’un recueil de nouvelles est donc suffisamment rare sous nos climats pour ne pas signaler à ceux qui s’intéressent à ce genre (dont l’exercice est pourtant difficile et réclame beaucoup de maîtrise) celui de Jean-Pierre Schamber, Cette roue qui nous emporte…, paru en 2008 aux éditions Fondencre.
Ce n’est que sept ans après sa publication que ce court ouvrage m’est parvenu entre les mains, en octobre dernier, pour mon plus grand plaisir, à l’occasion de la rencontre avec son éditeur au « salon de la poésie, de la nouvelle et du roman » de Vendôme.
« Albert, le patron du restaurant où nous avions nos habitudes, s’est approché de nous, rougeaud, boudiné dans son long tablier d’un blanc immaculé, sa haute toque bien droite sur la tête. Avec son accent épais, il nous a demandé « si ces messieurs dames étaient contents et si tout allaient comme ils voulaient ? » Ainsi commence le recueil, par la nouvelle Tournedos Rossini, et par cet incipit qui plante aussitôt le décor. Quelques lignes plus loin, après l’apparition d’un nouveau serveur, « un grand brun efflanqué », voilà l’action lancée. Nous sommes à l’époque de l’occupation. En 1942. Les convives sont deux collabos, le serveur, un juif employé par le patron du restaurant et, dehors, se prépare en silence la rafle du Vel d’hiv. En quelques pages, nous sommes plongés dans toute une époque, et dans l’intimité de personnages que presse le destin. Dans les coulisses d’une tragédie.
Je dirai pourtant, avant de poursuivre, que mes goûts personnels, appétits de curiosité, intérêt pour la découverte et passion plus particulière pour le théâtre contemporain, la poésie dite « moderne », en un mot pour les « défricheurs » littéraires, m’ont longtemps fait préférer les auteurs qui se situaient dans les espaces d’une création résolument nouvelle (souvent assez marginale, il faut bien le dire) et, sinon « d’avant-garde » et expérimentale, du moins plus aventureuse, d’un abord plus ingrat et plus audacieuse dans ses recherches et propositions que celle qui fait le bonheur d’un plus large public, de nombre d’éditeurs, alimente les prix des « rentrées littéraires » et les succès de librairies. Pour ce qui concerne les nouvelles, mes préférences vont (sans distinction d’époque) à des auteurs russes comme Tchékhov ou Gogol, germanophones comme Kafka ou Zweig, ou anglo-saxons, comme Faulkner, Cheever, Carver ou d’Ambrosio, mais encore Annie Proulx et Alice Munro, ou à quelques auteurs publiés par les excellentes éditions belges Quadrature. Force m’est d’avouer (donnant par là quelque peu raison aux libraires et aux lecteurs) que les auteurs français de nouvelles ne me paraissent pas toujours à la hauteur de ces derniers et des exigences qu’impose ce genre.
Les textes de Jean-Pierre Schamber pouvaient-ils relever ce défi ? C’est là que j’en voulais venir, après ce détour qui avait pour but d’éclairer mon approche du livre. On peut lire, dans l’Avant-propos de son recueil, que la collection Récits et fictions où il est publié a « l’ambition d’illustrer certains traits permanents de l’humanité dans une perspective résolument contemporaine. » Et l’éditeur poursuit ainsi la présentation de ces textes : « L’action des cinq nouvelles ici réunies se déroule de 1942 à… 2025. Un regard qui parcourt et déborde la seconde moitié du XXème siècle. […] Qu’il s’agisse de la collaboration ou de mai 68, de la technique de Jackson Pollock ou de l’exégèse d’un poème de Valéry, de telles références n’ont pas pour simple objet de planter un décor mais font battre le cœur même de la composition. » Cela se vérifie à la lecture.
Je laissais cependant entendre, plus haut, que c’est avec quelque réserve, une manière de prudence fondée sur mes attentes exigeantes, que je suis entré dans ces pages. Et j’en ai aussi donné la raison.
Tout obéit ici aux règles « canoniques » du genre : incipit accrocheur, resserrement de l’action dans des lieux presque uniques autour de personnages peu nombreux, portraits dessinés avec acuité ou délicatesse, plongée soudaine dans l’intimité des êtres et leur complexité, progressive montée de l’intensité dramatique, chute souvent brutale. De « la belle ouvrage » de nouvelliste… Mais l’écriture, à sa première approche, m’a semblé d’abord un peu « sage », sans marques de rudesse dans le rythme des phrases, pas assez bousculée à mon goût, manquant peut-être un peu « d’aspérité », s’autorisant aussi bien peu d’audaces stylistiques, en dépit d’une belle facture. Tout cela restant assez proche, dans son « classicisme », du système narratif d’un Maupassant ou d’un Huysmans (excusez quand même du peu !), mais système de narration que l’on aimerait voir un peu renouvelé. Impressions purement subjectives, bien entendu, que je me garderai de faire passer pour un jugement esthétique ayant valeur d’autorité. D’autant que, passés les premiers textes, et installé dans l’univers de cet auteur, il est bien difficile, je crois, de ne pas se laisser emporter par ces pages où tout ne peut que retenir l’attention du lecteur, le tenir en haleine et provoquer son émotion.
Et il y a aussi des moments forts, non plus coulisses mais scène même de la tragédie, comme celui, lors du débarquement sur les plages de Normandie, en 1944, où le jeune peintre Ronald Wilkinson voit son ami William mourir, à côté de lui. Mort qui l’obsèdera et dont il cherchera, sa vie durant, à exorciser la vision terrible en inventant la technique picturale du dripping, technique dont J. Pollock se fera l’héritier : « … Soudain, il ne fut plus là. Ou, plus exactement, il fut cisaillé en deux, le haut de son corps disparu dans un éclaboussement de gerbes rouges dessinant de grandes arabesques vermillon, tandis que le bas s’affaissait sur la plage, à vingt centimètres de Ronald. Le sang continuait à gicler de cette béance en jets qui creusaient dans le sable de minuscules cratères dont la couleur variait avec la profondeur en des camaïeux de rouges et de bruns qui étaient ensuite recouverts par d’autres giclées qui teignaient l’alentour d’un rose moins soutenu. » L’auteur a trouvé là un sujet magnifique dont il sait tirer le meilleur parti – même si la chute est, peut-être, un peu attendue.
Mais la guerre, dans cet ouvrage, est aussi ailleurs et partout, tout autour de nous, dans les rapports entre les individus que les exigences économiques de performance et de rentabilité, devenues nos normes sociales, transforment en « tueurs ». Le règne de l’argent, devenu souverain, reléguant l’humain à sa seule valeur marchande, est dénoncé dans la nouvelle Le nécessaire à sushis comme la plus grande offensive jamais menée depuis que l’homme est Homme contre l’Homme lui-même. Guerre sociale, et conduite aussi de manière feutrée, dans les coulisses des grands groupes industriels ou financiers par les soldats fanatisés du capital : « Avec ses homologues, la perpétuelle lutte fratricide pour l’accession au sommet de la pyramide justifiait tour à tour, le tutoiement, l’usage du prénom, les remarques fielleuses et les peaux de bananes dont sont jonchés les couloirs des grandes entreprises. »
Après le beau texte Cette roue qui nous emporte, dont la construction, fragmentée en archipel, m’a beaucoup séduit, l’ouvrage se termine par un texte qui se situe en 2025, après l’adoption par l’Assemblée Nationale de l’I.V.V., l’Interruption Volontaire de Vie. L’auteur y plante le décor de l’établissement dans lequel se rend Marianne, accompagné de son époux, afin d’y achever sa vie. C’est, nous confie le narrateur, sur le premier mouvement du concerto pour violon de Berg, A la mémoire d’un ange, que « sans un spasme, sans une contraction, sa main relâcha doucement son étreinte et s’ouvrit, paume vers le ciel. J’attendis l’ultime murmure de la dernière note tenue du violon, posai mes lèvres sur sa bouche encore tiède, arrangeai, une dernière fois, une mèche de ses cheveux, et sortis, sans rencontrer personne. »
Nous pouvons lire encore, dans l’Avant-propos du recueil, qu' »outre leur intérêt documentaire, les récits émaillés de ruptures tiendront le lecteur en haleine. » En cela, le recueil de Jean-Pierre Schamber tient parfaitement ses promesses. On sort de la lecture de cet ouvrage (inscrit dans son époque et capable d’en rendre les vibrations sismiques) en même temps troublé et un peu étourdi, avec aussi le sentiment que son auteur a joué, et tout à fait utilement, son devoir d’écrivain.
Michel Diaz (11 nov. 2015)